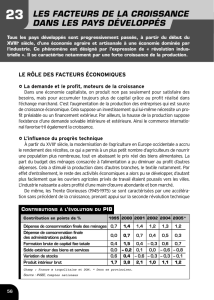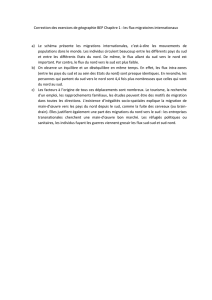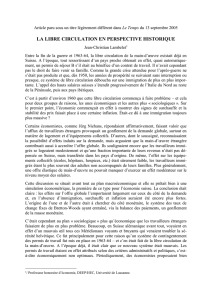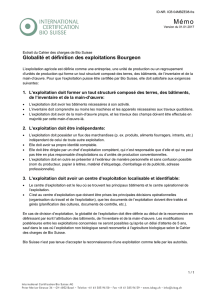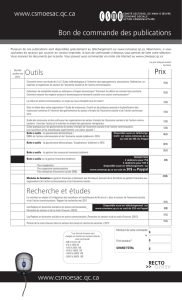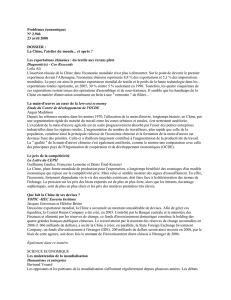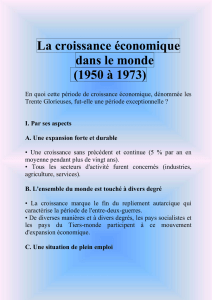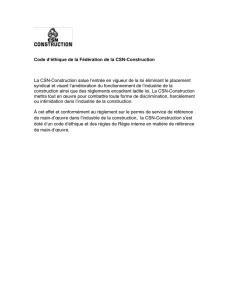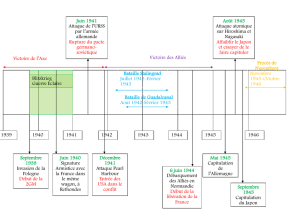vichy dans l`histoire des politiques francaises de la maind`œuvre

ÉTUDES
Travail et Emploi n° 98 • Avril 2004 • 77 •
Dans l’histoire encore peu explorée (1) de la poli-
tique française de la main-d’œuvre, le « moment
Vichy » est assurément paroxystique, mais est-il le
seul à présenter ce caractère? Depuis la Première
Guerre mondiale, événement fondateur de cette
politique, les épisodes dramatiques marqués par des
retournements soudains de conjoncture n’ont pas
manqué: l’économie française a connu, de 1914 à
1945, des phases de chômage massif (2) et des
crises aiguës de pénurie de main-d’œuvre (3), qui
ont pu, en certaines occasions, se superposer. Ce
sont à coup sûr ces mouvements d’accordéon de
très grande amplitude, dus pour une part à la
conjoncture économique mais bien davantage au
poids des guerres, qui ont entraîné la mise en œuvre
d’une politique de la main-d’œuvre ayant pour objet
« d’adapter aussi exactement que possible les
ressources humaines d’une Nation à ses besoins
généraux et plus spécialement à ses besoins écono-
miques » (4) (J. DESMAREST, 1946, p. 1).
L’épisode vichyste n’en constitue pas moins un
épisode à part en raison des circonstances très parti-
culières de l’Occupation. Conçue à l’origine pour
servir la Nation en armes (5), la politique de la
main-d’œuvre a, pour la première fois dans son
histoire, été mise au service d’une puissance étran-
gère qui dominait une grande partie de l’Europe. La
France ou, plus exactement, la France de Vichy est,
en outre, de tous les pays ayant été occupés par les
nazis, celui qui a fourni le plus de bras à l’économie
du Troisième Reich, aussi bien sur son propre terri-
toire qu’à destination de l’Allemagne (6). Cette
(*) MiRe-DREES, Chercheur associé à l’IDHE et à l’IHTP.
(1) L’étude la plus fouillée est celle de l’Allemand B. ZIELINSKI, 1995, qui s’est surtout penché sur les archives allemandes. La recherche historique
française accuse un net retard sur son homologue allemande qui s’est notamment intéressée à la politique de la main-d’œuvre allemande au cours des
deux conflits mondiaux (cf. notamment: HERBERT, 1990 et 1991; BADE, 1987), l’Allemagne ayant « capté » quelque 2,5 millions de travailleurs étran-
gers durant le premier conflit et plus de 7 millions durant le second. Il existe, pour la France, quelques monographies régionales et départementales
sur la Relève et le Service du Travail Obligatoire : voir bibliographie in HARBULOT, 1996-1997. Voir aussi, l’étude engagée de EVRARD, 1972.
(2) août 1914-printemps 1915; septembre 1931-septembre 1937; septembre 1939-décembre 1939; 22 juin 1940-fin 1941.
(3) 1915-1930; 1937-1940; 1941-1945.
(4) Jacques DESMAREST fut, ce qu’il ne mentionne pas dans son ouvrage, chargé de mission auprès de Jean TERRAY, le commissaire à la lutte contre le
chômage, puis directeur de cabinet au Commissariat général à la Main-d’œuvre française en Allemagne.
(5) Discours d’A. THOMAS aux usines du Creusot, avril 1916: « Au temps de la grande Révolution, lorsqu’aux heures tragiques de 1793 et 1794 la
Convention multipliait, pour mieux défendre le sol menacé de la Patrie, les institutions nouvelles, c’était toute une France nouvelle, notre France poli-
tique et administrative d’aujourd’hui qu’elle créait de toutes pièces dans le danger. Aujourd’hui, c’est par un effort identique, c’est par l’union de tous,
par toutes les mesures d’organisation et d’union que la nécessité nous impose, que du sein même de cette guerre effroyable la France économique
surgira. (…) « Forgez, tournez, usinez, camarades, vous usinez pour la victoire, vous usinez pour la France de demain, celle qui toujours défendra le
droit, mais qui, puisqu’il le faut, saura l’imposer par sa force ». (Bulletin des Usines de guerre, n° 1, 1er mai 1916).
(6) A l’automne 1943, les Français constituaient, en Allemagne, le groupe national le plus important avec plus de 26 % de la main-d’œuvre masculine
étrangère. Selon les statistiques produites au tribunal de Nuremberg, 7748568 000 heures de travail auraient été soustraites à l’économie française, au
seul titre des « déportations » de main-d’œuvre (Document 515-F: Rapport au gouvernement: travail forcé en France et déportations de main-d’œu-
vre en Allemagne).
Vichy dans l'histoire des politiques françaises
de la main-d'oeuvre
Vincent Viet (*)
Cet article se propose, à travers l'étude d'un moment paroxystique qui coïncide avec les années d'occupation
pendant la Seconde Guerre mondiale, d'appréhender la dimension historique des politiques de main-d'œuvre
en France. L'étude de ce moment atypique permet de cerner les caractères originaux d'une politique qui
connaîtra des retournements spectaculaires de conjoncture. De juillet 1940 au printemps 1942, les autorités
vichyssoises ont déployé une grande énergie pour conserver le contrôle intégral des questions de main-d'œu-
vre: elles n'aboutiront qu'à détourner la politique française de la main-d'œuvre, conçue pour soutenir la
nation en armes, de ses fondements originels acquis pendant la Première Guerre mondiale. Politique très
sensible aux variations de la conjoncture économique, c'est aussi une politique à mémoire compartimentée,
qui peut déployer des mesures types à chaque fois insuffisantes, car les problèmes toujours inédits imposent
d'autres mesures d'urgence. Oscillant entre rémanence dirigiste et libéralisme mesuré, sa compréhension
mobiliser plusieurs conceptions de l'Etat.

• 78 • Travail et Emploi n° 98 • Avril 2004
donnée lourde est d’autant plus paradoxale que
l’État français aura « tout fait » pour éviter le
régime de réquisition institué dans des pays comme
la Belgique ou la Hollande. Ne s’est-il pas « cons-
tamment réclamé de ses pouvoirs de collaboration
avec le gouvernement du Reich en revendiquant le
droit d’organiser le recrutement selon les méthodes
de son choix sur tout le territoire » (7). Tout s’est
ainsi passé comme si la volonté de conserver le
contrôle des opérations de main-d’œuvre avait
produit des résultats contraires et s’était, du même
coup, retournée contre les autorités vichystes, qui
redoutaient, à juste titre, le coût politique et psycho-
logique des prélèvements de main-d’œuvre en
faveur de l’Allemagne.
Tous ces paradoxes invitent à se pencher sur le
cours d’une politique qui s’est référée jusqu’en
mars 1942 aux expériences du passé, accumulées
depuis la Première Guerre mondiale, avant d’ins-
crire résolument la question des réquisitions et des
prélèvements de main-d’œuvre dans la collabora-
tion d’État. Quel sens la lecture d’un moment
paroxystique faisant écho au premier conflit
mondial peut-elle apporter à la compréhension
d’une politique très sensible aux variations de la
conjoncture économique et politique?
arder à tout prix le contrôle
des opérations de main-d’œuvre
(juillet 1940-janvier/mars 1942)
De périphérique qu’elle était par rapport au cadre
national de la politique de la main-d’œuvre, la ques-
tion des prélèvements de main-d’œuvre s’est
progressivement imposée en fonction des stratégies
économiques allemandes, des pressions que les
autorités d’occupation ont pu, à plusieurs
niveaux (8), exercer pour obtenir de la main-d’œu-
vre française et étrangère, ainsi que des négocia-
tions qui en ont résulté.
G
Des remèdes classiques
face à une situation inédite
Les circonstances de la défaite et la partition du
territoire en plusieurs zones ont assurément boule-
versé les données d’une politique qui s’exerçait
depuis 1938 dans le souvenir encore bien présent de
l’expérience dirigiste de la Première Guerre
mondiale. Désormais partagé en cinq zones, le pays
se trouvait plongé, depuis l’exode de 10 à
12 millions de réfugiés vers les régions du sud, dans
une situation catastrophique. L’arrêt forcé des fabri-
cations de guerre, les frais d’occupation écrasants,
le transfert des machines et des matières premières
françaises en Allemagne, le blocus britannique et
les réquisitions de matériel devaient engendrer un
chômage massif qui atteignit, en novembre 1940,
plus d’un million de personnes (9) (805 409
chômeurs secourus), tandis que 1800000 soldats
étaient faits prisonniers (10) (DURAND, 1994). La
crainte de voir se constituer des pôles de contesta-
tion parmi les populations ainsi touchées était
cependant suffisamment forte pour que les autorités
d’occupation se rallient à la stratégie (dominante
jusqu’à la fin de l’année 1941) du conseiller alle-
mand ECKELMANN (11) axée sur l’utilisation de la
main-d’œuvre sur place, ce qui n’excluait pas des
transferts d’ouvriers volontaires à destination de
l’Allemagne (12).
C’est en combinant des pratiques expérimentées
pendant la crise des années 1930 avec des mesures
novatrices que les responsables politiques de l’État
français se sont attaqués au problème du chômage.
Au nombre des remèdes courants figurent l’inter-
diction - fort théorique - des cumuls d’emplois et du
travail au noir (loi du 11 octobre 1940), le lance-
ment de grands travaux destinés à lutter contre le
chômage (lois du 5 et du 11 octobre 1940) et la
réduction de la durée du travail (13) qui devait bien-
(7) « La main-d’œuvre française pour l’Allemagne », Revue internationale du Travail, Vol. XLVII, n° 3, mars 1943, pp. 354-387. Cette situation distin-
gue la France des pays occupés où l’administration allemande a organisé elle-même le recrutement, et des pays politiquement liés à l’Allemagne avec
lesquels le gouvernement du Reich a procédé par voie d’accords (par exemple l’Italie) en laissant aux gouvernements le soin de recruter et de lui four-
nir les contingents fixés.
(8) Les questions de main-d’œuvre ont été évoquées, débattues et négociées au niveau gouvernemental (négociations avec le Militärbefehlshaber),
diplomatique (Délégation générale aux relations économiques franco-allemandes d’octobre 1941 à janvier 1943, Direction des services de l’Armistice
et Direction générale du gouvernement dans les territoires occupés); aux niveaux régional et départemental (les Feldkommandanturen et les services
allemands de la main-d’œuvre ont également négocié avec les préfectures et les services français de la main-d’œuvre); au niveau des organes admi-
nistratifs, chargés de mettre en œuvre cette politique (direction de la main-d’œuvre et services extérieurs du ministère du Travail, organismes ad hoc
comme le Commissariat à la Lutte contre le Chômage (CLC), le Commissariat général au STO, le Commissariat général interministériel au STO, le
Secrétariat général à la Mains-d'Œuvre.
(9) 1100000 chômeurs, dont la moitié appartenait à la région parisienne. Ce chiffre ne recouvre que les chômeurs de nationalité française.
(10) 1600000 d’entre eux ont connu la captivité en Allemagne et 1 million pendant 5 ans.
(11) Directeur du groupe VII (main-d’œuvre) du commandement militaire.
(12) De leur côté, les responsables politiques de Vichy voyaient dans le chômage « une menace pour leur légitimité face à la population française »
(ZIELINSKI, 1992).
(13) Une enquête de l’Inspection du travail portant sur 46000 établissements révèle que 10 % d’entre eux travaillaient, en février 1941, moins de
24 heures par semaine, 18 % de 24 à 32 heures et 15 % de 32 à 40 heures; 42 % travaillaient 40 heures et 15 % seulement davantage.

ÉTUDES
Travail et Emploi n° 98 • Avril 2004 • 79 •
tôt échoir aux Comités d’Organisation (14). Si le
durcissement de la réglementation du travail appa-
raît conforme à l’idéologie du régime, Vichy n’a fait
en réalité que reprendre à son compte la législation
restrictive de l’entre-deux-guerres: le contingente-
ment de la main-d’œuvre étrangère fut rétabli et
même renforcé (15) par la remise en vigueur de la
loi (suspendue en 1939) du 10 août 1932 sur le
pourcentage de main-d’œuvre étrangère, sans
consultation comme naguère des organisations
syndicales. Le sort des réfugiés fut, en outre,
aggravé par la loi du 27 septembre 1940 « sur les
étrangers en surnombre dans l’économie fran-
çaise ». S’inspirant d’un texte d’avril 1939 qui avait
institué des compagnies de travailleurs étrangers,
cette loi créa notamment des Groupements de
travailleurs étrangers (16), placés sous la double
tutelle du ministre de l’Intérieur et du ministre de la
Production industrielle et du Travail (17). Quant
aux mesures directement inspirées par l’idéologie
du nouveau régime, elles se résument pour l’essen-
tiel à la loi peu appliquée du 11 octobre relative au
travail féminin, visant à limiter le nombre des
femmes dans les administrations publiques, à y
interdire le recrutement ou même à provoquer leur
départ dans certaines circonstances (18).
Les réformes les plus novatrices concernèrent le
placement et l’indemnisation du chômage. Une loi
du 11 octobre 1940 remplaça les Offices départe-
mentaux de placement et les Fonds publics de
chômage par des Offices du travail régionaux et
départementaux, placés sous l’autorité des inspec-
teurs divisionnaires du travail. Était ainsi réalisée la
fusion, amorcée depuis les premiers mois de la
guerre, entre les organismes chargés de prononcer
l’admission aux secours de chômage et ceux qui
avaient pour rôle de procurer du travail. La réforme
allait insidieusement permettre à l’occupant d’exer-
cer des pressions locales pour obtenir de la main-
d’œuvre touchée par le chômage. Une autre innova-
tion importante fut la création, à la même date, d’un
Commissariat à la Lutte contre le Chômage (19),
chargé de recenser la main-d’œuvre disponible et
ses possibilités d’emploi, de rechercher les travaux
de toute nature susceptibles d’être entrepris, d’éta-
blir un programme pour la réalisation et le suivi de
ces travaux, et de diriger sur eux la main-d’œuvre
disponible. A ce titre, cette nouvelle structure,
placée sous la tutelle purement nominale du minis-
tère de la Production industrielle et du Travail, eut à
gérer les formations de main-d’œuvre encadrée qui
comprenaient les Groupements de Travailleurs
Étrangers et le Service de la main-d’œuvre indi-
gène, rattaché depuis le début de la guerre au minis-
tère du Travail. Le Commissariat à la Lutte contre le
Chômage fonctionnait différemment selon qu’il
s’agissait de la zone libre ou de la zone occupée:
dans la première, où le nombre de chômeurs fut vite
résiduel, il remplissait la fonction d’un organisme
de reclassement, complétant l’action des services de
placement; dans la seconde, il se préoccupait avant
tout de résorber le chômage. Sa direction fut
d’abord confiée à François LEHIDEUX puis, le 3 déce-
mbre 1941, au Secrétaire général à la Mains-
d'Œuvre et au Travail, Jean TERRAY, qui avait théo-
riquement sous ses ordres Henri MAUX pour la zone
Sud (Maux, 1942 et DESMAREST, 1946, pp. 138-
158).
Les prélèvements de main-d’œuvre
Le problème des prélèvements de main-d’œuvre
a d’emblée revêtu deux aspects: les réquisitions sur
place et l’envoi en Allemagne de travailleurs fran-
çais ou étrangers. Objectivement liées, ces deux
questions ont cependant reçu un traitement séparé
jusqu’au début du mois d’octobre 1941, date à
laquelle Jacques BARNAUD a pris la direction de
toutes les négociations relatives aux prélèvements
de main-d’œuvre.
Prévues par la Convention de La Haye du
18 octobre 1907 (20), les réquisitions locales pour
des travaux divers au bénéfice des troupes d’occu-
pation ou d’opérations ne pouvaient donner lieu à
aucune protestation officielle de la part de la
Direction française de l’Armistice, sauf cas de
brutalité avérée (21). Les préfets de la zone occupée
(14) La loi du 31 décembre 1941 allait reprendre dans un seul texte l’ensemble des dispositions légales destinées à lutter contre le chômage. Elle réaf-
firma le principe de la réquisition totale des exploitants et salariés, hommes et femmes, âgés de plus de 14 ans, appartenant aux exploitations agrico-
les ou forestières et aux ateliers d’artisanat rural. Elle réorganisa enfin les réquisitions de travailleurs adultes ou de jeunes gens pour le service civique
rural: les premières devaient être opérées de préférence parmi les chômeurs ou les oisifs, puis parmi les anciens agriculteurs et les manœuvres et ne
devaient atteindre des ouvriers spécialisés qu’en dernier ressort; les secondes devaient pourvoir aux besoins des régions déficitaires après entente entre
les préfets désintéressés.
(15) Lois du 27 août et du 27 septembre 1940.
(16) Les compagnies de travailleurs étrangers avaient été disloquées par la retraite et regroupées par les autorités françaises dans le Midi. Les Espa-
gnols qui s’y trouvaient furent regroupés avec les démobilisés des armées polonaise, belge et tchèque. Comme l’armée française de l’Armistice ne
pouvait plus assurer leur encadrement, le ministère du Travail fut chargé de prendre le relais.
(17) La gestion de ces groupements comprenant une majorité de réfugiés espagnols, de Polonais et de Tchécoslovaques fut très rapidement confiée au
Commissariat à la Lutte contre le Chômage.
(18) En fait, le personnel féminin devait être plus nombreux que jamais dans les administrations et les entreprises privées.
(19) Loi du 11 octobre 1940.
(20) Art. 6 de la Convention: L’État peut employer, comme travailleurs, les prisonniers de guerre, selon leur grade et leurs aptitudes, à l’exception
des officiers. Ces travaux ne seront pas excessifs et n’auront aucun rapport avec les opérations de guerre.
(21) Comme dans le Nord où les autorités d’Occupation procédèrent à des rafles.

• 80 • Travail et Emploi n° 98 • Avril 2004
(où les pressions allemandes furent les plus dures)
n’en dénoncèrent pas moins, dès octobre 1940, les
procédés « déloyaux » qui les sous-tendirent: les
ouvriers recrutés sur place étaient débauchés de
leurs entreprises par l’offre de salaires très supé-
rieurs à ceux qu’ils percevaient jusque-là, et la
durée du travail que le régime de Vichy s’efforçait
de réduire dans les entreprises françaises pour lutter
contre le chômage était beaucoup plus élevée dans
les entreprises placées sous contrôle allemand (22).
Dès lors que le caractère « militaire » des réqui-
sitions fut patent, des négociations s’engagèrent
avec les autorités du Majestic, auxquelles prit part
le délégué général à l’Équipement national,
François LEHIDEUX (23). « Dans un esprit de collabo-
ration constructive » et bien qu’il eût dénoncé le
caractère extra-conventionnel des réquisitions à
caractère militaire (Organisation Todt, chantiers de
la Kriegsmarine, de la Luftwaffe, etc.), ce dernier
accepta, le 20 décembre, que le Commissariat à la
Lutte contre le Chômage fournisse de préférence
des chômeurs aux entreprises travaillant pour l’oc-
cupant (24), mais refusa provisoirement de céder
directement de la main-d’œuvre à l’Organisation
Todt. Pour « épargner à nos nationaux d’être requis
par les autorités allemandes » (25), le Commissaire
à la lutte contre le chômage proposa, un mois plus
tard, de céder des ouvriers étrangers encadrés à
l’Organisation Todt, les chômeurs français devant
être dirigés vers les travaux agricoles (26): en
contrepartie du maintien des chantiers du
Commissariat, 11000 Espagnols seraient envoyés,
jusqu’en novembre 1941, sur les chantiers Todt,
encadrés et acheminés par le CLC en liaison avec
les services allemands (ZIELINSKI, 1992, pp. 295-
304). L’idée de placer des chômeurs français dans
l’agriculture était du reste conforme aux exigences
des autorités d’occupation qui, dans un souci de
paix sociale, souhaitaient régler au plus vite l’épi-
neuse question du ravitaillement. François LEHIDEUX
fut cependant prié, « au cas où les ouvriers refuse-
raient l’embauche dans l’agriculture, de les ramener
à plus de bonne volonté par le retrait des allocations
de chômage (27) et, si cela est nécessaire, par le
retrait de la carte d’alimentation » (28). Pour éviter
la fermeture des chantiers placés sous son contrôle,
le Commissariat à la Lutte contre le Chômage dut
dés lors s’engager, jusqu’en octobre 1941 à honorer
les demandes allemandes dans le cadre de
l’Organisation Todt (29), avec la promesse formelle
du côté allemand que la main-d’œuvre française,
employée sur les chantiers du Commissariat et sur
les chantiers ouverts par les départements, resterait
à l’abri de toute réquisition.
Il semble néanmoins que le Commissariat à la
Lutte contre le Chômage ait largement contribué en
zone libre, grâce à l’action de Henri MAUX et de
Gilbert LESAGE (POZNANSKI, 1994, pp. 531-537), à
améliorer le sort des étrangers encadrés (30) qui
furent de fait dispersés dans l’économie pour autant
qu’ils ne fussent pas réquisitionnés pour le compte
d’entreprises allemandes ou dans le cadre de l’orga-
nisation Todt (31). En octobre 1941, les ministères
concernés par l’immigration avaient d’ailleurs
arrêté une position commune contre tout nouveau
prélèvement de main-d’œuvre étrangère au profit de
l’économie allemande, estimant que « la remise de
réfugiés aux autorités allemandes aurait des réper-
cussions très défavorables à l’étranger et notam-
ment en Amérique où des faits de cette nature ne
manqueraient pas d’être exploités contre notre
pays », et que l’utilisation des 41000 étrangers
encadrés disponibles dans les Groupements de
Travailleurs Étrangers « n’empêcherait pas les
Allemands, étant donné leurs besoins illimités, de
recruter des Français en zone occupée » (32).
(22) cf. série AN F 1cIII : rapports des préfets et F 1A/3705 : synthèses des rapports de préfets.
(23) Négociations du 30 décembre 1940, du 28 janvier, 21 et 26 février, 14, 18 et 24 mars 1941. Le CLC, opérationnel depuis le 1er novembre 1940,
avait auparavant été saisi, le 12 décembre, par les autorités d’occupation d’une demande de main-d’œuvre.
(24) AN F37 46, dossier « comptes rendus du CLC », Doc. 6, Compte-rendu chronologique des relations du CLC avec les autorités d’occupation, Paris,
le 16 avril 1941, p. 1.
(25) AJ 41/426 : Compte rendu de la conférence du 2 octobre 1941 dans le cabinet de FOURCADE, directeur de la Police du Territoire et des Étrangers
au sujet d’un nouveau recrutement par l’OT de nouveaux étrangers. La citation est tirée d’une lettre d’H. MAUX lue au cours de cette réunion.
(26) AJ41/397 : Rapport DGTO, 18 février-20 mars 1941, annexe sur l’activité du CLC.
(27) Comme en août 1914, tout chômeur ayant refusé un emploi pouvait être exclu du bénéfice du secours. Dans une note du CLC de l’été 1941, il
est précisé que « la grande masse des ouvriers [français] travaillant pour le compte de l’Organisation Todt, est composée soit de requis, soit d’ouvriers
recrutés dans les offices départementaux de placement, et mis en demeure d’opter entre un engagement volontaire, ou un retrait de leur carte de
chômage » (AN F37/48, dossier: « Main-d’œuvre française pour l’Allemagne, 1941, mars-décembre, Note sur les réquisitions de main-d’œuvre fran-
çaise pour les autorités occupantes », s.d., 1941, p. 1).
(28) Lettre du 17 février 1941.
(29) Fin septembre 1941, l’OT avait recruté en zone libre 9000 travailleurs, pour la plupart réfugiés espagnols.
(30) Dès juin 1941, H. MAUX leur accorde soit le salaire de droit commun, soit une prime journalière de 8 francs au moins, leur entretien restant à la
charge du Commissariat.
(31) Par suite des prélèvements imposés par cette organisation et de la déportation des israélites, les effectifs des GTE tombèrent de 48000 en
janvier 1941 à 37000 à la fin de 1942, dispersés dans l’agriculture et l’industrie. Les 26000 Espagnols recrutés officiellement par l’OT entre 1942
et 1944 furent cependant loin d’être tous présents sur les chantiers. Avec la complicité du CLC, nombreux furent ceux qui échappèrent aux réquisi-
tions, au point d’entraîner de la part des autorités allemandes des mesures de rétorsion allant jusqu’à l’emprisonnement de travailleurs espagnols dans
de véritables camps de concentration, comme celui D’ALDERNEY dans les îles anglo-normandes (STEIN, 1979, pp. 207-209).
(32) AJ 41/426 : Compte rendu de la conférence du 2 octobre 1941 dans le cabinet de Fourcade, directeur de la Police du Territoire et des Étrangers
au sujet d’un nouveau recrutement d’étrangers par l’OT.

ÉTUDES
Travail et Emploi n° 98 • Avril 2004 • 81 •
Représentant le ministère du Travail, Marcel PAGÈS
était partisan « de les disséminer le plus possible et
[de] ne plus les qualifier d’individus en surnombre
dans notre économie nationale » (33). A la fin de
l’année 1942, marquée pourtant par un net durcisse-
ment, les travailleurs étrangers encadrés purent
enfin jouir des mêmes droits sociaux que les natio-
naux (34).
Si les autorités allemandes ont pu, dès août 1940,
exercer des pressions sur l’administration française
à l’effet d’obtenir de la main-d’œuvre étrangère
« libre » (par opposition à la main-d’œuvre étran-
gère dite « encadrée ») appartenant à des nationali-
tés précises (35), c’est essentiellement en raison du
chômage qui affectait en priorité les travailleurs
étrangers libres, objet des mesures de contingente-
ment prises en vertu de la loi de 1932. Compte tenu
du « neutralisme » amical de l’Espagne franquiste
(un certain nombre de réfugiés espagnols fut rapa-
trié) et de la protection relative dont jouissait la
communauté italienne, l’occupant reportait son
attention sur les autres travailleurs étrangers et sur
la main-d’œuvre française disponible. Sa volonté
d’avoir accès à cette dernière était déjà d’autant plus
affirmée qu’il avait à ménager les ressortissants des
puissances de l’Axe (Italiens, Allemands et ex-
Autrichiens) et que la législation française tendait
depuis septembre 1940 à favoriser le placement de
la main-d’œuvre nationale aux dépens de la main-
d’œuvre étrangère.
Que les autorités allemandes aient exigé (36)
pour les travailleurs allemands, ex-autrichiens et
italiens, présents sur le territoire français, des
« libertés et avantages au moins égaux à ceux des
Français » (37) n’est donc guère étonnant. La résur-
gence de la frontière « emploi » entre nationaux et
étrangers avait pour effet premier d’attirer l’atten-
tion des autorités d’occupation sur la masse des
chômeurs (surtout étrangers) et, tout particulière-
ment, sur les ressortissants des puissances de l’Axe
(38). Or, la Direction générale du Travail et de la
Mains-d'Œuvre entre les mains d’Alexandre PARODI
n’était guère disposée à introduire des distinctions
dans le régime juridique des travailleurs étrangers,
précisé par une circulaire du 10 septembre 1940
(39) et toujours régi par des accords internationaux,
contractés avant les hostilités. Prévoyant le relève-
ment rapide des professions utilisatrices de main-
d’œuvre étrangère, le directeur général souhaitait
retenir les travailleurs étrangers sur le territoire
national, tout en les soustrayant à l’appétit des
services allemands de recrutement (40). Un conflit
de souveraineté, dont l’enjeu n’était autre que le
statut des travailleurs étrangers « libres », s’ensui-
vit, qui devait, après la révocation d’Alexandre
PARODI, en octobre 1940, tourner à l’avantage de
l’Occupant. Ce dernier allait exiger, dès novem-
bre 1940, que les entreprises travaillant sous son
autorité fussent retranchées du champ d’application
de la loi de 1932 protégeant la main-d’œuvre natio-
nale (41). Puis, non content d’avoir encouragé les
dirigeants d’entreprise français à enfreindre cette loi
(42), il obtint, en juillet 1941, que les étrangers
travaillant pour son compte fussent munis d’une
carte d’identité dite de « travailleur » à la place de
l’ancienne carte de « non-travailleur » jusque-là
délivrée. Sur le front de l’emploi, et dans les entre-
prises travaillant pour le compte des autorités alle-
mandes, l’administration française perdit ainsi une
grande partie du contrôle qu’elle exerçait sur la
main-d’œuvre étrangère.
Les réquisitions se sont donc conjuguées avec la
législation française pour durcir la frontière
« emploi » entre main-d’œuvre française et main-
d’œuvre étrangère; mais elles ont aussi contribué à
« stabiliser » cette dernière sur le territoire national
en la dirigeant soit vers des secteurs vitaux (agricul-
ture, forestage, etc.) ou stratégiques (mines, houillè-
res, etc.), soit vers des chantiers (Organisation Todt,
Kriegsmarine, Luftwaffe) ou des entreprises placées
sous contrôle allemand.
Le « volontariat » comme gage
de la neutralité française
Les pressions des autorités d’occupation pour
obtenir de la main-d’œuvre à destination de
l’Allemagne ont d’abord été locales. Elles se sont
(33) Idem.
(34) Cette amélioration notable est ultérieurement attestée par le Directeur général du Travail et de la Mains-d'Œuvre, en 1946 : Centre d’Archives
Contemporaines de Fontainebleau (CAC) 860269, Art 8 : PV de la réunion de la CII, tenue le 11 janvier 1946.
(35) CAC 770623, Art. 68, lettre non datée et note d’Alexandre PARODI au Secrétaire Général du Travail et des Assurances, qui font état de demandes
allemandes portant sur des chômeurs slovaques, polonais, ukrainiens et yougoslaves.
(36) Par le canal des préfets, comme l’atteste une lettre du préfet du Maine-et-Loire au Secrétaire d’État à la PIT, datée du 20 sept. 1940 (CAC 770623,
Art. 68).
(37) CAC 770623, Art. 68, Note pour Monsieur le DGTMO, signée PAGÈS, DGTMO, 3ème Bureau, 1er oct. 1940.
(38 Dès août 1940, l’Administration française procéda au recensement, en zone occupée, des chômeurs français et étrangers. Les Allemands deman-
dèrent aux employeurs français soit une embauche prioritaire, soit une amélioration des quotas au bénéfice des Italiens, Russes, Slovaques, Hongrois.
(39) Circul. DGTMO du 10 septembre 1940 qui précise les modalités de délivrance des cartes d’identité de travailleur et d’application des décrets et
arrêtés de contingentement.
(40) Parodi craignait notamment que la production de secteurs stratégiques ne fût désorganisée par des prélèvements de main-d’œuvre. Le cas s’est
d’ailleurs produit en zone interdite: 8000 Polonais ont quitté les mines du Nord pour aller travailler en Allemagne.
(41) Instructions du 6 novembre 1940 confirmées le 22 juillet 1941.
(42) CAC 770623, Art. 68, Circul. Rüstungsinspektion Paris, Abt. Heer, Gr. Betreung, 2 octobre 1940.
 6
6
 7
7
 8
8
 9
9
 10
10
 11
11
 12
12
 13
13
 14
14
 15
15
 16
16
 17
17
1
/
17
100%