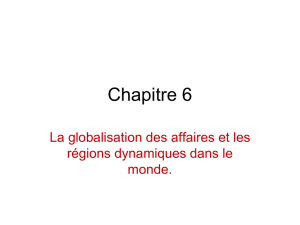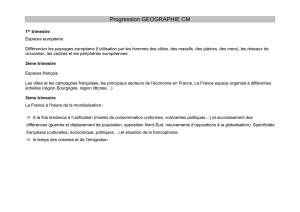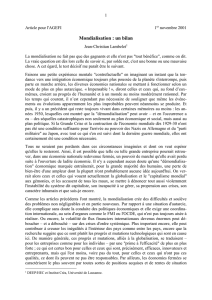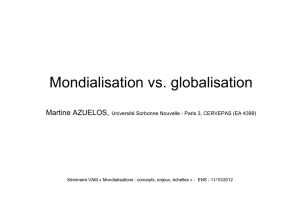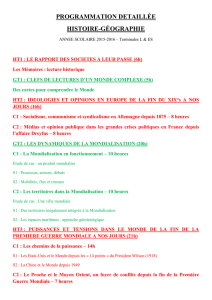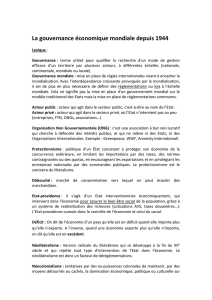313_1112_1052_Mise en page 1

Professeur David LANDES
Mondialisation, globalisation et
nationalisme : les leçons historiques
I
NTRODUCTION
: Monsieur le Professeur, Messieurs les Directeurs, chers collègues et chers
élèves, la rentrée académique aujourd’hui à HEC est marquée par un événement prestigieux,
convivial et porteur de sens. L’accueil du Professeur Landes qui nous fait le grand honneur de
délivrer cette conférence sur « mondialisation, globalisation et nationalisme » est en effet
quelque chose de très important pour nous. Ce moment est prestigieux car le Professeur
Landes est l’un des plus éminents spécialistes mondiaux de l’histoire économique et je crois
que c’est une discipline très importante. Je pense d’ailleurs que beaucoup d’entre vous avaient
travaillé sur toute ou partie de son œuvre pendant vos classes préparatoires. Ce moment est
également convivial car vous êtes, Monsieur Landes, professeur à Harvard, une institution
qui bien sûr est une institution de référence, mais également une institution avec laquelle
nous avons beaucoup de liens académiques, liens d’ailleurs dont nous nous enorgueillissons.
Enfin, ce moment est porteur de sens car votre vie et votre œuvre sont synonymes de culture
et d’internationalisation, deux maîtres mots de cette institution qui est HEC. Je tiens à rappeler
que l’une des plus belles professions de foi que vous ayez exprimées et que nous faisons nôtre
est la suivante : « L’éducation et le rapport au travail sont les deux dimensions primordiales
de toute culture ». Voilà un très beau programme pour nous tous ici cet après-midi. Au nom
du groupe HEC et au nom de tous les présents cet après-midi, vous me permettrez donc de
formuler tous mes remerciements.
_______________________
Mesdames, Messieurs et enfin chers collègues, c’est pour moi un très grand honneur d’être
invité ici et d’avoir la possibilité de connaître un peu cette promotion à ses débuts qui va
fournir des managers non seulement pour la France, mais pour le monde entier. On m’a
demandé de parler de mondialisation et de globalisation. Je dois commencer par dire
qu’effectivement, je suis historien de formation, de conviction, de prédilection, mais que j’ai
passé la meilleure partie de ma carrière professionnelle auprès des économistes et que dans
151

mon université, c’est-à-dire à Harvard, cela fait toute la différence car les économistes à
Harvard aiment bien discuter avec n’importe qui, même ceux qui ne sont pas d’accord, tandis
que les historiens sont plutôt jaloux de leur domaine. Ils sont brillants, mais ils n’ont pas le
même sens du fellowship du monde savant, c’est comme cela. Alors, c’était mon bonheur
d’être parmi les économistes. Je vais commencer par un problème. Est-ce que des nouveaux
mots signifient des nouveautés ? Je cite : développement, modernité, mondialisation,
libéralisation.
Peu d’époques de l’histoire humaine ont connu autant de bouleversements que la nôtre, surtout
depuis un siècle. C’est dans le livre de Coméliau, « Les impasses de la modernité ». Si on
ajoutait d’autres mots, globalisation, commercialisation, marchandisation, commoditification
et encore, on se croirait bien pris dans un monde bouleversé, intoxiqué, menacé, peut-être
aussi prometteur et encore. Je ne me rappelle pas quand c’était que je me suis rendu compte
que là où les autres parlaient de globalisation, les Français utilisaient le mot mondialisation.
Je me suis dit qu’il s’agissait encore une fois d’une exception culturelle. Les Français n’allaient
pas laisser l’idée, l’invention de l’idée et sa définition à l’initiative des autres, surtout pas aux
anglo-saxons. Et puis, on m’a expliqué qu’entre mondialisation et globalisation, il y avait une
différence. La mondialisation, c’était la diffusion d’une civilisation mondiale avec tous ses
aspects intellectuels et spirituels, un processus potentiellement humanitaire, égalitaire,
universaliste, mû par le respect de chacun pour chacun ; tandis que la globalisation était la
diffusion et l’établissement de l’empire des riches sur les pauvres, sur les autres, forts contre
faibles, processus économique et politique.
Mais il est évident qu’avec le passage du temps et de l’usage que le mot français mondialisation
est employé dans les deux sens et que pour les Français, la globalisation est quasiment exclue
du vocabulaire technique. Je cite dans le journal que vous connaissez tous, Le Monde : « La
mondialisation (les anglo-saxons parlent de globalisation) n’est pas en soi un phénomène
inédit. Le commerce, les échanges économiques, les multinationales, les mouvements de
capitaux, les transports internationaux rapides existent depuis plusieurs décennies, voire
plusieurs siècles ». En effet, le processus de mondialisation ou de globalisation, si vous voulez,
à ne pas confondre avec des simples échanges commerciaux, ce processus remonte au
XVème siècle à mon avis à l’expansion de l’Europe Outre-Mer, à l’ouverture du monde, à la
découverte du nouveau monde. Remarquez, il y a des historiens et philosophes progressistes
qui refusent l’idée d’une découverte. Pour eux, c’est une condescendance. Comment peut-on
découvrir ce qui est déjà là ? On pourrait tout autant parler d’une découverte par les indigènes
américains. Effectivement, on pourrait.
152

Eux aussi ont découvert, ont été surpris, mais ils n’ont pas compris la portée de la chose. Ils
ne pouvaient pas, ils recevaient. Ils ne connaissaient même pas l’envergure et la signification
de leurs propres peuplements des deux continents. Ils ne savaient même pas ce qu’était un
continent. Tout cela enfin, découverte ou pas découverte, n’est que subtilité et argutie qui,
pour des raisons idéologiques, visent à priver les Européens d’un rôle initiateur. On reconnaît
que les explorateurs européens n’ont pas tout compris. En particulier, ils croyaient d’abord
avoir traversé l’océan pour trouver le légendaire Japon, croyant le monde bien plus petit qu’il
ne l’est. Mais ils se sont vite corrigés, ils ont compris dès le début qu’ils avaient entamé, sinon
accompli, la circumnavigation du monde, et ceci d’autant plus après le passage portugais du
continent africain dans la Mer Indienne et les voyages espagnols du Mexique vers les
Philippines. Cette séquence d’ouvertures et d’expansions qu’on connaît comme la
mondialisation ou la globalisation s’est poursuivie depuis par à-coups en traversant des
périodes de progrès rapides ou lents selon les possibilités techniques et politiques. Au début,
c’était une histoire ibérique à partir de ces premières expéditions à travers la Méditerranée et
la proche Atlantique, première moitié du XVème siècle, histoire d’îles et de côtes.
Et puis, on a eu l’explosion du XVIème, l’exploitation des trésors minéraux du nouveau monde,
argent et or, dans cet ordre – argent d’abord parce qu’il y avait plus d’argent que d’or et ils
valaient plus – et l’ouverture de l’Inde et de l’Asie, tout cela avec la bénédiction du Saint-Père
de Rome qui s’est cru autorisé à partager le monde entre ses deux enfants chéris, de l’Espagne
et du Portugal. Mais la réussite même de ces premiers voyages invitait d’autres à entrer dans
le jeu, les Hollandais et les Anglais surtout, deux pays protestants voués à la mer. Ce sont ceux-
là qui ont fini par ramasser le butin de l’Asie. C’est vrai que les Espagnols ont gardé l’empire
américain jusqu’au début du XIXème siècle et en ont tiré une fortune en métal, mais cette
aubaine leur a plutôt coûté que rapporté. A l’encontre de l’argent gagné, l’argent trouvé ou
volé, dévoie le bénéficiaire. En revanche, les Hollandais et les Anglais ont bâti leurs empires
sur l’agriculture, y compris l’esclavage, et les manufactures, colonies américaines surtout, ou
sur des plantations et des privilèges commerciaux. C’étaient des entreprises rentables.
Au cours des siècles, d’autres puissances sont entrées dans le jeu, la France surtout en dépit
d’une préférence marquée pour les gains continentaux et puis tardivement le Japon. Ce dernier,
le Japon, ne s’en est pas mal enrichi, mais les gains et les ambitions impérialistes ont fini par
fausser leur politique intérieure et par encourager des convoitises qui ont amené la guerre et
le désastre. Je pense ici à la Deuxième Guerre Mondiale, la défaite après tant de victoires.
Quant à la France, elle n’a eu droit qu’à la portion congrue, les restes. Certains intérêts
particuliers ont profité de la colonisation, d’autres ont perdu. Mais le pays lui-même en a plutôt
perdu non seulement par les frais de gouvernement, de conflits et des maladies, mais surtout
par l’excès d’amour propre qui en résultait, toujours mauvais guide. Si l’on suit l’ordre des
153

événements et les progrès de l’expansion commerciale et impériale, on trouve que les jeux
étaient déjà faits avant la fin du XVIIIème siècle, tout à l’avantage des Pays-Bas avec son empire
en Indonésie et de l’Angleterre avec son empire ou les débuts de son empire en Inde.
Ensuite, on a poursuivi ce que nous appelons souvent l’impérialisme formel, l’acquisition de
colonies et de dépendances, mais pour de mauvaises raisons, c’est-à-dire des raisons mal
calculées du moins en termes commerciaux. En termes psychologiques, il y a un aspect
d’économie qui est trop souvent négligé par les observateurs critiques. C’est le fait que ces
dépendances fournissaient des carrières aux jeunes Européens, surtout ceux de bonne famille
qui y trouvaient des postes de prestige et d’influence qui les consolaient du manque de
situation comparable chez eux. Calcul ou pas parce qu’il y a le rôle des accidents aussi, la
colonisation ne touchait que 18 % des terres habitables et quelques 3 % de la population
mondiale à l’aube de l’ère industrielle, c’est-à-dire vers 1760, puis à l’apogée, disons en 1938,
42 % de la surface, 32 % des habitants. Sur cette période, la population des empires coloniaux
a cru de 27 à 742 millions d’habitants, 368 % de celle des pays métropolitains. Cela, c’est
pour l’impérialisme formel. Tout de même, le XIXème fut surtout l’âge de l’impérialisme
informel, d’attaches commerciales libres sans annexion territoriale.
Et le XXème siècle fut l’âge d’une retraite générale basée en partie sur la résistance des
colonies, mais aussi sur une décision rationnelle, toujours le calcul de la part des maîtres qui
ont fini par bien comprendre que la domination formelle ne payait plus. Au contraire, on se
rendait compte que l’argent versé aux colonies privait, c’est-à-dire n’enrichissait pas le
métropole. Je cite ici un article qui a paru à la fin du XIXème siècle : « Il est temps de consacrer
au Lot-et-Garonne et aux Basses-Alpes les dizaines de milliards que nous gaspillons au Sénégal
et à Madagascar ». Je veux simplement insérer une petite pensée où on pourrait dire, n’est-ce
pas, et discuter que les gens de ces autres parties du monde méritaient aussi des subventions,
etc. Ce serait peut-être un acte égoïste de la part des populations des pays métropolitains de
penser que tout ce qu’ils dépensaient là était pris sur leurs propres trésors, sur leurs propres
possibilités. Mais ceci dit, c’était l’attitude qui prévalait à l’époque. On pourrait poser aussi la
question si c’était l’attitude qui prévalait, comment se fait-il qu’on a essayé de garder toutes
ces colonies si longtemps ? Mais j’y reviendrai. Les plus durs et obstinés étaient les Japonais
qui ont fait la guerre pour s’imposer sur l’Asie de l’Est et les îles autour.
Ils rêvaient même de conquérir et d’annexer l’Inde, mais ils ont été battus, ils ont enfin compris
qu’il coûte moins cher d’acheter que de saisir. Et puis, on a eu comme on l’a vu des cas
d’impérialisme pour le prestige et l’amour propre, des cas où le calcul était plutôt
psychologique que matériel et économique. On pense ici surtout à la France et au Portugal,
ce sont ces pays-là qui ont le plus persisté et résisté aux efforts indépendantistes des colonisés,
ce qui leur a coûté fort cher. Rappelons-nous la guerre d’Algérie. En somme, l’impérialisme
154

formel n’a pas été la force économique qu’on a crue. Cela n’étonnera pas ceux qui y voyaient
une exploitation camouflée. On prenait, on s’emparait, on appauvrissait. Pour d’autres, ces
désavantages étaient plus que compensés par les travaux publics, la collaboration,
l’enseignement, les contacts personnels, mais ces bénéfices reflétaient à la longue l’inégalité
entre impérialistes et colonisés. L’impérialisme informel avec toutes ses inégalités impliquait
au moins un minimum d’indépendance et de capacité de la part de l’associé dépendant. Bien
négociés, bien conduits, ces arrangements pouvaient profiter à beaucoup des deux côtés de
la table.
Comme vous voyez, je préfère l’informel au formel. On dirait que l’âge d’or de l’impérialisme
informel était le XIXème siècle, surtout la belle époque de 1890 à 1914. Par rapport à cette
période d’expansion commerciale et financière, les flux de la fin du XXème siècle, surtout les
flux nets, seraient moins forts, de même pour les courants migratoires. Beaucoup des
économies pauvres d’aujourd’hui seraient, on dit, moins ouvertes, moins globalisées, qu’alors
et aussi, disent les sceptiques, moins intégrées, ceci non pas pour exprimer des regrets, mais
plutôt pour calmer les soucis. Or, je ne suis pas sûr. D’abord, on connaît le monde bien mieux
qu’autrefois, ce qui facilite l’intégration et encourage les migrations. En plus, il me semble que
les économies pauvres sont plus ouvertes qu’autrefois, plus désireuses d’entrer en relation
commerciale avec les riches car ces relations peuvent être bien profitables. J’attire votre
attention ici sur la contradiction apparente avec la doctrine d’avantage comparatif qui est
interprétée, n’est-ce pas, de façon à confiner, à restreindre, un pays à ses activités qui paient
le plus.
Du moins, c’est comme cela que l’économiste voit ces thèses. Je souligne que ce n’est pas
comparé entre deux pays différents, deux économies différentes, c’est comparé au sein de la
même économie, une activité contre une autre. Mais ce que les économistes oublient souvent,
c’est que cet avantage comparatif n’est pas fixe, cela change avec le temps. Si vous avez la
possibilité de lire dans mon livre « Richesse et pauvreté », vous verrez que je parle là de
l’attitude des économistes britanniques qui étaient en quelque sorte les chefs de la profession.
Dans la première moitié du XIXème siècle, ils étaient convaincus qu’un pays comme
l’Allemagne devait cultiver le seigle et les blés, n’est-ce pas, et ne pas s’occuper de l’industrie
parce qu’avec ce qu’ils gagnaient par l’agriculture, ils pouvaient acheter tout ce qu’ils voulaient
de la Grande Bretagne toutes les manufactures. Or, les Allemands à leur grand profit n’ont pas
accepté cette thèse. Ils ont cru – et à la longue avec raison – qu’ils avaient d’énormes
possibilités industrielles et ils sont devenus bien plus riches qu’ils ne le seraient devenus
autrement. C’est ce qu’on voit maintenant, les pays du Tiers monde, n’est-ce pas, maintenant,
veulent tous avoir des industries.
155
 6
6
 7
7
 8
8
 9
9
 10
10
 11
11
1
/
11
100%