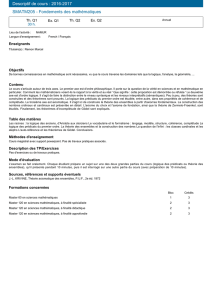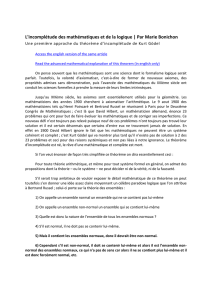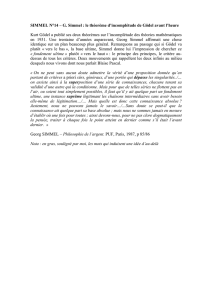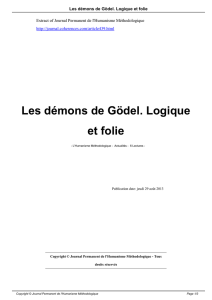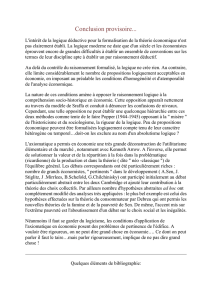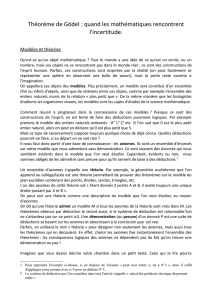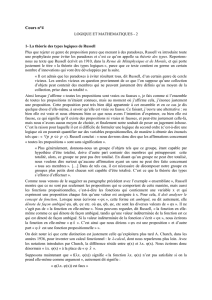Gödel le difficile


© POUR LA SCIENCE
Les États-Unis deviennent le lieu de résidence permanent de Gödel.
Pourtant, à son arrivée en 1940, son avenir est loin d’être sûr. Il connaît
les conditions strictes de naturalisation: notamment, il n’obtiendra un
permis de séjour que s’il trouve un emploi stable. Or, son contrat à Princeton ne
dure qu’un an. Peut-être est-ce la raison pour laquelle il n’indique pas sur sa
déclaration d’entrée qu’il veut demander la citoyenneté américaine. Il se ménage
ainsi, en cas d’extrême nécessité, la possibilité d’un retour en Autriche (qui est
dénommée alors la «Marche orientale du Troisième Reich»), où sa demande d’un
poste de «chargé de cours du nouvel ordre» n’a pas été retirée. Gödel entame
néanmoins les formalités de naturalisation dès son arrivée à Princeton.
Bien que des membres de renom de l’Institute for Advanced Study soutiennent
toujours Gödel, son contrat n’est prolongé qu’année par année jusqu’en 1946. En
outre, il doit demander une autorisation spéciale à chaque fois qu’il souhaite quit-
ter Princeton pour un voyage. Toutefois, Gödel ne peut s’en prendre qu’à lui-
même sur ce point, car à son arrivée à San Francisco, il a présenté non pas son
ancien document de voyage autrichien, mais son nouveau passeport allemand.
Cette étourderie lui réservera bien d’autres désagréments.
L’Institute for Advanced Study a probablement d’autres raisons de limiter la
durée des prolongations de son contrat. Entre mars 1940 et septembre 1943,
Gödel déménage quatre fois. Il justifie ces changements successifs par des motifs
qui surprennent les personnes non averties: la mauvaise qualité de l’air du centre
ville, des gaz toxiques produits par le chauffage central, ou des vapeurs nocives
s’échappant, selon lui, du réfrigérateur ou des radiateurs. Des craintes de ce genre
l’amènent à garder les fenêtres ouvertes en permanence, malgré sa sensibilité aux
refroidissements, quitte à garder son manteau chez lui.
Ce comportement inquiète non seulement ses collègues, mais Aydelotte du
State Department, qui interroge le médecin traitant de Gödel: «Estimez-vous
qu’il y ait un danger que sa maladie prenne une forme le poussant à la violence,
de sorte qu’il puisse se blesser lui-même ou quelqu’un d’autre?» Tout en respec-
tant le secret médical, le médecin assure qu’il n’y a aucun risque. La réponse suf-
fit à Aydelotte, qui conclut sa lettre de remerciement au médecin en ces termes:
«Il ne semble cependant pas nourrir de méfiance particulière concernant le sys-
tème de chauffage de l’Institut, où il poursuit son travail avec succès.»
La suite des recherches sur le continu
À peine arrivé à Princeton, Gödel reprend les cours qu’il a donnés l’année passée
sur le problème du continu, afin de leur donner une forme définitive. La tâche est
ardue, car Gödel vérifie toujours avec une méticulosité obsessive les manuscrits
destinés à la publication. Parallèlement, il donne une série de cours sur la théorie
des ensembles et une conférence à l’Université Brown (Rhode Island). Dans cette
conférence, Gödel répète sa conviction que l’hypothèse du continu est indépen-
dante des axiomes de la théorie des ensembles. En effet, argumente-t-il, si on sup-
pose le contraire, c’est-à-dire si on suppose que la négation de l’hypothèse du
continu n’est pas compatible avec les autres axiomes de la théorie des ensembles
Gödel le difficile
Après son installation aux États-Unis, en 1940,
Gödel s’intéresse de plus en plus à la philosophie,
qu’il considère indissociable de l’étude des mathématiques.
La statue de la liberté,
ici sur une carte postale
du début du XXesiècle,
symbole d’un nouveau départ
pour de nombreux émigrés d’Europe.

© POUR LA SCIENCE
69
(Gödel a déjà démontré que l’hypothèse du continu est compatible avec les
axiomes de la théorie des ensembles), cela aurait deux conséquences qui ont peu
de chance d’être exactes, dont une serait la possibilité de démontrer l’axiome du
choix. Or, Gödel est convaincu que l’axiome du choix, comme l’hypothèse du
continu, est indépendant des axiomes de la théorie des ensembles, et la recherche
d’une solution à ces questions l’occupe une bonne partie de son temps.
Depuis juin 1941, la situation politique s’est aggravée: le 22 juin, Hitler a
rompu le pacte de non-agression du 23 août 1939 et a donné l’ordre aux troupes
allemandes d’entrer en Union Soviétique; au Japon, le premier ministre, le
Général Hideki To¯jo¯, étend la guerre au Pacifique et à l’océan Indien le
17 octobre 1941 et attaque Pearl Harbor les 7 et 8 décembre.
Au mois d’octobre de cette année dramatique, Gödel écrit à son ami
Oskar Morgenstern qu’il a «percé» la question du continu et de l’axiome du
choix et que d’ici quelques mois il en présentera la démonstration. Il attend
cependant l’été 1942 pour présenter les bases de sa démonstration de l’indépen-
dance de l’axiome du choix à quelques collègues, et ne va pas plus loin. La
démonstration de l’indépendance de l’hypothèse du continu et de l’axiome du
choix ne sera fournie qu’en 1963 par Paul Cohen, jeune professeur de
l’Université Stanford. Ce dernier soumettra son manuscrit à Gödel et l’interro-
gera sur la démonstration annoncée depuis longtemps. Gödel rétorquera:
«Quelle démonstration?». Plus tard, en 1967, Gödel expliquera à Church:
«J’étais seulement en possession de certains résultats partiels concernant les
démonstrations de l’indépendance de l’axiome de constructibilité et de l’axiome
du choix […]. Sur la base de mes notes de l’époque [c’est-à-dire de 1942], très
incomplètes, je ne pouvais reconstruire sans difficulté que la première de ces
deux démonstrations. Ma méthode est plus apparentée à celle développée récem-
ment par Dana Scott qu’à celle de Cohen.»
Pourquoi Gödel renonça-t-il, à partir de 1942, à poursuivre ces recherches,
après avoir tant travaillé sur le problème du continu, alors que le sujet lui tenait
beaucoup à cœur et qu’il avait en main, selon sa propre estimation, des parties
déjà achevées d’une démonstration? John Shepherdson répondra à cette question
entre 1951 et 1953, dans un article paru en trois parties dans la revue «Journal of
Adele et Kurt Gödel à la terrasse
d’un café de Vienne, peu avant
leur mariage.
Archives of the Institute for Advanced Study, Princeton
CHAUSSETTES, CHAUSSURES ET
AXIOME DU CHOIX
« Choisir, parmi une infinité de
paires de chaussettes, une chaus-
sette de chaque paire, nécessite
l’axiome du choix, mais pour des
chaussures, il n’y en a pas besoin.»
écrivit Bertrand Russell. En effet,
l’axiome du choix est nécessaire
lorsqu’aucune propriété explicite ne
départage les éléments d’un
ensemble. Ici, toute paire de chaus-
sures compte une chaussure
gauche et une chaussure droite,
alors que rien ne permet de distin-
guer deux chaussettes d’une même
paire. L’axiome du choix permet jus-
tement de choisir quand même une
chaussette de chaque paire et de
les regrouper dans un ensemble. Il
exprime ainsi le fait que même si
nous ne pouvons différencier les
chaussettes, il existe une propriété
commune qui rassemble les chaus-
settes sélectionnées, que nous ne
savons pas expliciter.

© POUR LA SCIENCE
Symbolic Logic» (Journal de logique symbolique): il montrera que la méthode
gödelienne «du modèle interne», comme il la nomme, ne pouvait en principe pas
fournir une démonstration de l’indépendance de l’hypothèse du continu et de
l’axiome du choix (il s’agit de la méthode décrite dans le chapitre précédent,
consistant à limiter l’univers des ensembles à une partie spéciale – par exemple
les ensembles constructibles – et à montrer que tous les axiomes de la théorie des
ensembles restent valides lorsque les variables ne prennent que des valeurs appar-
tenant à cette partie). La démonstration nécessitait une approche différente.
Il n’est pas clair si et quand Gödel a reconnu ou du moins entrevu ce pro-
blème. Toutefois, ses travaux relatifs à l’hypothèse du continu et à l’axiome du
choix sont restés en souffrance après 1941 pour d’autres raisons. D’une part, son
amitié pour Einstein l’encouragea à retourner à ses premières amours, la phy-
sique, et à s’intéresser à la physique théorique et à la cosmologie; d’autre part,
Gödel consacrait de plus en plus de temps à l’étude de son autre passion, la phi-
losophie, sans laquelle il n’envisageait pas les mathématiques.
Gödel était persuadé que les questions philosophiques, par exemple celle de
l’existence des objets mathématiques, pouvaient guider les mathématiciens vers
de nouveaux axiomes qu’ils ne découvriraient pas en se cantonnant au système
formel étudié. Voyons comment se traduisent ces idées dans les derniers articles
de Gödel sur la recherche des fondements des mathématiques.
Évidence et constructibilité
En 1941, lors d’une conférence à l’Université Yale, Gödel aborde de nouveau le
problème des fondements de l’arithmétique: existe-t-il un système mathématique
où la cohérence de l’arithmétique est démontrable? D’après son théorème d’in-
complétude, un tel système n’est pas à chercher dans le formalisme finitiste de
Hilbert, mais doit le dépasser. Hilbert soutenait que les mathématiques devaient
être fondées sur des raisonnements finitistes, c’est-à-dire portant sur un nombre
fini d’objets concrets (donnés par une expérience ou une intuition sensible), et
constitués d’un nombre fini d’étapes. Gödel pense que cela ne suffit pas, et qu’il
faut aussi prendre en considération certaines propriétés abstraites des objets et des
formules des systèmes formels.
Gödel ne publie le texte de sa conférence qu’en 1958, après remaniements.
Il paraît sous le titre Sur une extension des mathématiques finitistes qui n’a pas
encore été utilisée dans le numéro spécial de la revue Dialectica consacré au
70eanniversaire de Bernays, l’ancien assistant de Hilbert. Gödel avait perdu
tout contact avec Bernays pendant presque 15 ans, puis leur correspondance
avait repris, après une visite de l’Allemand, en 1956, à l’occasion d’une invita-
tion à l’Université de Pennsylvanie. Dans son article, Gödel s’inspire de
quelques idées de Bernays. Selon ce dernier, «La non-contradiction d’un sys-
tème étant indémontrable par des moyens moins importants que ceux du sys-
tème lui-même, il est nécessaire de dépasser le cadre des mathématiques fini-
tistes au sens hilbertien pour démontrer la non-contradiction des mathéma-
tiques classiques et même de la théorie classique des nombres. Les mathéma-
tiques finitistes étant définies comme mathématiques de l’évidence claire, cela
signifie […
]
qu’on a besoin de certains concepts abstraits pour la démonstra-
tion de la non-contradiction de la théorie des nombres.» Par concepts abstraits,
il faut entendre, explicite Gödel, des concepts qui ne représentent pas les pro-
priétés des objets concrets ou les relations entre objets concrets, mais les pro-
priétés des «productions mentales», des « contenus de pensées» (par exemple
des démonstrations, des déclarations sensées).
Dans le programme de Hilbert initial, tout raisonnement finitiste équivaut à
la donnée concrète d’un objet, c’est-à-dire à «l’évidence» d’un objet ; pour
Gödel, au contraire, les rapports entre construction d’un objet (à l’aide d’un rai-
sonnement) et évidence de cet objet sont complexes. Ainsi, il distingue, dans le
raisonnement finitiste, d’une part «l’élément constructif, qui consiste dans le
fait qu’on ne peut parler d’objets mathématiques que dans la mesure où on peut
les montrer ou réellement les fabriquer par la construction» et, d’autre part,
«l’élément finitiste spécifique, qui requiert que les objets […
]
soient “évi-
70
Paul Cohen proposa en 1963
une démonstration de l’indépendance
de l’hypothèse du continu de Gödel:
on peut l’adjoindre ou non
aux axiomes des ensembles sans
engendrer de contradiction.
Stanford University

© POUR LA SCIENCE
dents”, c’est-à-dire qu’ils soient des arrangements d’éléments spatio-tempo-
rels». Puis, il souligne: « C’est cette deuxième exigence qu’il faut abandon-
ner.» Il n’est cependant pas nécessaire d’ajouter aux systèmes formels des par-
ties de la logique intuitionniste et de la théorie des nombres ordinaux, précise-
t-il, car, comme il l’a démontré, on obtient un élargissement fructueux du rai-
sonnement finitiste en utilisant «le concept de fonction calculable […
]
sur les
nombres naturels», ce qui ne requiert «aucune autre méthode de construction
pour ces fonctions que la simple récursion sur une variable numérique et l’in-
sertion de fonctions les unes dans les autres».
Plusieurs mathématiciens poursuivront les recherches sur les fondements des
mathématiques dans ce sens, en particulier le mathématicien autrichien
Georg Kreisel, émigré lui aussi, à qui Gödel procura en 1955 un contrat à
l’Institute for Advanced Study. Le jeune mathématicien américain
Clifford Spector se passionnera lui aussi pour cette approche, mais mourra d’une
leucémie à l’âge de 30 ans. Gödel le considérait comme le meilleur logicien des
États-Unis de la seconde moitié des années 1950.
Pour Gödel, l’étude de la constructibilité des objets est importante pour
deux raisons: elle permet d’une part de réfléchir sur la notion d’« évidence»
et, d’autre part, de comparer la «puissance » démonstrative de systèmes for-
mels donnés. Il déclare à ce sujet: « C’est le fait que Hilbert tienne à tout prix
à la connaissance concrète qui rend les mathématiques finitistes si incroya-
blement faibles et qui exclut beaucoup de ce qui paraît à tout un chacun aussi
convaincant que les mathématiques finitistes elles-mêmes. Par exemple, alors
que toute définition récursive primitive est finitiste, le principe général de
définition récursive primitive n’est pas une proposition finitiste, car il contient
le concept abstrait de fonction. Rien dans le concept de “finitiste ” ne laisse
supposer une limitation de la connaissance concrète. Seule l’interprétation
personnelle de Hilbert introduit une telle limitation.»
Apprendre à vivre avec le cercle vicieux
Gödel explicite sa position pour la première fois dans son article La logique
mathématique de Russell (1944), rédigé à la demande de Paul Schilpp pour un
ouvrage commémoratif sur Russell. La contribution de Gödel, souligna Schilpp,
était sollicitée par Russell lui-même, qui considérait le logicien autrichien comme
«l’autorité par excellence du domaine».
Fidèle à ses opinions, Gödel consacre une bonne partie de son article à cri-
tiquer le cheminement du philosophe britannique, qui l’a amené d’une «posi-
tion vraiment réaliste» à une position formaliste, « selon laquelle des classes
ou des concepts n’existent jamais en tant qu’objets réels, et selon laquelle des
propositions contenant ceux-ci comme termes n’ont de sens que dans la
mesure où ils sont interprétés comme de simples façons de parler.» Gödel
regrette le Russell qui, en 1918, écrivait, dans son Introduction à la philoso-
phie mathématique : « La logique traite du monde réel exactement de la même
manière que la zoologie, quoique ce soit de ses traits plus abstraits et plus
généraux.» Gödel se conforte en effet dans sa conception réaliste des objets
mathématiques: les objets mathématiques existent a priori et, lorsque nous les
définissons, nous ne faisons que nommer des éléments déjà existants. Par cette
conception, le logicien reprend la thèse existentialiste de Platon, et se consi-
dère d’ailleurs comme un «platonicien anachronique ».
Gödel conteste, en particulier, l’anathème lancé contre le cercle vicieux,
selon lequel «aucun tout ne peut contenir des éléments ne pouvant être défi-
nis que par des concepts contenus dans ce tout lui-même.» Ce principe était
une tentative d’éviter les antinomies, telle celle de Russell (l’ensemble de tous
les ensembles qui ne se contiennent pas eux-mêmes comme éléments, se
contient lui-même si et seulement s’il ne se contient pas lui-même) dans la
théorie des ensembles.
Selon Gödel, s’il est vrai que des paradoxes naissent de cercles vicieux, il
est faux de dire que la définition d’un ensemble en termes d’un tout dont il
fait partie doit nécessairement être exclue. En effet, «on peut démontrer que
71
Contrairement à la plupart
des mathématiciens de son temps,
Gödel avait une conception réaliste
des mathématiques. Il pensait, à l’instar
de Platon (427-348 avant notre ère), que
les objets mathématiques existent a
priori, mais que nous n’y accédons
que peu à peu.
 6
6
 7
7
 8
8
 9
9
1
/
9
100%