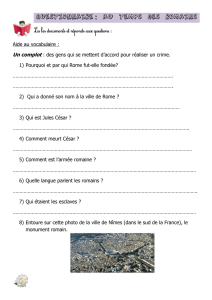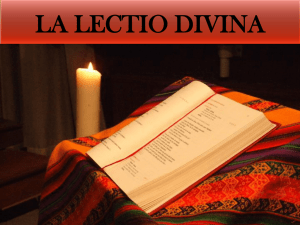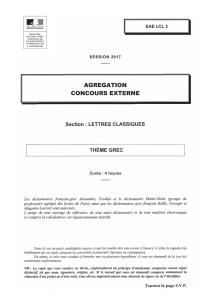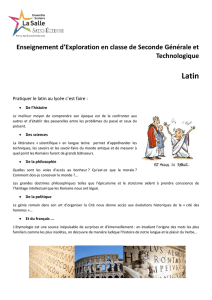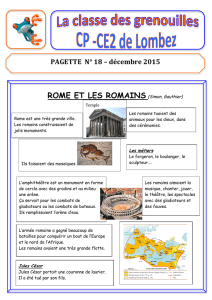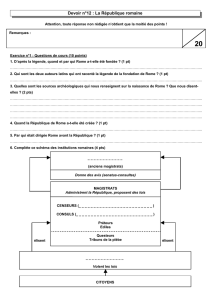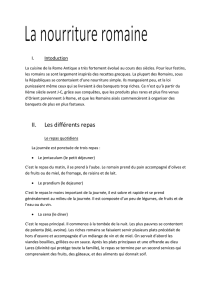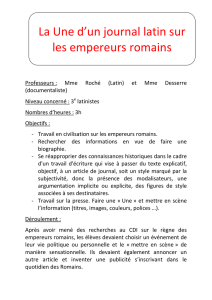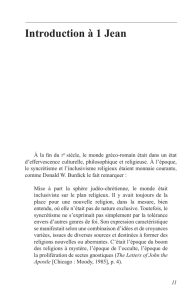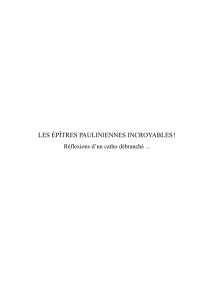l`épître aux romains - Eglise protestante unie des Alpes du Sud

1
www.protestants-gap.fr
L'ÉPÎTRE AUX ROMAINS
INTRODUCTION A L'ÉPÎTRE AUX ROMAINS
Paul rédige l'épître aux Romains à Corinthe au début de 58 après J.C. Il est apôtre depuis 25 ans,
fondateur d'Eglises depuis 11 ans. Il a annoncé l'Evangile de Jérusalem en Occident. Il songe à Rome
pour aller plus loin encore en Espagne. Il voudrait trouver à Rome une Eglise unie. Mais les chrétiens
Juifs et Grecs ont de la peine à vivre ensemble. Il ne leur a pas prêché. Il leur envoie son « évangile » ;
c'est notre lettre.
Paul fait alterner détresse et salut 1,18 à 3,20 (pécheurs) et 3,21-5,11 (justifiés) 5,12-14: Adam et
5,15-6,23 Christ, nouvel Adam, 7: la loi, complice du péché et 8: l'Esprit conduit l'homme, 9,1-10,21 les
Juifs ont trébuché et 11,1-36 : Israël sauvé, 12 à 15: vivre sa foi tous les jours ensemble sur la terre.
Richesse théologique : l'humanité pécheresse sous la colère de Dieu et la justification par la foi
sont les deux grandes lignes qui traversent cette lettre. Cette richesse théologique est toujours actuelle :
Augustin et Pélage (5e siècle), Thomas d'Aquin (Moyen Age), Luther, Bucer, Calvin (16e), Karl Barth,
Emil Brunner, la «Traduction œcuménique de la Bible ». Pour bien la comprendre, il faut lire les
ensembles et pas seulement quelques versets.
Texte de Maurice Carrez dans Parole Pour Tous.
L'ÉPÎTRE AUX ROMAINS
La bonne nouvelle est "puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit", en elle se révèle la
"justice de Dieu". Le programme des huit chapitres suivants est annoncé dès' le premier*. Le verset
suivant énonce une thèse générale qui va être démontrée par la suite : la colère de Dieu se révèle non
seulement contre les païens, mais contre tous les hommes quels qu'ils soient donc aussi contre les juifs.
Paul conclut cette section : la foi en Christ est le chemin par lequel, désormais, la justice est offerte aux
hommes. Confirmation est donnée par une preuve scripturaire : "Abraham crut en Dieu et cela lui fut
compté comme justice"** attestant ainsi que Paul s'enracine dans les Écritures.
Une nouvelle section prend acte de ce qui vient d'être acquis précédemment : "Étant donc
justifiés...". Un premier développement visant à mettre en place l'opposition entre vie dans le Christ,
donc sous la grâce, et vie dans le péché donc vie "pour la mort". Le chapitre 8 reformule l'Évangile et
rassemble toutes les objections et leurs réfutations successives en opposant cette fois vie dans la chair et
vie dans l'Esprit. Il se conclut en forme d'hymne de louange. Paul, ensuite***, tente de dire ce qu'il en
est pour lui du peuple juif : une promesse lui a été faite et celle-ci ne sera pas annulée. La fin de l'épître
est consacrée à des exhortations pratiques et des salutations circonstanciées.
* Versets 16 et 17
** Chapitre 4
*** Chapitres 9 à 11 Texte d’Élian Cuvillier, dans Parole Pour Tous, 12 Avril 2008

2
www.protestants-gap.fr
L'ÉPÎTRE AUX ROMAINS
Entre 54 et 59 après J.C., après un quart de siècle d'activité missionnaire, Paul s'apprête à porter à
Jérusalem le fruit de la collecte entreprise dans les églises qu'il a fondées. Après quoi, il envisage de
porter plus loin l'Evangile de Jésus-Christ. Il parle de l'Espagne. Pour s'y rendre, il passera par Rome*.
Paul s'adresse à une communauté qu'il n'a pas fondée. Sans doute compte-t-il sur son soutien
pour soutenir son nouveau projet missionnaire. Inversement, les chrétiens connaissent peu l'apôtre et
ne lui sont pas spontanément favorables. Cela donne la plus longue lettre conservée de Paul. La seule
aussi qui n'est pas une réaction urgente aux difficultés immédiates des destinataires habituels de l'apôtre.
Paul offre ainsi à ses lecteurs une réflexion plus construite et plus sereine, forgée et mûrie tout au
long de son ministère. S'il ne s'agit pas de toute sa pensée théologique, c'est une introduction à la vie
chrétienne individuelle et communautaire. Un concentré de l'enseignement que l’apôtre dispensait à
ceux qui, après avoir adhéré à l'Evangile, avaient reçu le baptême et devaient désormais se constituer en
communauté nouvelle, régie par la foi en Christ et dirigée par l'Esprit Saint.
* Chapitre 15, v.20 à 25 Texte de Jean Hadey, Parole Pour Tous, 12 Février 2007
L'ÉPÎTRE AUX ROMAINS
On n'aborde jamais sans tremblement la plus longue des épîtres écrites par Paul et conservée par
la tradition biblique.
Et pourtant, la place tenue par ce document dans l'histoire de l'Eglise est d'une importance
capitale. Faut-il rappeler que bien des grands théologiens, dans les moments de crise traversés par
l'Eglise, ont relu l'épître aux Romains et en ont été éclairés, encouragés, délivrés d'angoisses parfois
mortelles (Luther) ou de contradictions insolubles (Karl Barth).
Paul rédige sa longue lettre aux chrétiens de Rome en l'an 57, alors qu'il séjourne à Corinthe. Il
faut se souvenir que les évangiles tels que nous les connaissons n'existent pas encore. Le premier, celui
de Marc, ne sera écrit qu'une dizaine d'années plus tard.
De plus l'attente du Seigneur se fait moins vive, non pas parce qu'on n'y croit plus, mais parce
que l'Eglise primitive a compris que si elle voulait annoncer l'évangile jusqu'aux extrémités de la terre,
selon l'ordre de son Seigneur, il lui importait d'élaborer des positions de doctrine solides à opposer aux
religions païennes, à la gnose et aux philosophies ambiantes.
L'épître aux Romains se présente donc comme une tentative d'établir le plus brièvement mais le
plus rigoureusement possible l'aspect jugé essentiel par Paul de la prédication de l'évangile : la
justification par la foi seule. Rien ne sera ajouté, rien ne sera retranché à cette affirmation centrale et
primordiale.
Paul emploie les sept premiers chapitres de sa lettre à expliquer à ses destinataires comment la foi
gratuitement accordée et acceptée justifie, au-delà de leurs œuvres et de leurs qualités, la totalité de leur
existence.
Le chapitre 8 reste, par une sorte d'hymne cosmique à l'espérance rendue possible par la
justification de Jésus-Christ, un classique de la littérature biblique.
Les chapitres 9 à 11 auraient dû, s'ils avaient été lus attentivement, préserver les chrétiens de tout
antisémitisme mortel. Paul y évoque — on le sent pris aux entrailles — le rôle inaltérable du peuple juif
dans le plan du salut de Dieu.
A partir du chapitre 12, l'apôtre tente une sorte d'éthique pour concrétiser son enseignement dans
la vie de la communauté chrétienne de Rome.
Rendons grâces à Dieu qui nous permet aujourd'hui encore, grâce au labeur de son témoin Paul,
d'ajuster notre foi aux promesses de l'évangile.
Texte de Pierre Merlet dans Parole pour Tous.

3
www.protestants-gap.fr
L'ÉPÎTRE AUX ROMAINS
L'Évangile étant déjà annoncé dans toutes les grandes villes de la Méditerranée orientale, Paul
projette, vers le milieu des années 50, d'évangéliser l'Espagne. Aussi, de Corinthe, écrit-il aux églises de
Rome pour leur demander leur soutien spirituel et financier (chapitre 15).
Romains se présente comme la carte de visite dans laquelle il rend compte de son Évangile de la
justice de Dieu, appel adressé à chacune et à chacun à placer sa confiance en la reconnaissance
inconditionnelle de Dieu.
La justice de Dieu, qui est la juste relation que le Créateur établit avec ses créatures, ne réside ni
dans les religions humaines ni dans la loi juive, qui confondent Dieu avec leurs idéaux de perfection
(chapitres 1 à 3). Elle s'est révélée dans la démesure de la grâce du Père qui a fait don de son Fils pour
manifester l'esprit de gratuité par lequel il nous réconcilie (chapitres 3 à 8). Juifs et païens sont l'objet de
la même miséricorde (chapitres 9 à 11), par laquelle il nous invite à nous laisser renouveler dans
l'universalité de l'amour (chapitres 12 à 15).
François Vouga, Église Nationale Protestante de Genève,
Professeur de N.T., Institut théologique de Béthel
Parole pour Tous, le 26 Avril 2011
1
/
3
100%