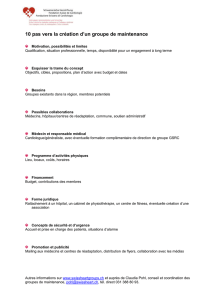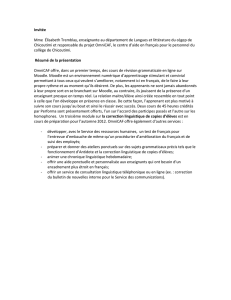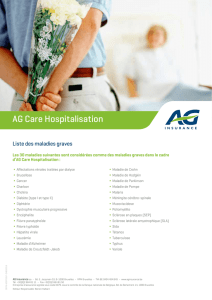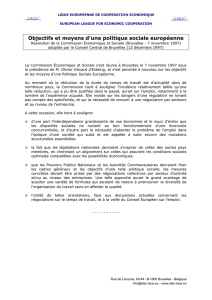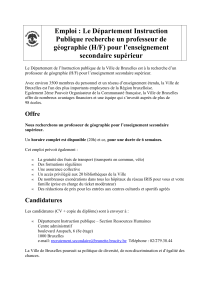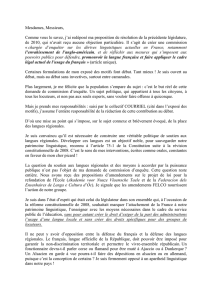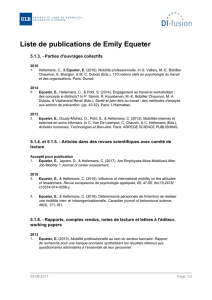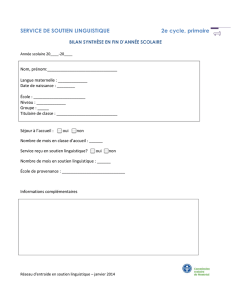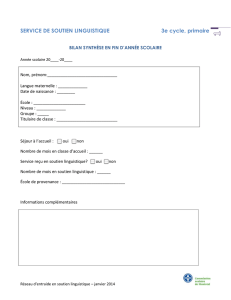Le souvenir le plus ancien qui me demeure de Jacques Pohl

JACQUES POHL
(2 avril 1909 - 18 décembre 1993)
Le souvenir le plus ancien qui me demeure de Jacques Pohl
remonte à une après-midi — un jeudi, je crois — d’octobre 1966,
lorsque, sous un magnifique soleil d’automne, je suis entré à l’Université
libre de Bruxelles pour y commencer mes études de philologie romane.
Nous étions très nombreux dans l’
auditoire
(“salle de cours, de
conférences” en français de Belgique). Parmi ce qui m’apparaissait
comme une foule (et que je perçois aujourd’hui, après la massification
récente de notre public, comme un petit groupe d’heureux élus), je
tentais de m’accrocher à l’un ou l’autre visage vaguement familier, sans
bien savoir ce qui pouvait m’attendre. On ne s’attardait guère, à
l’époque, en préliminaires ou en avertissements. Les bruits de couloir
tenaient lieu de “prises de contact” ou de “réunions d’information”, mais
l’ignorance du moment s’inscrivait alors dans une durée toute différente
de celle que nous connaissons désormais : les premiers examens
n’auraient lieu qu’en juin 1967 — huit mois plus tard ! Soudainement, au
milieu du brouhaha, les premiers rangs se mirent à se lever : le
professeur entrait.
“Vous allez vous lancer dans une merveilleuse aventure” — voilà,
me semble-t-il, la phrase qui vint inaugurer le cours d’“Encyclopédie de la
philologie romane” (ou d’“Exercices philologiques” ?, je ne me rappelle
plus). L’élocution était rapide, très étrange pour un étudiant frais émoulu
de l’
athénée
(“institution officielle d’enseignement secondaire destinée
aux jeunes gens ou mixte, correspondant au lycée en France”). Au beau
milieu des phrases s’interposaient des inspirations brèves et sifflotantes,
comme si l’orateur venait de se précipiter au pupitre après s’être livré à
une course éperdue. “On dirait un amoureux en retard à son rendez-
vous”, le mot fut lancé par l’une de nos camarades ; cette description
fort juste eut quelque succès sur les travées, où elle se répandit
doucement comme une onde affaiblie.
Cependant, l’amoureux parlait, plus vite encore, et de choses
nouvelles, difficiles. Nous nous mettions à découvrir, pêle-mêle, des
linguistes au nom parfois rétif (von Wartburg, Troubetzkoy,…), et qui
semblaient s’obstiner à écrire en allemand (langue redoutée — même si

2
l’on daignait nous signaler quelque traduction), des idiomes curieux
parlés aux quatre coins du globe (le tongouze, cher à mon souvenir), et,
jusqu’en français, notre français, des tours et des constructions
inattendus, négligés par les grammaires que nous avions pu fréquenter
(du genre
Moi j’étais le gendarme et j’essayais de t’attraper
ou
Avoir les
pieds à dix heures dix
). Très vite, l’idée s’est alors insinuée en nous que
la langue, qui élude si bien les interdits et les carcans auxquels nous nous
étions, vaille que vaille, astreints à l’associer — que cette langue,
plastique et fonctionnelle, se prête malgré tout à une étude rigoureuse
où la liberté du jugement critique s’appuie, par nécessité, sur
l’argumentation grammaticale. Le cours d’“Exercices philologiques” fut,
pour moi comme pour deux de mes condisciples (Paul Hirschbühler et
Paul Verluyten), le premier contact avec la linguistique moderne. J’ose
dire qu’il détermina notre vocation.
Les années se sont succédées, depuis, jusqu’à ce jour de
décembre où Jacques Pohl nous a quittés. J’avais appris à connaître, au
fil du temps, le directeur de mémoire, puis de thèse, dont la tolérance
me permit d’aborder, avec quelque insouciance, la grammaire générative
et les études comparées ; le philologue et le linguiste, auteur de
plusieurs ouvrages et d’innombrables articles1, membre du Conseil
International de la Langue Française et du comité de rédaction du
Français Moderne
; l’homme d’honneur et l’homme politique, résistant
civil durant la dernière guerre, et pour un temps sénateur (1968-1971).
Je ne tenterai pas de résumer ici l’œuvre scientifique de Jacques
Pohl. Toute synthèse masquerait l’intérêt d’une démarche sans cesse
alimentée par des observations ponctuelles dont la richesse et la
diversité ne se laissent épuiser par aucune théorie. Jacques Pohl n’était
pas l’homme des programmes et des slogans : les principes abstraits et
1 Citons, entre autres choses, les titres suivants :
Témoignages sur la syntaxe du verbe
dans quelques parlers français de Belgique
, Bruxelles, Palais des Académies, 1962 ;
Symboles et langages
, tome I :
Le symbole, clef de l’humain
; tome II :
La diversité des
langues
, Paris-Bruxelles, SODI, 1968 ;
L’homme et le signifiant
, Paris-Bruxelles, Nathan-
Labor, 1972 ;
Les variétés régionales du français. Études belges (1945-1977)
,
Bruxelles, Éditions de l’Université de Bruxelles, 1979 ; (partim)
Belgicismes. Inventaire
des particularités lexicales du français en Belgique
, Louvain-la-Neuve, Duculot (Conseil
International de la Langue Française), 1994. Voir aussi M. Dominicy et T. Gergely,
“Bibliographie des travaux scientifiques et didactiques de Jacques Pohl”, dans M.
Dominicy et M. Wilmet (éds),
Linguistique romane et linguistique française. Hommages
à Jacques Pohl
, Bruxelles, Éditions de l’Université de Bruxelles, 1980, pp. 9-19.

3
généraux ne le heurtaient guère, il s’y référait même volontiers ; mais
son intérêt, sa passion descriptive le portaient spontanément aux
marges, là où le linguiste, confronté à des phénomènes à la fois évidents
et imprévus, reste plongé dans la perplexité ou dans l’indécision. Qu’il
s’agisse de géographie linguistique ou de typologie, et voici que
surgissent des parlers ou des structures qui passent entre les mailles des
réseaux les plus serrés ; veut-on traiter du verbe, du nom, de
l’adverbe,… et voici que des données très simples, parfois connues
depuis longtemps, remettent en cause nos classifications convenues.
Partout, en somme, règne l’attente déçue, qui ne doit pas conduire au
relativisme ou à la paresse intellectuelle, mais nous fournir, au contraire,
un paradigme de probité scientifique, en même temps que de précieuses
leçons de méthodologie.
Tout cela, je le trouve déjà, pour ma part, dans un manuel très
modeste, que je me suis repris à lire durant ces derniers mois2. Jacques
Pohl n’y développe aucun système nouveau, bien qu’il se meuve sur un
terrain où prolifèreront, un peu plus tard, les “grammaires nouvelles”, si
largement oubliées aujourd’hui, du moins pour la plupart d’entre elles.
Mais, d’emblée (p. 15), le ton surprend :
Ainsi, en schématisant un peu, on a l’impression que la marche de
l’humanité est marquée par des couples d’inventions, l’une du couple étant de
technique mentale, l’autre de technique du feu, toutes les deux, vues de haut,
pouvant être tenues pour contemporaines : le feu et le langage parlé ; le métal
et le langage écrit ; le verre et l’alphabet ; la poudre à canon et l’impression sur
papier ; la fission de l’atome et les « cerveaux électroniques ».
Cette synthèse nous situe loin des introductions compassées, où la
grammaire n’est saisie qu’en elle-même, ou par rapport à la littérature,
ou encore dans sa relation à une “pensée” intemporelle et mal définie. La
fonctionnalité du langage, son caractère profondément social, son rôle
essentiel dans la progression de l’humanité, tout cela est enfermé à
l’intérieur d’un parallélisme simple, mais non réducteur, qui apprend à
l’élève que ce dont il sera question ne peut être pensé sans références à
l’histoire, à la science, et aux techniques.
2
Forme et Pensée. Esquisse d’une Grammaire française fonctionnelle
, Paris et Namur,
Wesmael-Charlier, 1958.

4
Une telle démarche permet d’aborder la norme linguistique avec
plus de distance, et non sans quelque esprit provocateur. Ainsi le
premier exemple traité (p. 24) est une phrase qualifiée de
“quelconque” : “
« En voiture, on plus confiance quand c’est soi qui
conduit que quand c’est un autre »
”, alors qu’il s’agirait là, pour un
grammairien tatillon, d’un énoncé au moins douteux — et l’auteur le sait
bien, puisqu’il ajoute, en note : “les phrases encadrées de ces guillemets
[à savoir ‘«’ et ‘»’ — M.D.] ont été réellement prononcées, en général par
des Parisiens de milieux cultivés”.
L’ouvrage tout entier témoigne de cette fraîcheur d’esprit et de
cette ouverture, si rares alors dans le domaine.
Sur le plan théorique, j’épinglerai, entre autres choses, quelques
paragraphes très heureux sur la redondance grammaticale (pp. 33-34),
ou encore un passage remarquable (p. 35) où l’auteur parvient à faire
saisir en un instant l’importance des fonctions grammaticales :
Lisez les mots suivants, classés par ordre alphabétique :
bateau, brouillard, capitaine, diriger, port.
Le sens même des mots vous suggère des rapports d’idées : on devine que
c’est le capitaine qui fait l’action de diriger ; que c’est le navire qui en est
l’objet, que cette action se fait dans le brouillard, et que son but est le port.
Mêlez les mots comme vous voudrez, ils vous suggéreront les mêmes idées.
En revanche, vous seriez beaucoup plus embarrassé si vous deviez
interpréter la suite de mots ci-dessous :
avocat, médecin, notaire, parler.
Est-ce le notaire qui parle de l’avocat au médecin, ou le médecin qui
parle de l’avocat au notaire, ou bien…?
Mais dès que les rapports entre les mots sont fixés de façon nette, la
phrase devient précise ; par exemple :
Le médecin et le notaire parlent de l’avocat.
À travers ce petit raisonnement sans prétention, le lecteur acquiert sur
le vif deux intuitions fondamentales concernant le langage naturel. Il
comprend d’abord que, pour une part, la forme de nos messages se
trouve parfois pré-construite dans des réseaux conceptuels étrangers à
la grammaire (qu’on songe aux nombreuses recherches menées sur ce
thème par les spécialistes de l’intelligence artificielle et de la cognition).
Mais il voit également que la structure grammaticale possède une
autonomie suffisante pour suppléer, dans de nombreux cas, à
l’indétermination conceptuelle.

5
Forme et Pensée
abonde aussi en notations de détail apparemment
anodines, mais qui débusquent, très fréquemment, un phénomène mal
connu, ou non thématisé. Mon penchant pour la poésie me fait choisir, en
la circonstance, cette note de la p. 47 :
Dans un poème célèbre, Baudelaire décrit l’albatros sur le pont d’un
navire en l’appelant : « l’infirme qui volait ». On pourrait prétendre qu’ici la
beauté de l’image vient justement de ce que le verbe n’actualise pas le sujet :
l’albatros, précisément parce qu’il est infirme, ne vole pas ; l’imparfait se réfère
à un moment où il n’était pas infirme. Il faut reconnaître d’ailleurs que sans
l’interposition de
qui
, l’union du verbe et du sujet deviendrait impossible :
« l’infirme volait » ; mais on admettrait : « Cet infirme avait volé ».
Dans un article encore inachevé, je tenterai d’établir que l’explication
proposée par Jacques Pohl demeure insuffisante3. Mais l’essentiel ne
réside pas là — qui d’ailleurs oserait se targuer d’avoir dit le dernier mot
sur le moindre fait empirique ? Ce qui me paraît admirable, en
l’occurrence, c’est le flair du grammairien qui repère l’attestation
(
L’autre mime, en boitant, l’infirme qui volait !
), aperçoit ensuite le rôle
crucial de la structure à proposition relative, et nous invite, par là même,
à nous interroger sur des séquences formellement similaires, et
cependant inacceptables : ??
Le médecin soigne le malade qui était en
bonne santé
, ??
Marie console l’élève qui était joyeux
(à moins de
restituer un discours indirect : “le malade qui se disait en bonne santé”,
“l’élève qui se disait joyeux”).
Cette démarche qui part de notations à l’apparence anecdotique,
et nous conduit, sans rien laisser paraître, vers des questions
essentielles, tout lecteur pourra la voir à l’œuvre dans les publications de
Jacques Pohl. Il y recueillera une moisson peu ordinaire d’observations et
de réflexions, et il entendra parfois, au détour d’une phrase inattendue
ou paradoxale, la voix de ce professeur qui demeurera, pour tous ses
étudiants, comme l’incarnation même d’une discipline difficile mais
fascinante — la linguistique.
3 Voir maintenant “Pour une étude linguistique des variantes : l’exemple des
Fleurs du
Mal
”, dans F.-R. Hausmann , H. Stammerjohann et H.-I. Radatz (éds),
Haben sich
Sprach- und Literaturwissenschaft noch etwas zu sagen ?
, Bonn, Romanistischer Verlag
(
Abhandlungen zur Sprache und Literatur
, 100), 1998, pp. 69-93.
1
/
5
100%