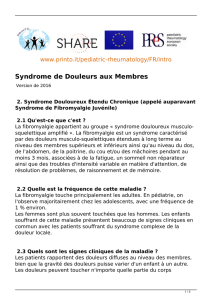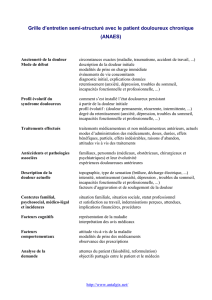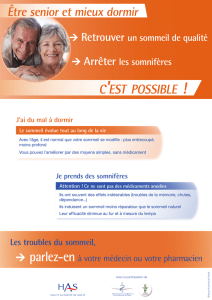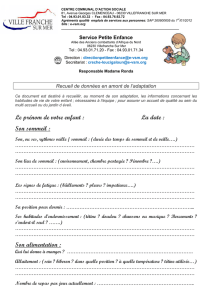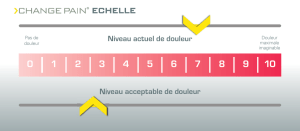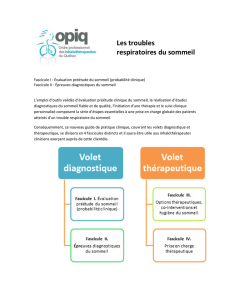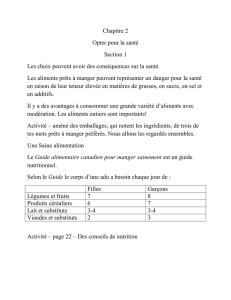Merci de cliquez ici pour télécharger les articles

Fibromyalgie : physiopathologie et accompagnement
thérapeutique
[26-190-A-10] - Doi : 10.1016/S1283-0887(14)60207-3
M. Guinot a b c , S. Launois b c, A. Favre-Juvin a b c : Praticien hospitalier, C. Maindet-
Dominici a d : Praticien hospitalier
Voir les affiliationsMasquer les affiliations
a Centre de référence des maladies neuromusculaires Rhône-Alpes, Centre hospitalier régional universitaire, CS 10217,
38043 Grenoble cedex 9, France
b Laboratoire hypoxie et physiopathologie, Inserm, U1042, 38000 Grenoble, France
c Clinique physiologie, sommeil, exercice, Pôle thorax et vaisseaux, Centre hospitalier régional universitaire, CS 10217,
38043 Grenoble cedex 9, France
d Pôle anesthésie et réanimation, Centre de la douleur, Centre hospitalier régional universitaire, CS 10217, 38043
Grenoble cedex 9, France
Auteur correspondant.
Introduction et problématique générale
La fibromyalgie (FM) est un syndrome douloureux chronique fréquent, touchant essentiellement
la femme. Elle a pour caractéristique principale une symptomatologie fonctionnelle riche
contrastant avec un examen clinique peu contributif [1]. Elle entraîne une souffrance et une
invalidité souvent sévères [2]. L'insuffisance de la compréhension de ses mécanismes
physiopathologiques entretient de nombreuses controverses sur la nature de ces symptômes et
sur leur traitement [3]. Pour éviter l'errance de ces patients, il est nécessaire de reconnaître leur
souffrance et de les aider dans leur parcours de soins. De plus, la symptomatologie douloureuse
s'inscrit souvent dans un contexte de comorbidités psychiatriques [4], neurologiques (troubles
du sommeil) [5] et d'obésité [6] qui contribuent à complexifier la démarche diagnostique et
thérapeutique. Cependant, leur prise en charge est nécessaire car elles jouent
vraisemblablement un rôle dans l'entretien ou l'aggravation des symptômes. Ainsi, il faut d'abord
relier les plaintes douloureuses à la FM [7] en s'aidant d'investigations complémentaires au titre
du diagnostic différentiel. Puis, il faut apprécier le retentissement de la FM sur la qualité de vie
et les capacités fonctionnelles des patients. Enfin, il faut évaluer la sévérité des comorbidités
neuropsychiatriques, et proposer un accompagnement thérapeutique pour améliorer la qualité
de vie et le sentiment d'autoefficacité de ces patients.
Description
Caractéristiques épidémiologiques
La FM est la pathologie douloureuse chronique diffuse la plus fréquente dans toutes les régions
et cultures du monde [1, 4]. Elle concerne environ 2 à 4 % de la population générale et 14 %
des patients consultant en rhumatologie [8], avec une prédominance féminine d'au moins
80 % [1, 4, 9, 10]. Cette prédominance a des explications multifactorielles, relevant à la fois
d'expériences douloureuses différentes, d'origine psychologique et socioculturelle, mais aussi de
mécanismes d'amplification et d'inhibition neurologiques de la douleur ayant un support
génétique et hormonal [9]. La majorité des diagnostics est faite avant 60 ans, avec un pic entre
40 et 50 ans. Il existe également des formes juvéniles évoluant fréquemment dans le cadre d'un
syndrome de fatigue chronique [11] pouvant compromettre le projet scolaire de ces enfants ou
adolescents.
Caractéristiques cliniques
La FM est caractérisée par l'association quasi constante de trois symptômes : des douleurs, une
fatigue générale et des troubles du sommeil [4, 7, 12]. À cette triade viennent s'ajouter
fréquemment des troubles cognitifs et de manière plus inconstante des plaintes dans la sphère
oto-rhino-laryngologique, digestive ou urogynécologique [3, 4, 12]. De fait, les patients
fibromyalgiques décrivent une association de symptômes multiples qui ont amené à reconsidérer
les critères diagnostiques de la FM [1, 12, 13, 14].
Douleurs

La FM se présente principalement sous la forme d'un tableau douloureux chronique (évoluant
depuis plus de trois mois) et diffus [4]. Le début peut être progressif ou brutal, dans les suites
directes d'un traumatisme (psychologique ou physique), ou d'une pathologie douloureuse
chronique préexistante. Les douleurs, bien que permanentes, fluctuent dans le temps et l'espace
corporel avec une grande variabilité intra- et interindividuelle. Elles peuvent avoir une
présentation articulaire, musculaire, tendineuse ou neurologique, être isolées ou combinées. Ces
douleurs ont généralement une recrudescence nocturne et matinale, avec une sensation de
raideur qui peut mimer un rhumatisme inflammatoire chronique.
L'effort musculaire aggrave en général les douleurs. Souvent, elles se prolongent après un effort,
pouvant persister plusieurs jours, l'ensemble contribuant à limiter l'activité physique et à
favoriser les comportements sédentaires de ces patients [6].
Par contraste, l'examen neurologique et ostéoarticulaire de ces patients est le plus souvent
normal en dehors de la mise en évidence de points douloureux. Celle-ci permet d'orienter le
diagnostic car elle objective une hyperalgésie et/ou une allodynie qui reflètent l'origine
neurologique centrale de la douleur [7, 15, 16, 17] (Figure 1). Certains déficits neurologiques ont
été décrits [18], posant le problème du diagnostic différentiel mais aussi celui des relations avec
les pathologies douloureuses locales préexistant à la FM [13, 14] et leur rôle dans la
chronicisation des douleurs [15].
Fatigue
Elle fait partie des symptômes cardinaux de la FM et est présente dans plus de 90 % des cas. Il
s'agit d'une fatigue généralisée aussi invalidante que les douleurs. Elle limite les activités,
notamment l'activité physique. Elle est présente dès le réveil pour s'améliorer parfois dans la
journée et réapparaître le soir. D'une façon générale, elle est corrélée à la sévérité de la FM,
entraînant parfois un véritable épuisement des patients. Comme la douleur, elle est majorée par
les stress (psychologiques, émotionnels, physiques, traumatiques, etc.). Ce symptôme est
partagé avec le syndrome de fatigue chronique, ces deux pathologies relevant probablement de
mécanismes physiopathologiques communs [11]. Cette fatigue n'est pas associée à une
altération de l'état général, de la fièvre ou un amaigrissement.
Troubles du sommeil
Ils sont quasi constants dans la FM, caractérisés par un sommeil non récupérateur [5, 12], avec
parfois un retentissement sur la vigilance diurne. Les patients FM décrivent plus fréquemment
des difficultés à l'endormissement et des réveils nocturnes [5, 19], entraînant une fragmentation
du sommeil parfois associée à un syndrome des jambes sans repos ou un syndrome d'apnées
obstructives du sommeil [5]. Il existe vraisemblablement une interaction bidirectionnelle entre
les troubles du sommeil et la douleur [5, 19]. En effet, une étude observationnelle récente d'une
durée moyenne de 11 ans [20] a montré que les femmes qui avaient initialement des troubles
du sommeil avaient un risque relatif de 3,4 de développer une FM. Ce risque était corrélé
positivement à la sévérité des troubles du sommeil. D'autre part, une étude expérimentale
réalisée chez des sujets sains a montré qu'une privation partielle de sommeil entraînait une
diminution du seuil douloureux [21]. Ces travaux suggèrent que les troubles du sommeil sont
impliqués dans le développement à long terme des douleurs chroniques, ainsi que dans leur
aggravation.
Symptômes diffus
Les patients souffrant de FM se plaignent généralement de troubles touchant la sphère cognitive,
sensorielle, mais aussi de céphalées de tension, et de douleurs digestives et urogénitales
(Tableau 1) [3, 12, 22]. Parmi ceux-ci, les troubles cognitifs (essentiellement difficultés de
concentration, de mémoire) sont fréquemment rapportés par les patients souffrant de FM [7],
parfois dénommés fibrofog [22]. Ces troubles sont parmi les plaintes les plus invalidantes après
la douleur, la fatigue, les troubles du sommeil, et leur fréquence serait trois fois plus élevée chez
les patients souffrant de FM que dans les autres pathologies rhumatismales [23]. De plus, leur
intensité est corrélée à la sévérité de la fatigue et de la douleur [23]. Ils sont souvent
accompagnés de plaintes sensorielles, notamment auditives, qui concernent les bruits de la vie
quotidienne [24]. Cette « hyperalgésie » auditive est corrélée à l'hyperalgésie à la pression chez
ces patients [24], suggérant qu'il existe une altération globale du traitement des informations
sensorielles chez ces patients [3, 24].

Retentissement fonctionnel de la fibromyalgie
Les patients FM ont souvent une altération sévère de la qualité de vie et des capacités de travail,
jugée plus importante que celle d'autres patients atteints de pathologies rhumatismales
chroniques comme la polyarthrite rhumatoïde ou l'arthrose [2]. Ainsi, la FM constitue un véritable
handicap dans les formes les plus sévères. La douleur, la fatigue, les troubles du sommeil et la
fatigabilité musculaire, mais aussi les troubles cognitifs, contribuent non seulement à limiter les
activités de la vie quotidienne et professionnelles, mais aussi à l'isolement social de ces
patients [23, 25].
La difficulté à réaliser des efforts musculaires est quasi constante. En effet, de nombreux patients
rapportent que porter des courses (50 à 90 %), monter des escaliers (40 à 50 %), marcher (11
à 29 %), courir (60 à 74 %) et travailler les bras levés (68 à 99 %) sont difficiles ou impossibles
à réaliser [26]. Au plan physiologique, la diminution de la tolérance à l'effort est variable selon
les études, d'une part en raison de l'hétérogénéité de la sévérité du retentissement, et d'autre
part parce que peu de travaux ont mesuré directement les capacités aérobies par mesure des
échanges gazeux. Dans notre expérience, cette intolérance à l'effort est fréquente. Il est possible
que la sévérité des formes cliniques que nous observons soit liée au fait que notre recrutement
hospitalier sélectionne les formes les plus sévères [27]. L'origine de cette intolérance semble
complexe. Elle semble principalement liée à un déconditionnement cardiocirculatoire et
musculaire chez les patients qui ont une activité physique réduite souvent associée à une prise
de poids [27]. Il est possible que la douleur lors des contractions musculaires modifie les réponses
cardiocirculatoires, respiratoires et métaboliques induites par le système nerveux central [27,
28].
Aspects physiopathologiques
Concept de « sensibilisation » centrale
Les mécanismes physiopathologiques de la FM restent encore mal connus. Cependant, la
diffusion des symptômes douloureux, leur association à des troubles cognitifs, des troubles
neurovégétatifs et/ou du sommeil, évoquent un dysfonctionnement diffus du système nerveux
central, reflétant une altération vraisemblable de la régulation des voies de la douleur, du
sommeil, de la cognition, mais aussi du système nerveux autonome et des voies
neuroendocriniennes impliquées dans la réponse au stress [10, 29, 30, 31].
Par ailleurs, la FM partage de nombreux points communs avec d'autres syndromes auxquels elle
est fréquemment associée (côlon irritable, vessie instable, syndrome de fatigue chronique,
maladies auto-immunes, etc.), regroupés sous la terminologie de syndromes par « sensibilisation
centrale » [3, 10, 16]. Ces termes peuvent prêter à confusion dans la mesure où ils ont été
décrits initialement comme des phénomènes d'amplification douloureuse secondaires à des
lésions médullaires ou cérébrales [16, 32]. Dans la suite de cet article, le terme de
« sensibilisation centrale » est utilisé en référence aux modifications de la perception de
phénomènes sensoriels (douleurs) dues à des phénomènes de neuroplasticité [16]. La
compréhension de ces mécanismes a une implication pratique dans l'approche diagnostique et
thérapeutique, car elle permet de repérer les caractéristiques cliniques qui doivent faire évoquer
des douleurs par sensibilisation centrale et d'expliquer l'absence d'efficacité des thérapeutiques
habituelles [16].
Point fort
Éléments cliniques en faveur d'une origine centrale des douleurs chez un patient
souffrant de pathologie articulaire [16]
• Douleurs situées dans différentes régions corporelles.
• Long passé douloureux chronique.
• Plaintes multiples associées (fatigue, troubles cognitifs, troubles du sommeil et de
l'humeur).
• « Hypersensibilité » sensorielle (auditive, visuelle, olfactive ou viscérale).
• Survenant chez une femme.
• Anamnèse familiale de tableau douloureux chronique.
• Douleurs déclenchées ou aggravées par les stresseurs.

• Examen clinique le plus souvent normal en dehors de sensibilité anormale à la douleur
(extension de zone douloureuse, allodynie).
Principaux mécanismes de sensibilisation centrale de la douleur
Les caractéristiques neurophysiologiques des douleurs chroniques de la FM consistent en une
hypersensibilité anormale à la douleur en réponse à des stimulations nociceptives ou mécaniques
(Figure 1) [15, 16, 31, 33, 34]. Les travaux de recherche animale et humaine suggèrent qu'il
existe une réorganisation fonctionnelle et structurale des voies de conduction et de contrôle de
la douleur (Figure 2), des récepteurs nociceptifs (fibres c ou Aδ) et tactiles (Aβ) jusqu'aux centres
sous-corticaux et corticaux d'intégration (revue in [17, 33, 34]). Ces mécanismes de
sensibilisation centrale sont liés à des modifications adaptatives survenant aux niveaux
moléculaire (récepteurs), synaptique, cellulaire et des réseaux neuronaux générant des
phénomènes d'amplification du signal nociceptif, mais aussi de diminution des mécanismes
inhibiteurs [15, 17, 33].
Chez l'homme, il est possible de reproduire expérimentalement une allodynie et une
hyperesthésie après une stimulation nociceptive répétée. L'hyperesthésie est réduite (mais non
l'allodynie) par l'administration d'un antagoniste des récepteurs N-méthyl-D aspartate [35]. Cela
suggère le rôle de ces récepteurs dans le développement de l'hypersesthésie au niveau de la
transmission homosynaptique de la corne dorsale médullaire [15, 17, 33], l'allodynie relevant
d'autres mécanismes [17, 34, 35, 36]. Il est vraisemblable que d'autres structures soient
impliquées dans la genèse et l'entretien des phénomènes de neuroplasticité médullaire, en
particulier les récepteurs aux neurokinines 1 (substance P) et les cellules gliales responsables de
la sécrétion de facteurs neurotrophiques et de cytokines pro-inflammatoires [17, 31, 33, 35].
Concernant les structures corticales, des études en imagerie par résonance magnétique (IRM)
fonctionnelle de patients FM [37] ont montré une activation anormale (cortex somatosensoriel,
thalamus, cortex cingulaire antérieur, insula) en réponse à un stimulus mécanique. Enfin, une
diminution du contrôle des voies descendantes de la douleur a été mise évidence chez des
patients FM [38].
Les mécanismes qui conduisent à la chronicisation des douleurs restent mal connus, notamment
dans les relations de temporalité entre la lésion nociceptive périphérique et la réorganisation des
structures corticales [15]. De plus, dans la FM, le stimulus nociceptif périphérique est
inconstamment présent alors qu'un traumatisme psychologique est parfois le seul facteur
déclenchant des douleurs [10, 35, 39].
Fibromyalgie, douleurs chroniques et modèle biopsychosocial
La compréhension actuelle de la physiopathologie de la FM relève du modèle « biopsychosocial »,
considérant l'expérience douloureuse comme l'interaction complexe entre des phénomènes
biologiques, psychologiques et des facteurs socioculturels [9, 40]. Ainsi, la FM pourrait
s'expliquer par des modifications neurobiologiques survenant sur une vulnérabilité innée ou
acquise (facteurs génétiques, événements traumatisants, conditions de vie), déclenchée par des
événements traumatiques et aggravée ou entretenue par des lésions douloureuses, certains
modes cognitifs et/ou comportements [10] (Figure 3).
Ainsi, le déterminisme génétique semble important puisque le risque de développer une FM est
six à huit fois supérieur chez les parents au premier degré de patients FM. Les mutations
intéressant les récepteurs β adrénergiques ou les enzymes contrôlant le métabolisme des
catécholamines sembleraient en cause [9, 41].
Parallèlement, le rôle des événements stressants (physiques, émotionnels), en particulier
lorsqu'ils surviennent durant l'enfance, est fréquemment évoqué dans le développement de la
FM et des pathologies psychiatriques (syndrome de stress post-traumatique, dépression) avec
lesquelles la FM est comorbide [4, 10, 42]. Ces événements modifieraient la plasticité cérébrale
à long terme, en particulier par l'intermédiaire de l'axe corticotrope [43]. En effet, cet axe
hormonal est impliqué dans la réponse au stress, mais également dans la régulation de la
plasticité neuronale dans les régions corticales responsables des adaptations comportementales,
émotionnelles et mnésiques (cortex préfrontal, amygdales, hippocampe) qui sont riches en
récepteurs minéralo- et glucocorticoïdes [43]. Des études ont effectivement montré une
altération de l'axe corticotrope au repos et en réponse à un stress physique, psychosocial [44]
ou pharmacologique chez les patients ayant subi des violences durant l'enfance [45] et les

patients FM [29, 46]. De plus, des études en IRM ont montré qu'il existait un amincissement de
la région du cortex cérébral impliquée spécifiquement dans les processus perceptifs ou adaptatifs
liés à l'événement traumatique subi [47]. Par exemple, il a été mis en évidence une diminution
de l'épaisseur du cortex sensitivomoteur (projection génitale) chez des femmes ayant été
abusées sexuellement, alors que d'autres régions corticales étaient modifiées pour d'autres
traumatismes [47].
Un événement initial (déclenchant ou précipitant) est déclaré par seulement 23 à 66 % des
patients FM [10]. De nombreux événements ont été décrits, tels que des traumatismes physiques
d'origine accidentelle [48], des infections virales ou bactériennes, des maladies auto-immunes
ou d'autres pathologies douloureuses chroniques (revue in [10, 39]).
Concernant les facteurs d'entretien ou aggravants, l'association à une pathologie douloureuse
chronique (ostéoarticulaire, digestive ou neurologique) joue vraisemblablement un rôle
important dans la genèse de mécanismes de passage à la chronicité via des phénomènes de
sensibilisation centrale [16, 17, 33]. De plus, certains comportements et modes cognitifs des
patients FM contribuent probablement au maintien ou à l'aggravation des symptômes
douloureux [10]. Parmi ceux-ci, l'hypervigilance, la faible acceptation de la maladie et les
comportements d'évitement de la douleur ont été individualisés, et constituent un risque de
développement de détresse psychologique [49]. Le rôle du « catastrophisme », qui peut être
défini comme un processus cognitif et émotionnel qui amplifie les sensations de détresse liées à
la perception douloureuse, mérite d'être individualisé dans les processus d'entretien de la FM [40,
50]. Ainsi, plusieurs études en IRM fonctionnelle ont montré que les sujets sains ou douloureux
chroniques ayant des niveaux élevés de « catastrophisme » avaient une augmentation de
l'activation neuronale (notamment cortex préfrontal, insula, amygdale) en réponse à un stimulus
nociceptif [40, 51, 52]. Ces régions cérébrales sont impliquées dans les réponses émotionnelles
et motivationnelles face à l'expérience douloureuse [40, 53].
Aspects diagnostiques
Reconnaître la fibromyalgie
Le diagnostic de FM est souvent retardé par rapport au début des symptômes (cinq ans en
moyenne), voire non effectué, dans 75 % des cas [7]. Ces manquements contribuent à multiplier
les examens complémentaires, entretenir l'errance « médicale » des patients et proposer un
accompagnement thérapeutique inadapté. Le diagnostic positif de FM repose sur l'anamnèse et
l'examen clinique (cf. supra) (Figure 4). Les examens clinique et biologiques sont le plus souvent
normaux, contrastant avec la richesse des symptômes fonctionnels [4, 7]. Il est possible de
compléter les investigations en utilisant les critères diagnostiques de FM de l'American College
of Rheumatology qui ont été révisés (Tableau 1) [12, 13, 14]. Ils permettent de classer
correctement 90 % des patients FM alors que 25 % des patients FM ne l'étaient pas avec les
critères de 1990 qui s'appuyaient uniquement sur la recherche de points douloureux [1]. Il est
également possible d'utiliser un autoquestionnaire court (Fibromyalgia Rapid Screening
Tool) [54], qui permet de classer correctement 88 % des patients ayant un syndrome douloureux
chronique avec une sensibilité de 90,5 % et une spécificité de 86,5 %.
Diagnostics différentiels et comorbidités
Bien que le diagnostic de FM puisse être posé sur l'anamnèse, il n'est pas toujours facile
d'éliminer des maladies rhumatismales [7, 8, 16] ou neurologiques devant des douleurs
articulaires, tendineuses, mais aussi musculaires ou neuropathiques [18, 55]. La FM partage des
symptômes communs avec ces pathologies et peut leur être associée de façon comorbide (FM
secondaire) [4, 10, 13].
Douleurs d'origine centrale et maladies rhumatismales
La fatigue générale et le dérouillage matinal, les troubles du sommeil, sont également présents
dans ces pathologies, suggérant que des mécanismes de sensibilisation centrale sont
communs [3, 10, 31, 34]. Le terme de multimorbidité serait plus approprié dans la mesure où il
permet de se focaliser sur le patient plutôt que sur les pathologies qu'il présente [56]. En effet,
la FM est associée dans 20 à 50 % à un rhumatisme inflammatoire chronique ou à une maladie
auto-immune [10]. Une étude prospective de 2012 a montré une incidence initiale de 6 % de
diagnostic de FM chez des patients souffrant également de polyarthrite rhumatoïde, avec une
 6
6
 7
7
 8
8
 9
9
 10
10
1
/
10
100%