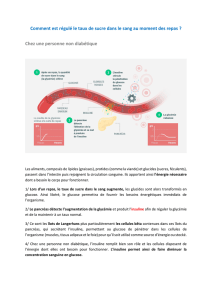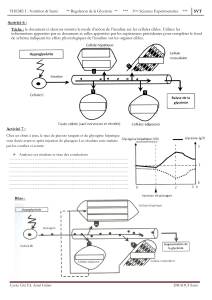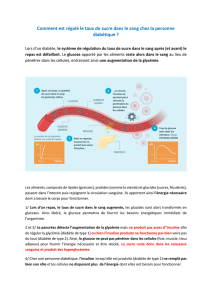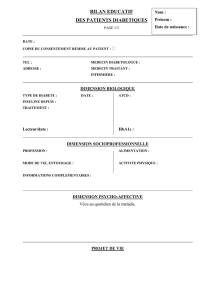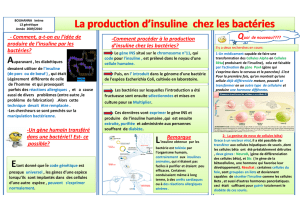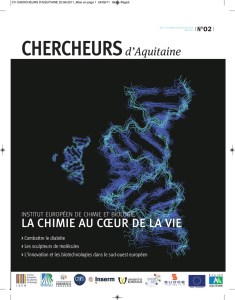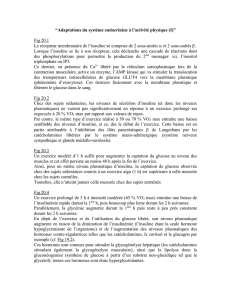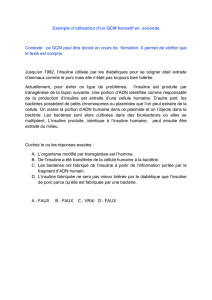Insulinothérapie par les cellules bêta

28
entre le taux de glucose dans le
sang et le taux d'injection d'insuline.
Même si de tels dispositifs étaient
disponibles sur le marché, ils ne
reproduiraient pas encore fidèlement
tous les aspects de la sécrétion
d'insuline physiologique par les
cellules bêta. En outre, ils seraient
susceptibles d'être coûteux et
nécessiteraient une surveillance très
rapprochée par l'utilisateur et le
médecin. Je prédis donc que ce genre
de dispositifs sera exclusivement
utilisé par des patients bien formés
et aisés, vivant dans des régions du
monde bénéficiant d'une aide
médicale sophistiquée. Si mes
affirmations sont exactes, pourquoi
ne pas utiliser des cellules plutôt que
des dispositifs pour remplacer les
cellules bêta manquantes ?
A l'heure actuelle, nous pouvons en
effet y arriver avec un certain succès
grâce à la transplantation d'îlots.
Cependant, nous ne disposerons
jamais d'îlots humains en suffisance
pour satisfaire les besoins de tous les
individus atteints de diabète dans le
monde. En outre, le succès de la
transplantation d'îlots dépend
encore actuellement de
l'immunosuppression qui, même
si elle a été considérablement
Orientations futures
Insulinothérapie par les
cellules bêta
`Philippe Halban
>>
La pompe à insuline présente des avantages pour
certaines personnes atteintes de diabète de type 1, les
libérant ainsi de la corvée des injections quotidiennes.
Cependant, le coût élevé de la pompe et la nécessité
d'une surveillance minutieuse limitera son utilisation
aux patients aisés qui peuvent compter sur une
assistance médicale sophistiquée.
Cet article suggère le recours à la "thérapie
bêtacellulaire" pour créer des répliques des cellules
productrices d'insuline. Il s'attarde sur le mode de
fonctionnement de ces cellules et explore certaines
contraintes à prendre en compte dans l'utilisation des
répliques de cellules secrétrices d'insuline
génétiquement modifiées pour le traitement du diabète
de type 1.
Insulinothérapie externe vs
biologie moléculaire
Le diabète de type 1 est le résultat
d'une destruction auto-immune des
cellules productrices de l'insuline
(cellules bêta) qui rend les
personnes atteintes de cette forme
de diabète dépendantes d'une
insulinothérapie externe pour
survivre. Cependant, une injection
sous-cutanée d'insuline ne reproduit
pas précisément la façon dont
l'hormone est sécrétée par la
cellule-bêta. La pompe à insuline
présente quelques avantages pour
certains individus. Toutefois il
n'existe pas encore à ce jour de
moyen de contrôle continu et non-
invasif de la glycémie (sucre)
permettant de fermer la boucle
Décembre 2002 Volume 47 Numéro 4

()
29
améliorée, pose encore des problèmes
majeurs (qui excluent l'utilisation
quotidienne chez les enfants).
Il est certainement temps aujourd'hui de
recourir à la biologie moléculaire
moderne pour produire un substitut ou
cellule bêta de remplacement pour la
thérapie cellulaire. On peut appeler cette
approche la "thérapie bêtacellulaire",
même si les cellules ne sont pas
d'authentiques cellules bêta, ou "thérapie
génique" car les cellules utilisées sont
génétiquement modifiées in vitro avant
d'être implantées.
Dans un article récent du Diabetes Voice,
Jim Shaw avait passé en revue quelques
méthodes envisagées pour créer de telles
répliques de cellules bêta (1). Dans cet
article, je me concentrerai plus
spécifiquement sur l'explication du mode
de fonctionnement des cellules bêta et
sur certaines restrictions à prendre en
considération si la thérapie à base de
répliques de cellules sécrétrices d'insuline
génétiquement modifiées devait un jour
soigner le diabète de type 1. Bien que
nous devrions tous être conscients des
obstacles immunologiques à la "thérapie
bêtacellulaire" du diabète comme le rejet
de la greffe, je n'en parlerai pas dans cet
article.
Comment fonctionne une
cellule bêta normale ?
La cellule bêta fabrique (processus
appelé la biosynthèse) et sécrète
l'insuline par le biais d'une série
d'événements intracellullaires
complexes, parfaitement synchronisés et
bien régulés (2). Les principes
fondamentaux sont faciles à décrire
mais assez difficiles à imiter. Le gène de
l'insuline s'exprime uniquement de façon
significative dans les cellules bêta.
Comme n'importe quel gène, l'ADN
dont il est composé est d'abord
transcrit dans une réplication appelée
'ARNm' (messager). Cet ARN messager
donne ensuite des ordres à l'usine
cellulaire qui produit un précurseur de
l'insuline, appelé de façon assez
appropriée la 'proinsuline'. Cette
proinsuline est ensuite empaquetée dans
des granules, des petites capsules de
stockage à l'intérieur de la cellule bêta.
A l'intérieur de ces capsules, la
proinsuline est transformée en insuline,
la forme active de l'hormone.
Les cellules bêta
constituent la clé
qui nous permettra
d'obtenir un système
parfait "en boucle
fermée" pour réguler
le taux de glucose.
Chaque cellule dispose d'environ
10 000 granules, et chaque granule
renferme quelques 200 000 molécules
d'insuline. L'insuline est stockée dans ces
granules et est uniquement libérée dans
le sang en réponse à une augmentation
du taux de glucose après un repas.
L'insuline agit sur le foie, les muscles et
les cellules graisseuses en stimulant le
métabolisme du glucose dans le corps, en
empêchant le foie d'en produire plus et
d'en libérer dans le sang. On observe par
conséquent une chute rapide du taux de
glucose dans le sang. A son tour, cette
chute signale aux cellules bêta d'arrêter
de libérer de l'insuline. Vous avez là un
parfait exemple de système en "boucle
fermée".
Stimulation au glucose de la
cellule bêta et son évolution
Comme mentionné ci-dessus, le glucose
stimule la sécrétion d'insuline. Cependant,
son effet sur la cellule bêta ne s'arrête pas
là. Comme démontré à la Figure 1, le
glucose stimule aussi la production de
l'ARN messager à partir de l'ADN du
gène de l'insuline (un processus appelé la
"transcription") (ADN vers ARNm, voir
Figure 1) ainsi que la traduction du
message de cet ARNm en proinsuline
protéique.
Chacune des étapes expliquées dans la
Figure 1 prend du temps. Il en résulte
que plus l'étape de stimulation initiale
est éloignée de l'étape de sécrétion de
l'insuline dans le sang, plus il faudra de
temps pour que la stimulation entraîne
l'augmentation du taux d'insuline
Figure 1:Durée estimée depuis la stimulation jusqu'à la première apparition
d'insuline dans le sang lors des diverses étapes de la production d'insuline. ADN,
la molécule chimique du gène ; ARNm, le messager chimique du gène vers l'usine
protéinique de la cellule ; cellule ß, la cellule qui sécrète normalement l'insuline ;
cellule X, la cellule régulée uniquement par stimulation du gène pour produire le
messager.
>>
→→→
Décembre 2002 Volume 47 Numéro 4
Orientations futures

()
30
dans le sang. Donc, alors qu'il est vrai que
le glucose stimule la formation de
l'ARNm de l'insuline, il faut au moins une
heure à partir du début de ce type de
stimulation pour que l'on puisse voir la
sécrétion de l'insuline augmenter. Ceci est
en contradiction avec la stimulation
directe de la sécrétion exercée par le
glucose via la décharge des granules de
stockage dont on peut observer l'effet en
une minute ou deux.
C'est le granule !
Le granule est le cœur et l'âme de la
cellule bêta. Comme nous venons de le
mentionner, il permet le stockage de
l'insuline et la libération en quantité
adéquate de l'insuline en réponse à
l'augmentation de la glycémie. En réalité,
la cellule bêta est encore plus
sophistiquée puisque la sécrétion
d'insuline peut être stimulée par de
nombreuses autres molécules en plus du
glucose. Celles-ci comprennent les acides
aminés (éléments structuraux des
protéines), les acides gras et certaines
autres hormones stimulantes produites
dans l'intestin (neuropeptides).
Mais dans tous les cas, la libération
d'insuline se fait à partir des granules.
C'est le point de départ du problème.
Nous pouvons facilement modifier toute
cellule (non bêta) afin qu'elle fabrique de
l'insuline en ayant recours aux techniques
modernes de la biologie moléculaire. En
effet, ceci a été réalisé pour la première
fois il y a 20 ans dans des cellules
pituitaires (3). Mais le fait de forcer les
cellules à libérer de l'insuline rapidement
en réponse au taux de glucose (ce qui
n'était pas le cas pour ces cellules
pituitaires) est une toute autre histoire.
Ecoulement contrôlé de
l'insuline
La sécrétion de l'insuline par la cellule
bêta est donc remarquablement bien
régulée. Elle doit l'être afin d'assurer un
équilibre glycémique normal. Des
tests cliniques récents, et plus
spécifiquement le DCCT (Diabetes
Control and Complications Trial), nous
ont appris l'importance d'un contrôle
strict de la glycémie dans la gestion
du diabète de type 1. Cependant le
risque d'hypoglycémie résultant d'une
insulinothérapie surintensive est
maintenant trop réel.Toute réplique
de cellule bêta utilisée pour le
traitement du diabète de type 1
devra fonctionner réellement bien
afin de limiter les mouvements dans
un sens ou dans l'autre (vers le haut
ou vers le bas). Nous avons
récemment revu en détails ce que
nous considérons comme étant les
exigences minimales en matière de
"thérapie bêtacellulaire" (4) et je
conseille au lecteur de se référer à
cette révision technique pour de plus
amples informations qui n'entrent
pas dans le cadre du présent article.
De nombreuses
études menées par
des groupes
travaillant sur le
traitement du
diabète de type 1
sont
potentiellement
peu judicieuces.
La majorité des groupes qui
travaillent dans ce domaine ne
semblent pas accorder une grande
attention aux modes de fonctionnement
de la cellule bêta lorsqu'ils élaborent
leurs stratégies de thérapie cellulaire.
Ceci n'est sûrement pas sans lien avec
les éventuelles récompenses financières
attribuées pour "guérir" le diabète mais
n'a pas de très bonnes répercussions
sur l'attitude de ces scientifiques envers
le patient. Par conséquent, la plupart de
ces groupes essaient de produire
l'insuline dans des cellules sans granules !
Ces cellules peuvent sécréter des
protéines en utilisant ce que l'on appelle
la voie "constitutive", essentiellement en
les laissant s'écouler. Le taux de
sécrétion ne peut cependant pas être
influencé par l'environnement de la
cellule. Il est impossible à l'heure
actuelle de permettre à ces cellules de
répondre au taux de glucose comme le
font des cellules bêta normales, avec
une augmentation quasi instantanée de
la sécrétion de l'insuline. Il est
cependant facile d'assurer que l'insuline
soit la principale forme sécrétée de la
protéine et pas le précurseur de
proinsuline moins actif (et
potentiellement indésirable).
Pour contrôler les dégâts, la plupart des
chercheurs s'assurent à présent que
l'expression du gène de l'insuline puisse
être stimulée par le glucose. Parfois, il
peut être inhibé par l'insuline elle-
même, ce qui donne une élégante
boucle de rétro-action négative conçue
pour limiter l'hypoglycémie (voir
référence 5 pour exemple). L'exception
la plus significative à cette tendance
était l'étude passionnante de Cheung et
al qui décrivait la sécrétion de l'insuline
régulée par le glucose à partir des
cellules K de l'intestin (6).
Pourquoi donc pensez-vous que je
considère ces autres études comme
potentiellement peu judicieuses ?
Immunosuppression consiste à
réprimer le système immunitaire
naturel du corps afin qu’il ne
puisse rejeter un organe
transplanté.
Décembre 2002 Volume 47 Numéro 4
Orientations futures

31
Figure 2:Données estimées relatives à un test intraveineux de tolérance au glucose
(IVGTT) chez un individu normal (à gauche) et chez une personne atteinte de diabète de
type 1 (à droite) traitée par "thérapie bêtacellulaire" en utilisant la cellule "X" de la Figure 1. >>
du taux de glucose plasmatique. Ceci
ne peut en aucun cas constituer un
traitement pour le diabète de type 1 !
Imaginons quelles pourraient être les
conséquences pour une personne
atteinte de diabète de type 1 traitée
de cette manière. Ceci est démontré
à la Figure 2. Je m'empresse
d'insister sur le fait qu'à ma
connaissance, une telle expérience
n'a pas encore été réalisée sur des
humains. En effet, la thérapie
cellulaire pour le diabète (définie ici
comme le recours à des cellules
génétiquement modifiées et non des
îlots) en est à ses débuts et les tests
in vitro ont été limités aux petits
animaux. Les graphiques de la Figure
2 sont par conséquent inventés ! Ils
sont cependant inspirés de résultats
réels sur des individus normaux
pour la partie relative aux contrôles
et se basent sur des observations
sur des souris extrapolées à
l'homme en ce qui concerne la
thérapie cellulaire. Disons en passant
que cette extrapolation est en fait
assez difficile à faire, car les souris
ne constituent pas un modèle valable
d'équilibre glycémique applicable aux
humains !
Il ne faut pas être un génie (ou même
un diabétologue) pour comprendre la
signification de la Figure 2. Chez
l'individu normal, l'injection
intraveineuse de glucose provoque une
hausse rapide de la glycémie, comme
représenté par la ligne pleine sur le
graphique de gauche. Ceci entraîne une
augmentation de l'insuline plasmatique
grâce à la stimulation de la sécrétion
d'insuline par les cellules bêta en
réponse au taux élevé de glucose
plasmatique, comme indiqué par la ligne
pleine sur le graphique de droite. A
peine l'insuline a-t-elle diminué que la
glycémie commence à baisser et que la
libération d'insuline par les cellules bêta
diminue.
Après environ 90 minutes, les taux de
glucose et d'insuline seront revenus à des
niveaux de base. On a juste observé une
courte période d'hyperglycémie et pas
d'hypoglycémie profonde. Cet individu
n'aurait pas été plus mal en se portant
volontaire pour ce test de tolérance au
glucose par intraveineuse (IVGTT ) !
Considérons à présent la thérapie
cellulaire sur un "patient". Regardons la
ligne en pointillé sur le graphique de
gauche, nous pouvons voir que le glucose
augmente tout aussi rapidement mais
reste à un taux élevé plus longtemps.
Pourquoi ? Regardons la courbe de
l'insuline représentée par une ligne en
pointillé sur le graphique de droite. Les
taux d'insuline n'augmentent pas du tout
pendant les 30 premières minutes.
Après 60 minutes, on observe une
augmentation très faible, à peine
remarquable.
Comme mentionné ci-dessus (Figure 1),
c'est dans ce tout premier laps de
Durée (min)
Glucose (mM)
Décembre 2002 Volume 47 Numéro 4
Orientations futures
contrôle
Insuline (pM)
Thérapie avec cellule “X”
Glucose plasmatique Insuline plasmatique
Durée (min)
Regardons à nouveau la Figure 1. En
mettant en place la régulation de la
glycémie lors de la transcription (étape
de l'ADN vers l'ARNm) et peut-être
un jour lors de la traduction (ARNm
vers proinsuline – pas encore réalisé
mais faisable, à mon avis) sans y inclure
la régulation de la sécrétion, le temps
de libération de l'insuline stimulée à
partir d'une cellule fabriquée sera
inévitablement compromis. En effet,
comme mentionné plus haut, il faudra
au moins une heure avant que les
premières molécules d'insuline
nouvellement formées puissent
commencer à être sécrétées en
réponse à l'augmentation de la
glycémie.
Pire encore, alors que la sécrétion
d'insuline à partir de la cellule bêta
diminue lorsque la glycémie baisse, on
sait que l'ARNm de l'insuline persiste
un certain temps dans la cellule. Ce qui
signifie que des répliques de cellules
bêta fabriquées de cette manière
s'épuiseront à un rythme réellement
plus lent. L'insuline sera encore libérée
par la cellule pendant de nombreuses
heures sans tenir compte de la baisse

()
32
`Philippe Halban
Le Docteur Philippe Halban est
biologiste cellulaire et Professeur à la
Faculté de Médecine de l'Université
de Genève en Suisse. Il est actuelle-
ment Président de l'Association euro-
péenne pour l'étude du diabète
(EASD). Les opinions présentées
dans cet article sont les siennes et
pas nécessairement celles de l'EASD.
Références :
1. Shaw J: Gene Therapy: looking
for alternatives to insulin injection.
Diabetes Voice 2002; 1: 30-34
2. Orci L, Vassalli JD, Perrelet A: The
insulin factory. Sci Am 1988; 259:
85-94.
3. Moore HPH, Walker MD, Lee F,
Kelly RB: Expressing a human
proinsulin cDNA in a mouse
ACTH-secreting cell. Cell 1983; 35:
531-538.
4. Halban PA, Kahn SE, Lernmark A,
Rhodes CJ: Gene and cell-replace-
ment therapy in the treatment of
type 1 diabetes: how high must the
standards be set? Diabetes 200;150:
2181-2191.
5. Lee HC, Kim SJ, Kim KS, Shin HC,
Yoon JW: Remission in models of
Type 1 diabetes by gene therapy
using a single-chain insulin
analogue. Nature 2000; 408:
483-488.
6. Cheung AT, Dayanandan B, Lewis
JT, Korbutt GS, Rajotte RV, Bryer-
Ash M, Boylan MO, Wolfe MM,
Kieffer TJ: Glucose-dependent
insulin release from genetically
engineered K cells. Science 2000;
290: 1959-1962.
temps que nous devons nous attendre à
une augmentation de la sécrétion
d'insuline à partir de cellules bêta
répliquées, suite à la stimulation de la
transcription du gène. Plus désespérant
encore, les taux d'insuline continuent à
augmenter malgré que le glucose soit
revenu à son niveau de base. Ceci est dû
à la lenteur de la réponse mentionnée
ci-dessus. Les conséquences sont
dévastatrices et inévitables : le taux
d'insuline inadéquatement haut
provoquera une hypoglycémie profonde.
Ce patient ne se sentira pas bien
pendant l'IVGTT et il se pourrait même
que l'on doive inverser l'hypoglycémie au
moyen d'une perfusion de glucose.
Nous devons être
absolument certains
d'être capables
d'offrir une
alternative
réellement efficace à
l'injection d'insuline
avant d'annoncer la
possibilité de traiter
les personnes
atteintes de diabète
de type 1.
Engouement vs espoir
La communauté des scientifiques qui
travaille sur la thérapie génique ou
cellulaire du diabète, et j'en fais partie,
doit absolument être certaine de
pouvoir fournir une alternative
réellement efficace à l'injection d'insuline
avant d'annoncer leur "remède" pour le
diabète de type 1 aux personnes
atteintes de cette maladie. Ne pas le
faire serait assez irresponsable. Je ne
pense pas que les modèles actuels
utilisant les cellules secrétrices d'insuline
régulées uniquement au niveau de la
biosynthèse puissent déjà fournir le
traitement. Aujourd'hui, je conçois que
ces cellules, ou peut-être une version
améliorée, puissent un jour s'avérer
utiles pour une injection à plus faible
dose de l'insuline, régulée sur le long
terme, chez des individus atteints de
diabète de type 2. Mais cela est une
autre histoire dont nous pouvons
discuter à un autre moment.
Conclusion
Je ne veux pas paraître indûment
pessimiste. Au contraire, je suis excité,
comme tout le monde, à l'idée d'une
thérapie cellulaire ou thérapie génique
pour le diabète par le biais de l'utilisation
de répliques de cellules bêta sur mesure.
Je pense que cela sera possible. Je
pense que cette méthode sera
beaucoup plus efficace que l'injection
d'insuline, moins chère et plus
accessible que tout autre futur
dispositif mécanique en "boucle
fermée". Je pense que les répliques de
cellules bêta pourront un jour
constituer une alternative intéressante
à la transplantation d'îlots, pas
uniquement en termes de disponibilité,
mais également comme moyen d'éviter
l'immunosuppression.
Je pense par conséquent que la "thérapie
bêtacellulaire" pourra un jour offrir un
traitement peu coûteux et sûr aux
personnes atteintes de diabète de type 1
dans le monde entier. Mais ne me
demandez pas quand cela se produira ou
quelle sera la forme de cette thérapie
cellulaire. Nous sommes juste au point
de départ d'un voyage palpitant, rendu
encore plus excitant grâce au progrès
réalisé au niveau de la biologie des
cellules souches. A mon avis, la fin du
voyage n'est pas encore en vue, mais si
nous basons notre progression sur la
compréhension du fonctionnement des
cellules bêta, nous saurons alors que
nous y sommes arrivés.
Décembre 2002 Volume 47 Numéro 4
Orientations futures
1
/
5
100%