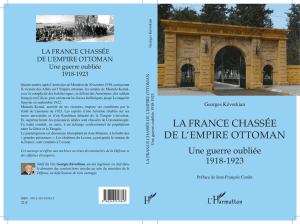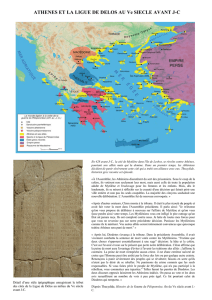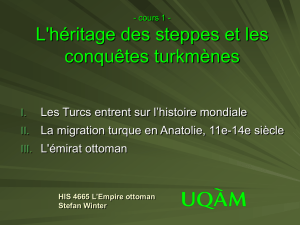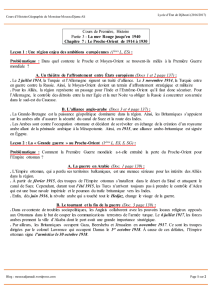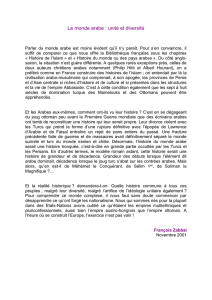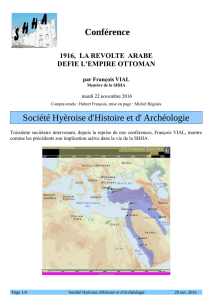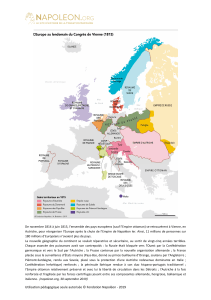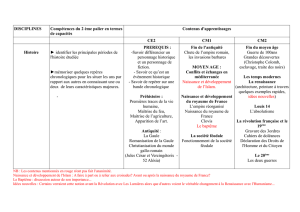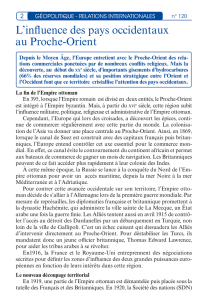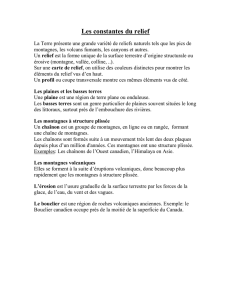La Première Guerre mondialesonne le glas

La Première Guerre mondiale sonne le glas
des Empires austro-hongrois, russe et ottoman. Des traités de paix donnent naissance
à des États-nations dont ils délimitent les frontières.
Celles de l’Empire ottoman sont particulièrement diciles à tracer en raison de sa vaste
étendue, de son multiculturalisme et de la spécicité de son histoire. Qui plus est, la
situation politique au sein de l’Empire est mouvementée.
Fin 1918, l’Arabie, la Syrie, la Palestine, la Macédoine, la Thrace et la Mésopotamie sont
envahies par les alliés. Cette occupation est vécue comme une humiliation par Mustafa
Kemal, général de l’armée impériale qui s’est illustré notamment dans les Dardanelles.
Refusant de voir l’Empire démembré, il prend la tête d’une révolte contre le gouvernement
et organise un pouvoir nationaliste parallèle, à Ankara.
En 1920, le traité de Sèvres entérine les décisions relatives au territoire ottoman prises
par les alliées. Accepté par le Sultan, il est catégoriquement refusé par le mouvement
national de Mustafa Kemal, futur Atatürk. Appuyé par la France et la Russie bolchevique,
et fort de victoires militaires, il obtient la renégociation du traité. Après de longues
tractations, le 24 juillet 1923, la Turquie, d'une part, et la France, le Royaume d'Italie,
le Royaume-Uni, l'Empire du Japon, le Royaume de Grèce, le Royaume de Roumanie, le
Royaume des Serbes, Croates et Slovènes, d'autre part, signent un nouveau traité
conforme aux nouveaux rapports de force de la région, le traité de Lausanne.
En premier lieu, ce traité reconnaît la légitimité de la République turque mise en place
par Mustafa Kemal. Les alliés obtiennent la reconnaissance par la Turquie des pertes
territoriales de l'ex-Empire ottoman à Chypre, dans le Dodécanèse, en Syrie, Palestine,
Jordanie, Irak et Arabie, mais en échange renoncent à demander l'indépendance, voire
simplement l'autonomie, du Kurdistan et de l'Arménie, auparavant prévue dans le traité
de Sèvres.
Ces nouvelles frontières établies ne sont pas sans conséquence pour la population. Avant
même la signature du traité, des échanges de populations débutent « baïonnette dans
le dos ». Un exode basé sur des critères religieux est engagé : 1,5 million de Grecs vivant
en Asie Mineure sur le territoire de la nouvelle Turquie et 500 000 Turcs musulmans
vivant sur le territoire grec vont passer d’un territoire à l’autre. Près d’un demi-million
d’entre eux y laisseront la vie.
Un traité d’une dizaine de pages a ainsi redessiné une région stratégique du monde et
décidé du déracinement de deux millions de personnes.

16 17
Tout le long de la rue Ermou.
Dans les belles demeures en pierre rose,
la pierre des carrières de Sarımsak, en face.
Dans le quartier turc et les maisons de réfugiés
de la Ville Haute, là où je me réfugie à mon tour
dès que je reviens.
Mais ma vraie patrie, cette patrie du cœur que j’ai
tant cherchée, c’est à Mytilène que je l’ai trouvée.
Dans le quartier turc et les maisons de refugiés
de la Ville Haute, la où je me refugie à mon tour
dès que je reviens.
Tout au long de la rue Ermou.
Dans les belles demeures en pierre rose,
la pierre des carrières de Sarimsak, en face.

18 19
Mercredi 9 novembre 2011
Mon travail s’est
achevé hier, mais je
reste encore un peu.
Une pause de quelques jours,
histoire de me balader pour la énième
fois d’un bout à l’autre de la ville.
Dans les forêts
et les volcans éteints de Lesbos,
dans la mer étale et le meltème,
dans les anses, les salines,
les oliveraies, les ravines,
dans les cafés
et les villages
solides comme le roc,
dans le petit paradis terrestre et
les succulentes courgettes
de Madame Irini,
à deux pas d’Agios Dimitrios.

20 21
21
Un ennemi qu’il faut
montrer du doigt,
dénoncer dans
les livres d’école.
Car il ne
s’agirait pas…
Car il ne s’agirait pas
qu’en grandissant
les enfants comprennent
enfin que d’autres que lui sont
responsables de ce qui va
de travers dans leur vie.
Hier, il y avait un défilé. Il y a un siècle, à un an près,
l’île était libérée de nos ennemis,
les Turcs.
Chaque peuple a son
ennemi, un ennemi mortel.
S’il n’en a pas, eh bien,
il doit s’en trouver un.

22 23
Au mur, un encadrement : je reconnais
la masse imposante du cuirassé qui donne
son nom au restaurant.
Aujourd’hui, son escorte
se compose d’une escadre de
boulettes de viande à la smyrniote.
L’ail me pique
délicieusement le palais.
Je me rappelle les boulettes que
mes deux grands-mères me préparaient
dans leur cuisine de Kaisariani*, à Athènes.
Donc, il y a quatre-vingt-dix-neuf ans, le cuirassé
Averof
et son escorte avaient jeté l’ancre en vue du port.
Soufflant de la fumée par ses trois évents,
il avait scellé de la façon la plus martiale
qui soit la libération de Mytilène.
 6
6
 7
7
 8
8
 9
9
 10
10
 11
11
1
/
11
100%