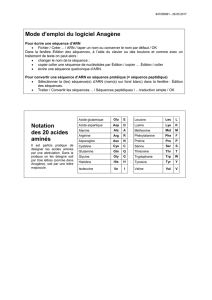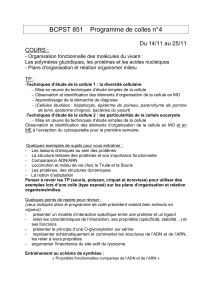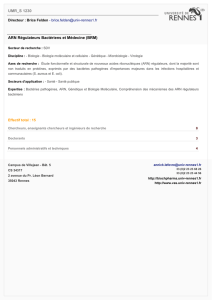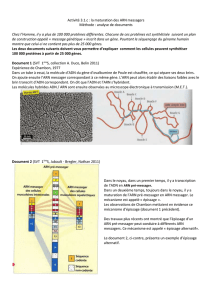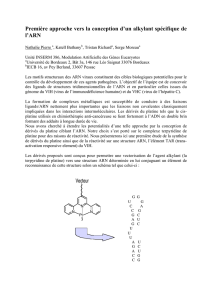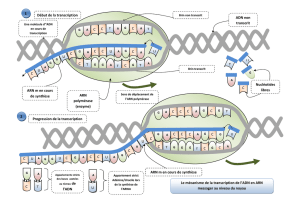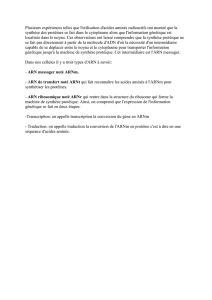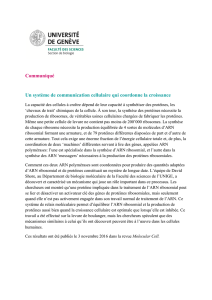Les ARN des bactéries pathogènes

© POUR LA SCIENCE -N° 371 SEPTEMBRE 2008
60
Brice Felden
Les bactéries pathogènes perçoivent leur environnement grâce
à des systèmes sensoriels élaborés et reprogramment l’expression
de leurs gènes dédiés à l’infection. Des
ARN
sont au cœur de cette adaptation.
epuis 1961, la septième pandémie de cho-
léra parcourt le monde et, à partir de l’In-
donésie, a conquis tous les continents,
excepté l’Océanie. L’agent de la maladie,
Vibrio cholerae, est une bactérie qui vit
dans les eaux insalubres. Elle déclenche la
maladie lorsqu’elle est absorbée, v i a l ’ e a u
ou des aliments contaminés. Une fois dans l'intestin, les
vibrions fabriquent la toxine cholérique, qui entraîne une
importante déshydratation, le plus souvent fatale. L’ i n c u-
bation est suivie de violentes diarrhées et de vomissements
sans fièvre qui, en l’absence de traitement, tuent en trois jours.
Cet exemple, où une bactérie passe de l’eau dans l’intes-
tin, révèle que, pour qu’une infection bactérienne « réussisse» ,
l’adaptation de l’envahisseur au nouvel enviro n n e m e n t
hostile – l’hôte– doit être rapide et efficace. Pour mener à
bien cette étape, le micro - o r ganisme est doté à sa surface de
systèmes sensoriels élaborés qui modifient rapidement l’ex-
p r ession de gènes spécifiques de l’infection, par exemple ceux
qui favorisent l’évitement du système immunitaire de
l’hôte, la pénétration dans les cellules et la dissémination dans
les tissus. Une fois ces dispositifs activés, l’expression de cer-
tains gènes augmente tandis que celle d’autres diminue.
Jusqu’à récemment, les biologistes pensaient que les
« chefs d’orc h e s t r e » de ces réseaux de régulation étaient
exclusivement des protéines, activatrices ou inhibitrices.
Pourtant, depuis peu, on découvre de plus en plus d’acides
ribonucléiques (des
A R N
) jouant un rôle dans le contrôle
de l’expression de nombreux gènes qui aident l’infection à
se mettre en place et à perdurer (voir la figure 1). Ces méca-
nismes fondés sur les
ARN
ajoutent un niveau supplémen-
t a i r e de complexité à la physiologie bactérienne. Nous
d é c r i r ons comment certaines bactéries pathogènes utilisent
des
ARN
pour « sentir » leur environnement, par exemple
pour communiquer entre elles et pro d u i re des toxines, mais
aussi pour modifier la composition de leur membrane et
même pour détecter les changements de température. À
terme, l’élucidation de ces mécanismes offrira des pistes
pour concevoir de nouvelles générations d’antibiotiques.
D’abord, distinguons deux grandes classes d’
ARN
res-
ponsables de ces mécanismes: les régulateurs c i s et les t r a n s .
Schématiquement, les premiers font partie du brin d’
ARN
dont l’expression est contrôlée, les seconds sont extérieurs
à cet
A R N
. Certains régulateurs c i s , situés en amont des
gènes, détectent les besoins des bactéries et dirigent eux-
mêmes la fabrication des protéines codées; ce sont les « r i b o -
r é g u l a t e u r s », que nous n’abord e rons pas ici. D’autre s
régulateurs cis sont situés en aval des
ARN
messagers (les
ARN
qui sont traduits en protéines) dont ils régulent la tra-
duction. Les
ARN
régulateurs trans, dont la plupart ne sont
pas traduits en protéines, sont produits (transcrits) indé-
pendamment des gènes, mais pourtant ils en contrôlent l’ex-
pression (voir la figure2). Ces régulateurs trans s’associent
à un ou, le plus souvent, à plusieurs
ARN
messagers dont
ils favorisent ou empêchent la traduction en pro t é i n e s .
D’autres
ARN
régulateurs trans agissent sur des protéines
régulatrices qu’ils empêchent d’agir. De nombreuses bac-
téries pathogènes chez l’homme, certains animaux et
végétaux fabriquent des
ARN
régulateurs trans et cis.
Conversation entre bactéries
Dans leur environnement, les bactéries collectent des infor-
mations et les utilisent de façon à favoriser leur cro i s -
sance et leur prolifération. Ainsi, certaines bactéries
p roduisent, sécrètent, échangent et détectent des molé-
cules de signalisation grâce auxquelles elles estiment la
densité de leur population. Elles utilisent ces re n s e i g n e-
ments pour contrôler et synchroniser l’expression des gènes
de l’ensemble de la communauté en fonction des varia-
tions de leur environnement, des re s s o u r ces et de l’es-
pace disponible. De la sorte, des bactéries « d é c i d e n t », par
exemple, de pro d u i re des facteurs de virulence (voir l’en-
cadré page 63) et d’échanger de l’
A D N
. Les communications
Les
A R N
des bac t é r ies
Les
A R N
des bac t é r ies
371-Felden-lma0408.xp 4/09/08 10:58 Page 60

© POUR LA SCIENCE -Biologie moléculaire 61
1. Les ba c t é r i es path o g è n es
u t i l i sent des pro t é i nes ( e n
vert ) , mais aussi pl us i eurs
A R N
( en bleu ) pour faci l iter l’infec-
tion. Ains i , certa i n s
A R N
sera ient essentiels pour la mu l ti pl ica-
tion bactérienne (a), la fabrication de toxines (b, en jaune), la
modification de la membrane de la bactérie afin qu’elle adhère
aux cel l u l es hôtes ( c ) ou le pi é geage de certa i n es cel l u l es immu-
nitaires de l’organisme infecté (d, ici des anticorps sont inacti-
vés par des composés bactériens).
ARN
Protéine
Bactérie
pathogène
Toxine
Cellule de l’hôte
Cellule immunitaire
a
b
c
d
pathog è nes
pathog è nes
371-Felden-lma0408.xp 4/09/08 10:58 Page 61

© POUR LA SCIENCE -N° 371 SEPTEMBRE 2008
62
i n t e rc e l l u l a i res sont répandues dans le monde bactérien,
mais comment s’établissent-elles ?
Les bactéries fabriquent des molécules, nommées auto-
inducteurs, qu’elles libèrent dans le milieu extracellulaire
(voir la figure 3). À mesure que la population croît, la quan-
tité de ces molécules augmente et atteint un seuil au-delà
duquel elles sont détectées par le groupe. Cette perc e p-
tion, soit par des récepteurs, soit après leur entrée dans la
bactérie, entraîne la modification de l’expression des gènes
chez chaque membre de la population. Ainsi, grâce à ce
mécanisme astucieux, les bactéries fonctionnent à la façon
d’un organisme multicellulaire et en tirent des avantages
précieux qu’elles seraient incapables d’obtenir en agissant
seules. Des travaux récents ont montré que plusieurs
ARN
régulateurs sont au centre de ce mécanisme de communi-
cation bactérienne. La fabrication de facteurs de virulence
par des bactéries qui infectent les cellules d’un organisme
est parfois sous la dépendance d’un tel système. Vo y o n s
cela avec Vibrio cholerae.
Pour s’adapter et survivre aux diff é ren ts enviro n n e -
ments (cours d’eau et intestins), Vibrio cholerae dispose de
plusieurs systèmes lui permettant d’estimer la densité
bactérienne afin de coordonner l’état physiologique de
chaque bactérie en tant que population homogène. Au moins
sept
A R N
r é g u lateurs sont impliqués, dont quatre (Q r r 1
à 4) fonctionnent par appariements, c’est-à-dire qu’ils s’as-
socient à des
A R N
messagers et en contrôlent la traduction,
et trois autres (C s r
B
à
D
) qui empêchent des protéines régu-
latrices d’agir en les éloignant de leurs cibles (voir la figure 4 ).
Lorsque les bactéries sont en phase de latence (elles ne se
multiplient pas), elles fabriquent ces diff é rents
A R N
r é g u -
lateurs, mais le frein que ces derniers constituent est levé
lors d’un épisode infectieux: dans l’intestin, les pro t é i n e s
régulatrices deviennent disponibles et favorisent l’interac-
tion des pathogènes avec les cellules de l’hôte ainsi que la
mobilité des bactéries et la production des facteurs de
v i r ulence, le plus important étant la toxine cholérique.
Les
ARN
régulateurs Csr contiennent, au sein de leurs
séquences, des leurres qui attirent jusqu’à 18 protéines régu-
latrices, empêchant leur fixation sur des
A R N
m e s s a g e r s
cibles. Quant aux
ARN
Qrr, avec une protéine chaperonne
(qui impose sa forme à l’
ARN
), ils se fixent sur l’
ARN
mes-
sager d’une protéine essentielle à la formation de biofilms
et à la fabrication des facteurs de virulence. En s’associant
ainsi, les
A R N
Qrr empêchent la traduction de cet
A R N
messager et conduisent à sa dégradation. Grâce à ces
ARN
régulateurs, la réaction des bactéries à l’enviro n n e m e n t
est rapide et réversible: en effet, le temps de vie des
ARN
régulateurs est court, leur action est donc temporaire.
Le staphylocoque doré (Staphylococus aure u s ) fabrique lui
aussi de nombreux facteurs de virulence selon la densité
c e l l u l a i re. Cette bactérie est l’une des causes les plus courantes
d’infections nosocomiales, c’est-à-dire contractées en milieu
h o s p i t a l i e r, et de pathologies liées à la production de toxines.
Ce pathogène de l’homme et de l’animal est responsable d’in-
fections graves dites purulentes (abcès, furoncles) ou géné-
ralisées (septicémies, chocs toxiques). Parmi les facteurs de
v i r ulence de Staphylococus aure u s , on trouve des toxines, des
enzymes et des protéines extracellulaires grâce auxquelles
le micro - o rganisme adhère à diff é r entes surfaces biologiques.
ADN
ARN
Site de fixation
du ribosome
a
b
c
La production de ces facteurs est séquentielle (ils ne sont pas
tous fabriqués au même moment) et placée sous le contrôle
de systèmes complexes de régulation. L’ensemble forme ainsi
un réseau sensible aux signaux extérieurs qu’il transmet à
l’ensemble de la machinerie cellulaire. Ainsi, avec ces
A R N
régulateurs, les bactéries Staphylococus aure u s e t Vibrio chole-
r a e disposent d’un moyen efficace de communication, grâce
auquel elles s’adaptent à leur enviro n n e m e n t .
Le système
A
g r
Staphylococus a u r e u s se caractérise par des systèmes de régu-
lation à deux composants. Ces systèmes sont constitués
de deux protéines, l’une membranaire et l’autre cytoplas-
mique. La pre m i è r e est le capteur : quand elle détecte un
signal extérieur, par exemple un auto-inducteur, elle accro c h e
un groupe phosphate qui est ensuite transféré à la pro-
téine cytoplasmique. Ainsi parée, cette dernière favorise
l’expression de gènes cibles.
Les diff é rentes souches de bactéries sont groupées selon
le signal extérieur (un peptide) qu’elles produisent. De façon
re m a rquable, chaque peptide auto-inducteur, bien qu’ac-
tivant la modification de l’expression des gènes du groupe
qui le produit, inhibe ce processus de re p ro g r a m m a t i o n
génétique au sein des autres gro u p e s a p p a re n t é s ! A i n s i ,
au cours de l’infection, la multiplication d’un groupe de
bactéries se fait au détriment des autres.
Chez Staphylococus aure u s , le système à deux composants
nommé
A
gr (pour Accessory gene re g u l a t o r) est un régula-
371-Felden-lma0408.xp 4/09/08 10:58 Page 62

© POUR LA SCIENCE -Biologie moléculaire 63
teur global de la fabrication de facteurs de virulence. Grâce
aux quatre protéines
A
gr (notées de
A
à
D
) dont elles dispo-
sent, les bactéries estiment leur nombre et s’adaptent au
milieu selon deux stratégies. Pendant la phase initiale de la
colonisation, elles fabriquent, entre autres, une protéine dotée
de fonctions de protection contre la phagocytose, notamment
en piégeant certains anticorps. Plus tard, le système
A
gr favo-
rise la production de toxines, telle l’hémolysine-. C’est une
petite protéine qui détruit diff é r entes cellules de l’hôte, comme
les globules rouges, ainsi que des organites cellulaire s .
Le système A g r, dont le rôle dans l’infection a été démon-
tré sur diff é r ents modèles animaux, est constitué de l’
A R N I I
et l’
A R N I I I
. Le premier code les éléments du système de détec-
tion (les protéines
A
g r
A
,
B
,
C
et
D
), notamment des auto-induc-
teurs, tandis que le second est un
A R N
r é g u l a t e u r. Cet
A R N
,
qui code également une toxine, est doté de diverses fonc-
tions régulatrices, dont la plus importante est la transition
e n t re la synthèse des protéines de surface (des adhésines) et
la sécrétion de toxines (des hémolysines, des protéases et
d ’ a u t res enzymes de dégradation). Ce faisant, il favorise le
passage d’une phase de colonisation bactérienne, sans symp-
tôme pour l’hôte, à celle du déclenchement de l’infection.
L’
A R N I I I
contrôle l’expression de gènes de virulence au
niveau de leur transcription en
A R N
messager et également
2. Des
A R N
r é g u la t e u rs
( e n ora n ge ) cont r ô l ent l’ex pr e ss i on de diff é-
r ents
A R N
messagers (co da n t des pro t é i n es) en s’y asso c ia n t. Certa i n s
A R N
r é g u lateurs décou v r ent le site de fixation du ribosome afin que cet élé-
ment fabr i que les pro t é i n es en tradu i sa n t les informations co d é e s da n s
l ’
A R N
messager ( a ). À l’inver s e, d’au t r e s
A R N
r é g u l ateurs diss i mu l ent le
s i te de fixation du ribosome ( b ) , bloqua n t tou te fabr ication de pro t é i n es.
Da ns d’au t r es cas, l’asso c iation de l’
A R N
r é g u lateur avec l’
A R N
messager
condu i t à la dégradation rapide de ce dern i er ( c ) . Enfin, l’
A R N
r é g u l ateur peu t
se lier à des pro t é i nes sp é c i f iques ( n on repr é s ent é es) pour eff ec t uer l’u n e
ou l’autre des fon c tions régulat r i ces pr é c é d entes.
ARN
régulateur
Ribosome
Protéine
ARN
messager détruit
Site de fixation
du ribosome
La virulence rend compte du pouvoir pathogène et de
la nocivité d’un micro-organisme, telle une bacté-
rie. Lors d’une infection, la virulence se manifeste
par le biais de divers facteurs, c’est-à-dire de tous les élé-
ments dont la bactérie dispose pour déclencher une infec-
tion et ses symptômes, notamment l’inflammation et la
fièvre. Ces facteurs de virulence sont essentiellement des
protéines et sont donc, à ce titre, codés par des gènes dits
de virulence. On en distingue plusieurs types : certains favo-
risent la reconnaissance de l'hôte et la fixation à ses cel-
l u l e s ; d’autres sont des enzymes ou des toxines qui détruisent
les cellules ou perturbent le métabolisme de l’hôte ; d’autres
encore bouleversent le système immunitaire soit en mas-
quant les micro-organismes, soit en modifiant l’activité des
cellules immunitaires, voire en les détruisant. Enfin, cer-
tains facteurs de virulence favorisent la colonisation de l’or-
ganisme. Ainsi, le pouvoir pathogène d’une bactérie
reflète la nature et la diversité des facteurs de virulence
qu’elle produit. La fabrication de ces facteurs de virulence
est soumise à un strict contrôle par des protéines, mais
aussi, on le découvre, par plusieurs
A R N
.
La virulence et ses facteurs
371-Felden-lma0408.xp 4/09/08 10:58 Page 63

© POUR LA SCIENCE -N° 371 SEPTEMBRE 2008
64
lors de leur traduction en protéines en s’associant (par
appariements) avec plusieurs
A R N
messagers cibles. Le cas
de l’
A R N
III n’est pas isolé: des
A R N
régulateurs sont aussi
impliqués dans le fonctionnement de systèmes à deux com-
posants chez d’autres bactéries pathogènes, par exemple
S t r eptococcus pyogenes, l’agent d’angines et d’infections
cutanées graves, de Clostridium perfringens, responsable de
septicémies et de gangrène.
Récemment, nous avons identifié plusieurs nouveaux
ARN
fabriqués par Staphylococus aureus et dont l’expression
varie selon les souches. Les gènes de ces
A R N
sont situés
dans des zones particulières du génome, nommées îlots
de pathogénicité, qui réunissent de nombreux gènes de viru-
lence et de résistance aux antibiotiques, suggérant que ces
ARN
influent sur le déroulement de l’infection.
Souvent membrane varie
Les bactéries interagissent aussi directement avec les cellules
de l’organisme colonisé. La surface cellulaire des bactéries
conquérantes constituant le premier point de contact dire c t
avec l’hôte, la modification rapide de cette surface est un a t o u t
pour de nombreux pathogènes. Plusieurs équipes étudiant
les
A R N
régulateurs ont mis en évidence leur rôle essentiel
dans la composition de la surface des cellules bactériennes,
p a r t i c u l i è rement pour les protéines de la membrane externe
des bactéries dites à Gram négatif. Les bactéries de ce type
sont entourées d’une membrane interne, d’un espace
p é r i plasmique et d’une membrane externe (les bactéries à
Gram positif n’ont pas de membrane externe). Cette mem-
brane est imperméable à la plupart des molécules (nutri-
ments, signaux, déchets, antibiotiques...), mais elle est
ARN
régulateur
Protéine
régulatrice
Site de fixation du ribosome
ARN
messager
Ribosome
Traduction
Protéine
4. Ce rtains
A R N
r é g u la t e u rs
( e n ora nge ) f o n c tion n ent à la faç on
d ’ u ne «col le mol é c u l aire» à pro t é i n es, en séques t r a n t des pro t é i n es régu-
lat r i ces, qui ne peu v ent pl us ag i r. Par exemple, une pro t é i n e ( l es anneau x
bleu foncé) qui emp ê che la traduc tion des
A R N
messagers en bloqua n t le
s i te de fixation des ribosomes peut ainsi être inhibée et la pro t é i n e co d é e
est fabr i quée (à gauche ). Lors d’un épi s o d e infec t ieux, les bac t é r i es patho-
g è n es libèrent les pro t é i n es de leur squele t te d’
A R N
, el les peu v ent alor s
r e mplir leur rôle : la pro t é i ne codée n’est pl u s fabr i quée
(à droite )
.
3. Co n v e rsa t ions ba ct é r i e n n e s à dista n c e.
Da n s une popu l a-
tion, des bac t é r i es pro du i s ent des mol é c u l es de sig na l i sation ( e n vert ),
nom m é es au to - i n duc teu r s , et réag i ssent à leur accu mu l ation ext racel l u-
la i r e, par exemple en fabr i qua n t des fac teurs de viru len ce. Ces méca n i s m es
sont pa r f o is cont r e carrés par d’au t r es mol é cu l es, tel l es des enz y mes ( e n
rose ) qui détru i sent les au t o - i nduc t eu r s , ou bien des au to - i n duc t eurs anta-
gon i s tes ( e n bleu ) . Ces dern i er s , de struc tu r e s ch i m iques simila i r es au x
au t o - i nduc teu r s, inhibent la détec tion de ceu x- c i en pr e na n t leur place, et
donc les réac tions biolog i ques qu’ils ent ra î n ent.
Auto-inducteur
Auto-inducteur
antagoniste
Enzyme
371-Felden-lma0408.xp 4/09/08 10:58 Page 64
 6
6
 7
7
 8
8
1
/
8
100%