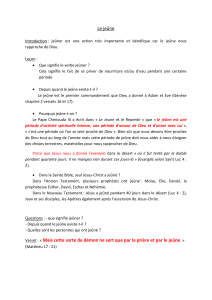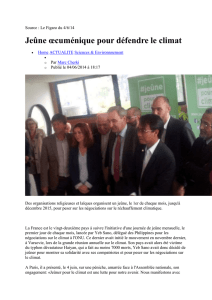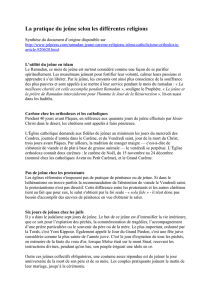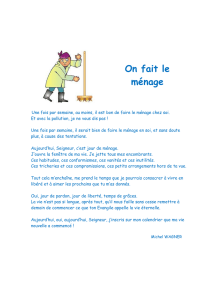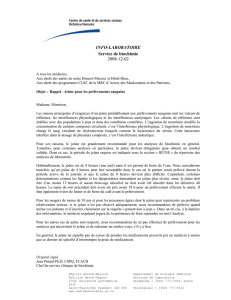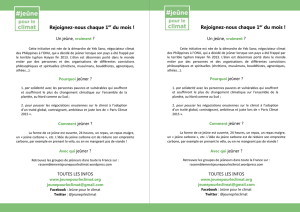Le Jeûne

Désiré Mérien
Le Jeûne
Santé et longévité
grâce à la détoxination cellulaire
(collection ABC)

13
Chapitre 1
Le jeûne dans la nature
et chez l’homme
1. Le jeûne animal
Le jeûne spontané de l’animal
La restriction de nourriture est observée dans le monde
étant pas conformés par
des éducations, les animaux agissent par instinct, souvent
dans le but d’une réparation corporelle. Et de fait, de nom-
breuses améliorations sont alors observées.
auquel était exposé l’animal. Ainsi observe-t-on des chats,
des chiens et autres animaux qui se déplacent, malades ou
temps à autre, ils sortent pour consommer de l’eau.
Le repos physique du corps, le repos physiologique de l’en-
semble des organes dédiés à l’alimentation, et la consom-
mation d’eau constituent leurs moyens de régénération. Les
animaux obéissent à un instinct qui leur est commun : récu-

Le Jeûne
14
pérer de l’énergie et laisser « travailler » leur corps pour
assurer leur guérison.
2. Diverses situations de jeûne animal
Le jeûne en situation de dommage corporel : un animal blessé
ou malade décide instinctivement de ne pas s’alimenter. Ces
se reposer et de récupérer de l’énergie vitale. À intervalles
réguliers, l’animal bouge pour boire de l’eau, et seulement
de l’eau. Les repos physique et physiologique accompagnés
d’apport d’eau représentent leurs choix instinctifs de gué-
rison. Dans la nature, en situation d’anomalie corporelle, la
réponse est donc de ne pas s’alimenter.
Le jeûne en manque de nourriture : les approvisionne-
ments des animaux vivant à l’état naturel ne sont pas
constants. Ils sont donc obligés de se contenter de provi-
à l’inanition, et à
animaux vivant à l’état sauvage, une perte conséquente de
masse pondérale au cours de l’hiver. Heureusement, leurs
réserves alimentaires corporelles leur permettent de sur-
facteur de survie important.
Le jeûne en situations particulières : certains animaux
périodes de restrictions alimentaires se prolongent souvent
par un sommeil récupérateur d’une durée particulièrement

Le jeûne dans la nature et chez l’homme
15
; c’est le cas notamment de ceux qui passent
de l’état de larve à celui d’insecte.
Le jeûne en hibernation : à l’état sauvage, les animaux
doivent s’adapter à la saison hivernale. En Europe du nord,
nourriture contraint alors les animaux à s’organiser pour
survivre. Certains mettent en réserve des nutriments
les abeilles. Pendant les périodes les plus froides, ils se
protègent en dormant et en ne prenant aucune nourri-
ture. À l’inverse, d’autres animaux emmagasinent leurs
provisions de nutriments à l’intérieur d’eux-mêmes. Au
cours de ce temps d’hibernation, l’état de sommeil est
les mammifères, leur métabolisme, sont très ralentis ; les
fonctions vitales sont alors amenuisées et la température
du corps peut s’abaisser considérablement ; la perte pondé-
rale peut atteindre la moitié de la masse initiale. C’est ainsi
qu’ils peuvent d’adapter aux rigueurs de la période hiver-
ces animaux vivent en léthargie. Notons que pour la mar-
motte, il s’agit d’un état particulier conservant néanmoins
la plupart des fonctions vitales à faible densité : l’excrétion,
-
ceptibles.
L’hibernation ressemble à l’état de sommeil contrôlé. Hors
de cette situation, l’animal aurait du mal à survivre. La tem-
pérature corporelle peut descendre d’un ou deux degrés

Le Jeûne
16
en dessous de l’air ambiant ; le pouls est considérablement
ralenti et les mouvements respiratoires diminuent.
L’hibernation de certains animaux comme l’ours brun
est connue pour sa particularité : parfois la femelle donne
nord de la Russie se place sur un amas de feuilles vers la
; s’il n’est pas dérangé, cela durera
à la mi-mars, il vit sur ses réserves nutritives entrepo-
sées dans ses tissus à la belle saison. L’écureuil emmagasine
des noisettes dans une cachette, il peut se réveiller pour les
consommer ; c’est un hibernant partiel. Le blaireau hiberne
durant parfois près de dix semaines. Le loir se dresse une
cachette protectrice et il y dort cinq mois sans manger. Les
chauves-souris hibernent également et cela peut durer la
moitié de l’année ; l
durant tout ce temps. Contrairement aux mammifères hiber-
nants qui recherchent des endroits protégés des intempé-
ries de l’hiver, les animaux « inférieurs » s’enterrent et leur
température avoisine alors celle de l’extérieur. Naturelle-
ment, leur métabolisme s’abaisse. Les reptiles se cachent,
salamandres, certains poissons s’ensevelissent sous le sol
fabrique avec sa bave une sécrétion qui bouche l’entrée de
sa coquille. Les insectes hibernent en stade larvaire, enve-
loppés dans un cocon. Les abeilles et guêpes dorment,
enfouies dans leurs cachettes, tout l’hiver. Tous se raniment
au printemps, dès que la température devient clémente.
L’hibernation est déterminée par l’abaissement de la tem-
retour de circonstances favorables. Ainsi, les ours mangent
en abondance pour amasser des provisions en prévision de
leur hibernation, de manière qu’ils ne sortent pas de leur
 6
6
 7
7
 8
8
 9
9
 10
10
 11
11
 12
12
 13
13
 14
14
 15
15
 16
16
 17
17
 18
18
1
/
18
100%