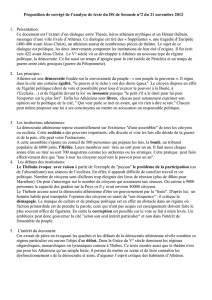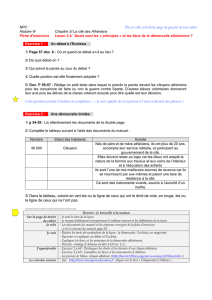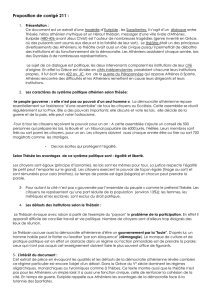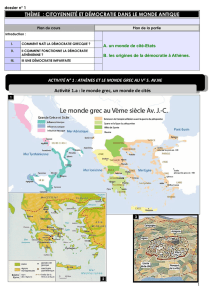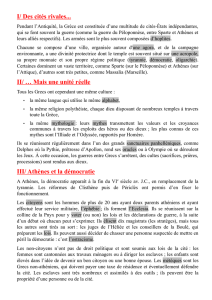comparaison Athènes-Thèbes au 5e s. av. J.-C.

M. Aubel – DST 2nd 1 h.
Correction DS – Explication d'un document
d'histoire : comparaison Athènes-Thèbes au 5e s. av.
J.-C. [CA v1.2]
Note : il est évident que l'obtention d'une note maximale ne nécessitait, de la part d'un élève, qu'une
part modeste des informations et analyses qui suivent. Entre crochets, quelques (rares) compléments
d'information non signalés en classe.
1. Ce texte, traduit du grec antique, est composé d'extraits d’un dialogue entre Thésée, héros
athénien mythique [il a tué le minotaure crétois] et un héraut thébain, messager de la cité
grecque de Thèbes. Une cité (polis) est un micro-État souverain qui comprend une ville et ses
campagnes (Ex. : Athènes, Thèbes, Sparte...). Cette forme d'oganisation socio-politique est la
plus courante (il existe aussi quelques royaumes. Ex. : la Macédoine) dans le Monde grec antique
qui s'étend, depuis la colonisation grecque des 8e-6e s. av. J.-C., sur l'ensemble du bassin
méditerranéen (Ex. : Marseille fondation de Phocée). Ces cités nombreuses et petites (~ 100 km²
en moyenne mais 2 650 km² pour Athènes) sont donc proches géographiquement et, souvent, en
concurrence voire en conflit (on estime qu'une cité grecque est en guerre deux années sur trois !)
[la compétition – agôn, influence du modèle homérique - est saine et naturelle pour les Grecs, ce
dont nous avons hérité]. C'est le cas ici : Thèbes est voisine et rivale d'Athènes depuis des
siècles. Ce dialogue est extrait des Suppliantes, une tragédie d’Euripide (- 484-406 av. J.-C.),
célèbre auteur athénien de nombreuses pièces de théâtre. C'est à Athènes qu'est né le théâtre à
cette époque [voir Q6]. Le sujet de ce dialogue est politique, les deux intervenants comparent les
institutions de leur cité d’origine. Il fut écrit vers - 423/2 av. J.-C., un temps d’apogée pour la cité
d'Athènes (« siècle de Périclès ») et un temps de guerre entre cités grecques (guerre du
Péloponnèse depuis – 431 av. J.-C. entre Athènes, Sparte et leurs alliés respectifs).
2. Régimes politiques : le 5e s. av. J.-C. voit se consolider à Athènes un type assez nouveau de
régime politique, la démocratie directe. Athènes n'est ni la première, ni même la seule
démocratie grecque mais c'est la plus importante et la mieux connue par les sources. C'est un
régime politique dans lequel le peuple, c'est-à-dire l'ensemble des citoyens (sans distinction de
naissance, de fortune ou de capacité), détient le pouvoir souverain et exprime sa volonté par le
vote. On peut dire que la démocratie est le régime politique le plus libre, puisqu'il vise le salut de
tout le peuple, et non l'utilité de ceux qui dirigent. La démocratie est directe quand les citoyens
participent directement à l'élaboration et au vote des lois (par opposition au système de
démocratie représentative telle l'actuelle Vème République française). La tyrannie est un type de
régime politique caractérisé par le pouvoir absolu et arbitraire d'un individu (le tyran). En général,
il est arrivé au pouvoir par la force et s'y maintient par le même moyen (ex. : le tyran athénien
Pisistrate au 6e s. avait des gardes munis de gourdins). Attention cependant, un tyran peut être
populaire et bon gouvernant (c'est le cas de Pisistrate). Ce type de régime tyrannique est courant
dans le Monde grec depuis les 7e-6e s. av. J.-C.
3. Les principes : Athènes est une démocratie directe ; elle est donc fondée sur la souveraineté du
peuple (demos) : « son peuple la gouverne » réuni en assemblée. Il règne dans la cité l'égalité
civique (et non sociale) : « le pauvre et le riche y ont des droits égaux ». Le citoyen dispose en
effet de l'égalité politique (droit de vote) et de l'égalité devant la loi [isonomie]. Enfin les
Athéniens sont libres, chacun peut notamment exprimer son opinion sur la politique de la cité
(liberté d'expression). Chacun peut même proposer une loi à ses concitoyens ou mettre en
accusation un responsable politique.
4. Les institutions athéniennes : la démocratie athénienne repose essentiellement sur l'existence
d'une assemblée de tous les citoyens (ecclesia). Cette assemblée a des pouvoirs importants : elle
discute et vote les lois, elle décide de la guerre et de la paix, elle peut voter l'ostracisme
(bannissement pour dix ans des supects d'aspiration à la tyrannie). A cette assemblée s'ajoute un
conseil de 500 citoyens qui prépare les lois (Boulè), un tribunal populaire de 6 000 jurés
(l'Héliée). Leurs membres sont tirés au sort pour un an. Il faut aussi chaque année ~ 700
magistrats, en général tirés au sort. Ces pratiques peuvent faire effectivement dire que « tour à
tour les citoyens reçoivent le pouvoir pour un an ».
5. Les défauts des institutions : le Thébain évoque à partir de l'exemple du « paysan » le problème
de la participation effective dans une démocratie directe. En effet, il apparaît difficile de concilier
travail et vie politique. Nombre de citoyens sont pauvres et travaillent dur (paysans, pêcheurs,
pottiers...) ; en grande majorité, ils sont trop éloignés des lieux de réunion (presque 40 km pour
le village de Marathon) alors qu'il n'y a pas de route et que le cheval est un luxe (voir les
cavaliers de la frise du Parthénon). On peut s'interroger sur le nombre de citoyens qui assistaient
aux séances. On estime à 9 000 personnes la capacité des gradins sur la colline de la Pnyx où
siège l'ecclesia, le quorum (nombre minimal) pour un ostracisme (bannissement pour dix ans) est

de 6 000 ; or, il y avait environ 30 000 à 40 000 citoyens au milieu du 5e s. Cette critique semble
donc pertinente même si le système de la mistophorie (Misthos à partir du milieu du 5e s.)
permet d'encourager la participation des plus pauvres par une compensation financière. Il
s'interroge aussi sur le degré d'instruction d'un peuple largement rural. Un analphabète peut-il
gouverner avec compétence ? Son argumentation est cependant discutable : d'abord,
l'intelligence et le bon sens ne se réduisent pas aux connaissances (les historiens considérent
d'ailleurs que le peuple a plutôt bien gouverné Athènes aux 5e-4e s.). Ensuite, diverses données
laissent à penser qu'une bonne partie (la majorité ?) des citoyens athéniens sait lire et écrire aux
5e-4e s. : les tablettes sur lesquelles sont gravées les lois [dites de Dracon] sont exposées sur
l'agora (place publique) ; la procédure d'ostracisme nécessite de graver un nom sur un tesson
(l'ostrakon). Le Thébain accuse aussi la démocratie athénienne d'être un gouvernement par la
foule. D'après lui, un homme habile peut la flatter ou l'exalter par son éloquence : c'est le
problème éternel de la démagogie, qui consiste cyniquement à mentir, flatter et promettre pour
accèder au pouvoir : c'est, d'après Les Cavaliers d'Aristophane, le cas du tanneur Cléon qui, alors
que la pièce d'Euripide est jouée au théâtre de Dionysos, domine la vie politique athénienne (de
-429 à sa mort en -422 av. J.-C.) . Le manque de culture et de pratique politique est en effet un
obstacle dans un système où l'action primordiale est de prendre la parole et de persuader les
autres (afin de faire voter une loi ou décret) ; ceux qui n'ont pas appris cet art de l'orateur font,
le plus souvent, office de figurants silencieux (« qui n'a rien à dire se tait »). Cet apprentissage
avantage ceux qui ont du temps et de l'argent à lui consacrer : les aristocrates, tel Périclès,
prennent des leçon de rhétorique, l'art de présenter les idées de la façon la plus persuasive, et
dominent la vie politique athénienne des 5e-4e s. En outre, la corruption est possible car le vote
se fait à main levée. Un ambitieux peut donc gouverner la cité « selon son seul intérêt particulier
» et non dans l'intérêt de l'ensemble du peuple. Périclès mort (- 429 av. J.-C.), la démagogie
triomphe souvent à Athènes aux 5e-4e s. av. J.-C.
6. L'intérêt et les limites du document : ce texte en évoquant les qualités et les défauts de la
démocratie, que l'auteur connait très bien puisqu'il est lui-même citoyen athénien depuis
longtemps (il a plus de soixante ans), révèle combien ce type de régime particulier est l'objet
d'un débat animé – parfois violent - en Grèce et à Athènes au 5e s. av. J.-C. (et encore
aujourd'hui). En Grèce, dominent alors les régimes oligarchiques, monarchiques ou tyranniques.
La démocratie athénienne, souvent critiquée férocement et publiquement (voir la pièce Les
Cavaliers d'Aristophane) est un équilibre assez fragile : elle disparaît d'ailleurs brièvement deux
fois (en –411 et -404-403 av. J.-C.) et quasi-définivement sous la pression macédonienne à la fin
du 4e s. Ce texte montre également que le théâtre n'est pas pour les Athéniens un simple
divertissement. Joué lors de la fête religieuse des Grandes Dyonisies (en l'honneur du dieu
Dionysos), objet d'un concours avec un jury de citoyens, il a une fonction civique, celle de
renforcer la cohésion de la cité. Il faut cependant souligner, ce que l'auteur néglige (car c'est une
évidence pour ses spectateurs athéniens), que ce corps civique n'est qu'une minorité de la
population (30 000-40 000 sur 300 000 à 350 000 habitants de l'Attique au milieu du 5e s.) :
femmes, étrangers et esclaves en sont exclus. Par ailleurs, lorsque Thésée affirme : « son peuple
la gouverne tour à tour, les citoyens reçoivent le pouvoir pour un an », Euripide passe sous
silence le fait que les magistratures les plus importantes ne sont pas tirées au sort : stratèges,
archontes... Entre leur goût pour l'égalité et la compétence indispensable du général d'une armée
d'hoplites (une défaite peut causer la fin d'une cité et la mort ou l'esclavage de ses citoyens – le
cas est arrivé au 5e s.), les Athéniens ont tranché : élection des dix stratèges. C'est ainsi que
Périclès peut dominer la vie politique en se faisant réélire stratège jusqu'à sa mort (- 429 av. J.-
C.).
1
/
2
100%