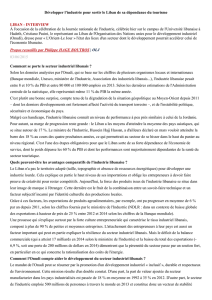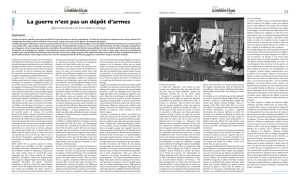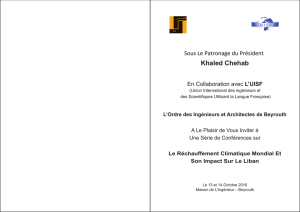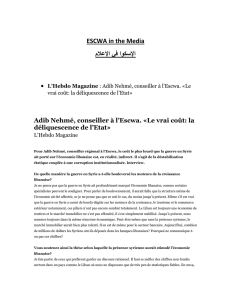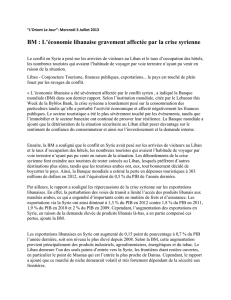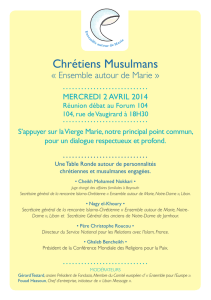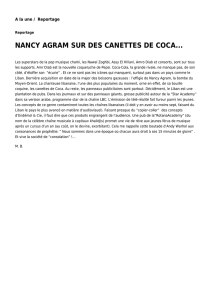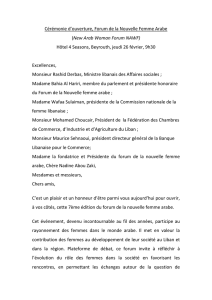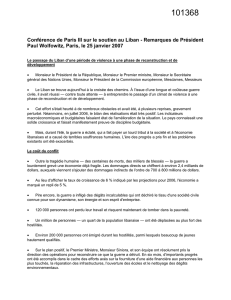les risques attendus d`une dette publique libanaise en

LES RISQUES ATTENDUS D’UNE DETTE PUBLIQUE
LIBANAISE EN CONSTANTE PROGRESSION
Nouhad El Chalouhi - chargée d’enseignement à la FGM
Le Liban est un pays où l’économie de marché est fortement ouverte à l’extérieur. Sa force
réside dans sa capacité d’attraction des investissements et des capitaux des ressortissants
libanais et surtout étrangers.
En effet, un pays construit sa richesse nationale par l’adoption d’une politique monétaire et
budgétaire réfléchie. Où tout Etat est une entité souveraine, capable seule de créer sa monnaie
et d’avoir un budget en déséquilibre. Cette particularité est essentielle car tout organisme
privé ou public, autre que l’Etat, doit avoir son budget en équilibre.
Ce déséquilibre budgétaire permet donc aux Etats d’avoir une dette publique « acceptable »
jusqu’à 60% du PIB
1
. Cet endettement est tout à fait entré dans les mœurs des marchés
internationaux, la seule limite est la capacité du pays endetté à réduire sa dette, voire à la
stabiliser.
Ainsi à cause de la dernière crise financière européenne, divers pays européens comme la
Grèce, l’Italie ou encore l’Espagne sont fortement fragilisés financièrement car
l’augmentation de leur dette publique suscite de réelles difficultés économique, sociale, et
politique au sein de leur pays.
Le Liban n’échappe pas non plus à ce débat. En effet, le Liban a une dette aujourd’hui égale à
plus de 200% du PIB, faisant de ce pays l’un des pays les plus endettés du monde. Cette
situation particulière mérite d’être étudiée car si le Liban est très endetté aujourd’hui, il ne l’a
pas toujours été.
En effet, le Liban d’après guerre a du faire face non seulement à la reconstruction mais aussi à
la dollarisation
2
(I). Cette situation fait qu’aujourd’hui le Liban tente de s’en sortir à travers
des réformes fiscales et budgétaires, tout en s’appuyant sur un atout majeur et non des plus
négligeables, à savoir ses banques commerciales locales (II).
I. Les origines et l’évolution de la dette publique libanaise
1
Les règles de Maastricht ont ainsi retenu 60 % du Produit Intérieur Brute (PIB).
2
La dollarisation est le phénomène de recours au dollar, qui est une devise étrangère constituant une valeur
sûre, pour faire face au manque de confiance envers la monnaie nationale lié à une instabilité politique.

Le Liban a pendant longtemps été l’économie la plus dynamique du Moyen-Orient. En
effet, pendant la période d’avant 1975, le Liban était très prospère et profitait d’une croissance
économique des plus avantageuse.
Cette période va être stoppée par 16 ans de guerre civile, qui vont bouleverser non seulement
l’équilibre politique du pays mais aussi l’équilibre économique et budgétaire. En effet, à la fin
de la guerre, en 1990, le Liban veut se reconstruire. Le gouvernement libanais n’avait d’autre
choix que de s’endetter. Ainsi, la dette publique libanaise était en grande majorité en livres
libanaises, et prise sur une échéance à court terme
3
.
La tendance de l’époque était, en effet, de prendre ce type de crédit. Mais face à l’instabilité
politique du pays, une perte de confiance dans la monnaie nationale conduit les banques à
favoriser les prêts en dollars plutôt que les prêts en livres libanaises. En effet, les
conséquences de la guerre ont fortement affaibli sa force économique sur les marchés
internationaux. Ainsi, malgré l’instauration d’une limite d’emprunt en devise étrangère
4
, la
dollarisation des prêts s’accentue.
Ces deux facteurs, ont favorisé progressivement la dette publique libanaise, qui n’a cessé de
croître continuellement, avec un ratio de la dette publique nette par rapport au PIB de 38% en
1992 à 83,57% en 2002. Cette situation a donné lieu à la première conférence de Paris I en
février 2001
5
. Cette conférence a permis de réduire la dette publique libanaise avec
notamment l’octroi de dettes à plus long terme et à un coût moins élevé. Mais c’est surtout
avec les deux conférences de Paris II et Paris III
6
que la dette libanaise a été remaniée. Où la
conférence de Paris II a permis au Liban de bénéficier de 4,4 milliards de dollars de crédits
internationaux. Par cette action, les conférences ont redonné confiance aux marchés financiers
en favorisant la conversion de la dette publique interne en dette publique externe à long
terme
7
, avec des taux d’intérêt bas.
Cette conversion est certes bénéfique pour le Liban mais cette situation engendre deux lourdes
conséquences :
- La première étant qu’avec la dollarisation
8
, le Liban a accentué la dépendance de son
économie nationale vis-à-vis de l’évolution des taux d’intérêt des marchés financiers
internationaux. Elle est fortement ressentie par la Banque du Liban qui assure depuis
novembre 1998, l’équilibre du marché du taux de change entre la livre libanaise et le
dollar
9
. Sachant que ce taux est fixe
10
, la Banque du Liban lutte contre la
« dollarisation de l’économie libanaise ». Où les particuliers préfèrent utiliser les prêts
en dollar, les organismes publics font appel au prêt en livre libanaise. Cette limite
permet à la banque du Liban de protéger la valeur de sa livre, d’autant que le dépôt
d’argent devant tout organisme public doit se faire en livres libanaises.
3
Le court terme regroupe des bons du Trésor de 3, 6 et 12 mois.
4
Mais pour limiter les risques de liquidité et de solvabilité de dollarisation financière, une règlementation
bancaire impose aux banques de limiter leurs prêts en devises étrangères à 70% des dépôts en devises.
5
C’est en 1997 que la Communauté Européenne a établi une relation contractuelle d’aide avec le Liban. Le
Liban est également un partenaire de longue date du partenariat euro-méditerranéen inauguré lors de la
Conférence de Barcelone de 1995.
6
Paris II en novembre 2002, et Paris III en Janvier 2007.
7
La part des bons du trésor à 24 mois est passée de 41% en 1995 à plus de 93% en 2003 ; alors que celle des
bons du trésor à 12 mois est passée pour la même période de 43% à 3%.
8
Transformation de la dette interne en dette externe.
9
La BDL assure l’équilibre en utilisant des réserves en devises, le taux d’escompte, de refinancement (…).
10
Un dollar égale 1507,5 livre libanaise.

- La seconde conséquence, est qu’avec l’augmentation en continu de la dette publique
libanaise, les investissements publics ont été fortement ralentis. En effet, le
gouvernement libanais, devant faire face au remboursement de la dette publique,
mobilise une part importante de ses recettes budgétaires au remboursement de la dette
au détriment des investissements qui peuvent être faits par lui.
Cette situation affaiblit incontestablement l’économie libanaise, qui doit faire, en même
temps, face à des problèmes géopolitiques nationaux, régionaux, voire internationaux. Où
l’augmentation continue de la dette et la difficulté d’assurer une parité fixe avec le dollar,
fragilise la crédibilité du Liban sur la scène internationale. Cette dérive économique née dans
le début des années 1990, n’a cessé de s’accentuer en se prolongeant durablement dans le
temps.
En effet, les conflits militaires de l’été 2006 ont fortement touché l’économie libanaise, et
plus précisément les finances publiques, conduisant l’Union Européenne à libérer une aide de
reconstruction de 10 millions d’euros
11
. Cette instabilité a engendré un ralentissement sensible
de la croissance passant de 6% en 2004 à 1% en 2006.
Face à ces problèmes financiers, le Liban a toujours bénéficié des aides internationales et
surtout européennes. Mais ces aides ont été accordées sous certaines conditions de
privatisation de certains secteurs publics et de l’instauration de réformes fiscales. Malgré ces
aides et ces promesses de réformes, la situation du Liban reste toujours aussi fragile(II).
II. Des tentatives de secours fragilisées
La dette libanaise continue d’augmenter chaque année d’environ 4 500 à 5 000 milliards de
livre libanaise par an. Ainsi, la dette publique libanaise dépassait les 190% du PIB en 2006.
Face à cette situation, plusieurs réformes publiques ont été envisagées : une réforme fiscale
par l’introduction de la TVA
12
et la privatisation.
A titre d’exemple, le déficit cumulé par « l’électricité du Liban »(EDL), entreprise chargée de
la production et de la distribution de l’électricité au Liban, est de 12 milliards de dollars. Ce
déficit fait du Liban le pays le plus endetté du monde
13
. La privatisation de l’EDL fait partie
des engagements pris par le gouvernement libanais lors de la conférence de Paris II. Mais
aucune réforme n’a réellement été menée. Toutes ces dépenses publiques représentent
environ 35% à 40% du PIB, et le secteur public emploie plus de 18% de la population
active. Ces chiffres montrent la lourdeur de ce secteur où les salaires et les allocations sociales
versés à ces fonctionnaires représentent plus du tiers des salaires versés au Liban.
L’instauration de toute réforme se montre difficile, car de fortes tentions politiques subsistent
empêchant les parties politiques de se mettre d’accord sur un projet de réforme d’envergure.
11
Le Liban est un des bénéficiaires de l’aide du programme « MEDA », aide octroyée par l’Union Européenne.
Le montant d’aide du MEDA I (1995-1999) s’élève à 182 millions d’euros ; et celui de MEDA II (2000-2006)
s’élève à 130 millions d’euros.
12
Taxe sur la Valeur Ajoutée.
13
Si l’on utilise le ratio dette/exportation.

L’endettement budgétaire reste inchangé, et ce dernier est de 55,1 milliards de dollars en mai
2012, soit une hausse de 4,5% sur un an et de 2,7% depuis fin 2011
14
. Cette dette représente
plus de 200% du PIB libanais. Ce niveau exceptionnellement élevé de la dette place le Liban à
la première place mondiale en termes d’endettement par rapport aux exportations.
Aujourd’hui le problème majeur du Liban est que d’une part les intérêts des prêts absorbent
une part importante des ressources publiques. D’autre part, le gouvernement fait appel à des
prêts en devises étrangères plutôt qu’en livre libanaise. Cette vulnérabilité croissante du
Liban, vis-à-vis des marchés internationaux, est mesurée par de grandes agences de notation
tel que « Standard and Poor’s », qui classe le Liban parmi les pays qui « représentent une
assez faible sécurité de remboursement
15
» de leur dette sur le long terme. Ainsi le Liban est
passé de la note de B stable à B négatif
16
à cause de la situation politique en Syrie. Cette
notation est très importante, car plus les Etats sont bien notés plus leurs crédits sont à des taux
bas. D’autre part grâce à une bonne notation, la réputation du pays sur les marchés
internationaux est assurée.
Face à cette situation le Liban qui a échappé à la crise financière mondiale se trouve dans une
situation certes fragile mais soutenu par divers facteurs :
- En effet, la force du Liban est d’être la troisième destination pour les investissements
interarabes
17
. Ces investissements cumulés aux investissements des ressortissants
libanais permettent d’assurer une forte liquidité au sein des banques libanaises et par la
même un équilibre financier national. Les banques libanaises ont un bilan qui est égal
à 340% du PIB.
- La force du Liban réside dans son système bancaire qui grâce aux réserves d’or de là
banque centrale libanaise n’a pas connu d’effondrement.
- Enfin, la dette publique libanaise se trouve aux mains des sept plus grandes banques
libanaises qui n’ont aucun intérêt à ne pas renouveler les échéances des bons du trésor
libanais car leurs profits sont largement dépendants du rendement qu’ils obtiennent par
ces titres.
Cette politique permet encore aujourd’hui de contenir les risques auxquels font aujourd’hui
face certains pays européens comme la Grèce ou l’Espagne. Mais le Liban continue de vivre
dangereusement car le risque le plus important serrait un retrait massif des capitaux placés au
Liban. Dans ce cas la dette ne serait plus soutenue et la situation deviendra catastrophique.
Ainsi des risques importants demeurent au Liban et l’enjeu majeur est de maintenir la
confiance des investisseurs qui offrent aux banques libanaises une forte liquidité nécessaire à
14
La dette publique était de 53,6 milliards de dollars fin 2011, soit une hausse de 2% par rapport à 2010.
15
Journal l’Orient le Jour, « Standart and poor’s abaisse la perspective de la note du Liban », 28 mai 2012.
16
L’indice « Institutional Investor Ratings » (IIR), donne une indication sur le risque de non remboursement de
la dette des Etats. Tout en sachant que plus l’IRR s’approche de 100 plus la chance du pays à rembourser est
forte. Il y a le groupe A qui présente un risque de défaut faible de remboursement car l’IRR est supérieur à
67,7%. Le groupe B a un IRR compris entre 24,2 et 45,9%, où le pays fait l’objet de forte préoccupation. Et enfin
le groupe C où l’IRR est inférieur à 24,2% représente les pays ayant un risque élevé de remboursement.
17
Troisième après l’Arabie Saoudite et l’Egypte.

leurs investissements vis-à-vis de la dette publique. Mais l’Etat libanais doit faire face à cette
dette qui ne cesse d’augmenter, car un bouleversement géopolitique peut renverser les
avantages de ce courant actuel. En ne répondant pas à ces problèmes financiers, le Liban
risque de les accumuler et de ne plus pouvoir les traiter, sachant que la situation économique
mondiale et surtout européenne est toujours blessée par la dernière crise financière.
Bibliographie :
1. Documentation électronique
- www.bdl.gov.lb
- www.finance.gov.lb
- www.lorientlejour.com:
« Standard and Poor's abaisse la perspective de la note du Liban », OLJ/Agences,
28 Mai 2012.
« Le rapport d’avancement sur le Liban de la Politique européenne de voisinage :
un surcroît de réformes est nécessaire », 17 Mai 2012.
- www.lecommercedulevant.com, « Les rendements de la dette externe à 2,26% fin avril »,
28 Mai 2012.
2. Articles
- « Les contraintes de la politique monétaire libanaise (1993-2004) : endettement public,
dollarisation et taux de change fixe », Jean-Baptiste Desquilbet, L'Actualité économique,
vol. 83, n° 2, 2007, p. 163-199.
- « La dette publique libanaise : Anticipation de défaut de l’Etat libanais sur la dette
souveraine en devises étrangères », Ghada EL KHOURY, Bruno Colmant, Albert Corhay
(1995-2006).
- « Comment gérer la dette publique dans un contexte de crise financière internationale ? »,
Charbel Nahas, Conférence au Rotary, Club de Beyrouth, 12 janvier 2009.
3. Rapports
- « Instrument Européen de voisinage et de partenariat, République libanaise : document
de stratégie par Pays 2007-2013, et programme indicatif national 2007-2010 », Rapport
de l’Union Européenne.
1
/
5
100%