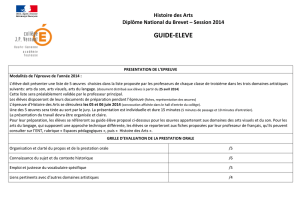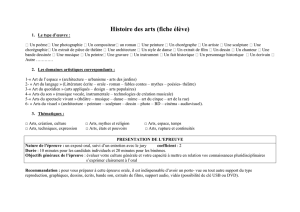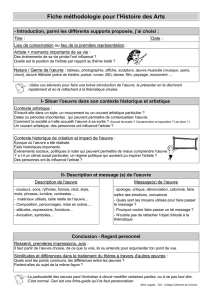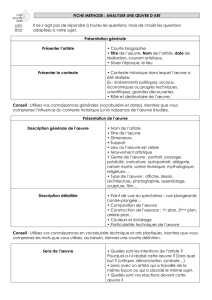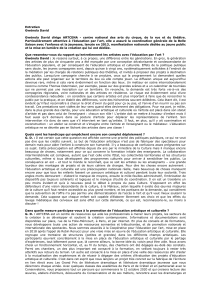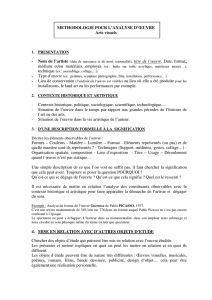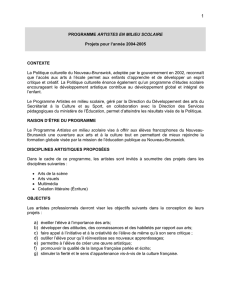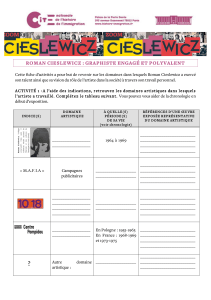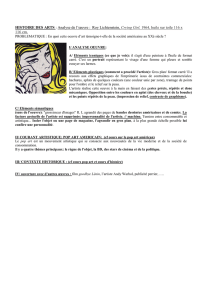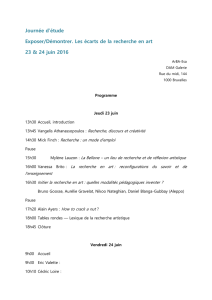Le travail artistique n`est pas qu`artistique. Le déploiement de l

Le travail artistique n’est pas qu’artistique. Le déploiement de l’ethnographie dans le
contexte d’un programme d’éducation artistique en milieu scolaire
Jean Paul Filiod
L’ethnographie, si on l’entend comme un travail circonscrit à un groupe ou à un espace, tend à se
déployer lorsqu’on s’intéresse à un contexte dans lequel l’artiste est amené à développer d’autres
compétences que celles auxquelles il a habituellement affaire. Dans ce cas, le travail de l’artiste au
quotidien, s’il est artistique au sens d’une activité technique particulière menée par un être singulier
inspiré et créatif, engage ce même être comme sujet social dans une négociation avec le contexte.
L’ethnographie doit alors s’entendre comme la démarche qui consiste à embrasser un terrain et se
laisser porter par lui au moyen de plusieurs techniques de collecte, et non plus comme une activité
centrée sur les seules observations directe et participante.
Le cadre est un programme d’éducation artistique en école maternelle, où l’artiste est « en
résidence ». Entre janvier 2003 et juillet 2005, dans dix écoles lyonnaises, des artistes de différentes
disciplines ont été confrontés à des milieux différents de ceux dans lesquels les artistes s’inscrivent
ou tentent de s’inscrire (galeries, industrie culturelle, monde marchand,…). Ce programme a engagé
plusieurs partenaires 1 et a été coordonné par le Centre national de ressources Enfance Art et
Langages, organisme municipal (ici CREAL).
Début 2004, le CREAL a sollicité l’IUFM de Lyon pour réaliser une recherche. J’y ai été convié,
puisqu’identifié comme socio-anthropologue pratiquant l’ethnographie, ayant travaillé sur les
espaces habités et les objets matériels (Filiod 2003a, 2003b), et impliqué en tant que formateur et
chercheur sur l’école maternelle. En septembre 2005, une nouvelle équipe s’est constituée sous ma
direction, en vue d’approfondir certains résultats et préparer une recherche de terrain dans les écoles
qui s’engageront à partir de septembre 2006, la Ville de Lyon ayant souhaité prolonger
l’expérience.
Prémices : logique collective
Les artistes étant en place depuis janvier 2003, les regards portés sur le programme étaient déjà
nombreux. Copiloté par une chef de projet culturel, et une conseillère pédagogique en éducation
musicale (remplacée la dernière année par une de ses homologues des arts visuels), le CREAL devait
organiser des évaluations. En son sein, des outils ont été établis, des résumés et synthèses produits
pour tel ou tel organe de presse. Un reportage pour une chaîne éducative locale fut réalisé, puis un
autre, produit à la demande du CREAL. Tandis que, dès mars 2004, des discours plus officiels
d’évaluation s’énoncèrent lors d’un colloque adossé à une exposition présentant les travaux dans les
écoles. Enfin, en plus de la demande de recherche faite à l’IUFM, le CREAL en fit une auprès d’un
enseignant-chercheur en sciences de l’éducation, spécialiste en philosophie de l’art, en poste dans
une université lyonnaise.
Dans ce contexte foisonnant, notre équipe s’empara de la demande que le CREAL formula lors d’une
réunion par un « observer ce qui se passe » qui satisfaisait secrètement l’ethnographe. En effet, les
enjeux liés aux innovations auraient pu laisser penser que le CREAL orienterait plus la demande :
“les enfants développent-ils des compétences spécifiquement artistiques ?”, “constate-t-on des
changements dans les représentations de l’art chez les membres du personnel de service ?”,…
Observer ce qui se passe… L’occasion fut donc donnée de valoriser l’« observation flottante »
(Pétonnet 1982) au sein d’un des trois groupes de l’équipe 2. Après avoir expérimenté, à deux,
1 Ville de Lyon, ministères de l’Éducation nationale et de la Culture et leurs instances locales, CNDP, INRP.
2 L’équipe était composée de huit membres :
– trois enseignants-chercheurs : un en sociologie, avec l’anthropologie comme spécialité, deux en sciences de
l’éducation avec chacun une spécialité : psychologie, analyse de pratiques professionnelles ;
– une formatrice en arts plastiques et visuels ;
– un inspecteur de l’Éducation nationale formateur, spécialisé sur la danse ;
– trois maîtresses-formatrices, enseignantes en école maternelle.
Sur cette base se sont formés trois groupes, pilotés chacun par un enseignant-chercheur.

2
l’observation directe d’une activité menée par une photographe plasticienne, les trois membres de
notre groupe se sont répartis chacun sur une école, en s’attachant à développer une attitude, plutôt
que d’opter pour telle technique de collecte. Il s’agissait donc de s’inspirer de cette méthode qui
« consiste à rester en toute circonstance vacant et disponible, à ne pas mobiliser l’attention sur un
objet précis, mais à la laisser “flotter” afin que les informations la pénètrent sans filtre, sans a priori,
jusqu’à ce que des points de repères, des convergences, apparaissent et que l’on parvienne alors à
découvrir des règles sous-jacentes » (ibid. : 39). Le « signe distinctif » de l’anthropologie étant « ce
contact avec le matériel vivant », cela « demande la volonté de suspendre son jugement » et « de
s’attendre à ce qui ne peut même pas être formulé, d’être au service de notre matériel et de se fier à
ce qu’il nous dit quand nous le rencontrons » (Mead 1971 : 14). “Disponibilité
mentale”, “ouverture, écoute et attention”, “décrire et enregistrer sans jugement”, cette attitude
permet de dégager des interrogations à partir de tout ce que le terrain donne à voir, à sentir, à
entendre.
Prémices : logique individuelle
L’école dans laquelle j’ai effectué un travail de terrain entre juin 2004 et juin 2005 accueillait un
plasticien, Loïc D., que je connus fin 2003 lors d’une journée d’étude au Musée des Beaux-Arts de
Lyon. Une exposition sur le thème de l’enfance y était combinée à des échanges avec des artistes et
à une conférence-débat que je dispensais sur le thème « Les enfants, les objets et le désordre ». Loïc
s’était montré intéressé, et je lui ai proposé un entretien sur son travail en milieu scolaire, quelques
jours avant que l’équipe IUFM sollicite les acteurs des écoles pour l’accueil des chercheurs 3. C’était
en avril 2004, je sympathisai avec des enseignantes de l’école où Loïc travaillait, et c’est dans ce
mouvement que j’y fus, en quelque sorte, affecté. J’assistai à une réunion de l’équipe éducative en
juin de la même année, avant de la retrouver en septembre, pour un travail de terrain plus direct. Je
vins avec une caméra numérique.
Au-delà de la connaissance qu’apporte l’anthropologie visuelle (Copans 1996 : 107-109 ; Filiod
1998), le choix de l’image mobile tenait aussi à la combinaison de la présence d’un plasticien et de
la profusion d’objets et de productions matérielles que donnent généralement à voir les écoles
maternelles. Le centrage sur les interactions au quotidien devait aussi permettre de dégager des
phénomènes non mis au jour jusqu’à lors. Peut-être aussi s’agissait-il de montrer aux acteurs, déjà
très sollicités, que je m’abstenais de les juger, aidé en cela par l’intermédiaire symbolique de la
caméra ?
J’avais toutefois expérimenté, deux ou trois ans plus tôt, une méthode d’enquête filmique sur le
rapport entre espaces, objets et sujets. Cette méthode, qui prenait alors comme support une classe
d’école maternelle, comportait trois temps :
– Le lieu, à vide, et ses objets ;
– le lieu et ses objets, en entretien avec l’enseignante ;
– le lieu, ses objets, ses acteurs (enseignante, élèves, Atsem 4, parents), dans l’action.
Ces données étant malheureusement restées en souffrance, j’ai saisi l’occasion de rééditer
l’expérience, aidé par les circonstances : en effet, ce jour-là, étant arrivé une demi-heure avant Loïc,
j’ai entamé un filmage à vide de l’école, à travers un trajet dont le point de départ était « l’atelier »,
encore dénommé « espace goûter » sur les plans d’évacuation de l’école. Ce lieu s’offrait comme
point de départ évident, du fait de la nouveauté que figurait la présence d’un atelier d’artiste 5 dans
une école maternelle. On pourrait dire que l’ethnographe, conformément au stéréotype, a été attiré
3 Quatre équipes sur huit ont accepté. L’accès au terrain dans des cadres institutionnalisés fait partie des paramètres de
la démarche ethnographique ; le respect de l’accord ou du refus des acteurs s’invite comme la part déontologique de la
méthode.
4 Agents territoriaux spécialisés en école maternelle.
5 L’image commune de l’atelier d’artiste doit être ici relativisée : ce lieu est par définition réservé à une seule personne
(sauf dans les cas où il y a plusieurs artistes mais ça ne change pas grand chose). Ici, d’autres acteurs s’y rendent :
élèves, enseignants, Atsem, parents, chercheurs.

3
par l’exotisme du lieu… Mais s’il y a tropisme, il y a exclusion d’autre(s) chose(s). Interroger le
travail artistique dans le cadre de tels projets pose justement la question de savoir où se porte le
regard de l’ethnographe : le tropisme vers l’atelier et la tentation de “coller à l’artiste” n’ont pas
manqué d’animer cette année de travail de terrain, ce qu’il me faudra éclaircir.
Le filmage consista en un parcours, depuis l’atelier, à travers couloirs, escaliers et hall d’accueil,
sans filmer les espaces intérieurs (salles de classe, de réunion, toilettes, bibliothèque). Je m’attardais
sur les objets affichés, ainsi que sur les deux cours de récréation 6, lieux centraux du projet de
l’année.
Le motif de ce choix de la cour pour cette dernière année du travail avec Loïc se comprendra mieux
avec un détour par les projets précédents. Cela permettra aussi d’apprécier le souci de cohérence de
l’artiste :
« Transformer une salle en forêt », le 1er projet est « une sorte d’installation qui modifie
radicalement un espace ». Bandes verticales aux teintes noir et blanc mélangées, projections
d’images, théâtre d’ombres, « un espace métaphorique » se crée, suscitant l’imagination,
l’illusion, « la perte des repères spatiaux à l’intérieur d’un espace connu ». Trois mois de travail,
avec des questions d’enfants : « “comment on va faire pour pas se perdre ?”, “est-ce que les
parents auront le droit de venir ?”, “est-ce qu’i’ pourront ?” », et quelques « évaluations : “à
partir de combien d’arbres on est dans une forêt ?” ». Un rapport à des « paramètres », qui fait
qu’on avait aussi affaire à une « étude ».
Le 2e projet, le territoire, viendra dans la foulée, « pour les amener à une vision en plan : dans la
forêt, ils étaient perdus dans quelque chose qui les dominait complètement », alors qu’avec « le
territoire », grand espace au sol en forme de cercle incluant des parcelles délimitées par des
lignes de terre, « ils devenaient un peu des géants dans un espace dont ils avaient constamment
une vision globale ». L’espace est fait de « frontières », mais, par une « narration permanente »
au sein du groupe d’enfants, « toutes les formes se modifiaient constamment » ; les parcelles
sont « matérialisées », mais « ce qui devait s’inventer, c’était, justement, comment créer des
liens avec les autres parcelles, inventer des choses, qui communiquent ».
Du 3e projet, la boule à souvenirs, a résulté une sphère, structure « constituée de dix éléments »,
des « arcs » que les enfants appelleront « les bateaux ». Occasion pour Loïc de « les faire
voyager, dans les couloirs, pour les amener dans une classe, les déplacer, etc. ». Une fois dans
l’atelier, les enfants « ont manipulé les trucs et créé une forme à partir de ça. Donc y avait pas
de forme préconçue, ils savaient pas encore que ça allait être une sphère (…). Et puis en fait,
cette idée, elle est restée : quand y a qu’un seul élément, c’est un bateau, et quand les éléments
sont réunis, c’est une sphère. Et ça, c’est aussi quelque chose qui existe dans tous les projets que
j’ai faits dans l’école, cette notion de construction-déconstruction et d’une division de quelque
chose, prendre en considération des fragments et la somme de ces fragments en tant que
forme ». Objets personnels, photographies, matériaux variés ornent les cloisons intérieure et
extérieure de la sphère. Selon Loïc, « les enfants sont amenés à se définir à travers les objets, à
travers des choses qui leur ont été données, des récits, etc. Mais la forme que ça prend en
définitive, c’est justement : qu’est-ce qu’on partage de cette identité, et comment on peut recréer
quelque chose qui soit un tissage d’identités ? Donc c’est prendre conscience [qu’] on reste pas
cloisonné dans une identité quand on est dans l’école, on est forcément mélangés, et y a des
parts d’identité qui s’effacent, d’autres parts qui sont utilisées, qui sont révélées ». La
production matérialise ainsi, pour les enfants et par leur propre action, les dimensions
individuelle et collective qui nourrissent l’apprentissage d’une socialisation basique.
Territoire, mémoire, souvenir, partage d’identités,… l’idée de la cour de récréation s’inscrira dans
le prolongement. Mais cette fois, le projet part d’un espace existant. « Exprimé par la directrice, dit
Loïc, c’est l’idée (…) qu’y ait des espaces agréables (…). D’un autre côté, moi, je me dis c’est pas
possible de faire travailler les enfants dans l’optique d’une réalisation pérenne, mais par contre, ça
6 Une en haut pour les enfants de petite section, une en bas pour ceux des moyenne et grande sections.

4
m’intéresse bien d’explorer, parce que ça a du sens par rapport au reste de ce qu’on a fait,
d’explorer cet espace de la cour de récréation, des jeux qui s’y font ». Son travail de cette rentrée
2004 a donc consisté à faire exprimer les enfants sur les jeux auxquels ils s’adonnent dans la cour, à
les photographier en train de jouer, à leur donner l’appareil pour qu’ils se photographient eux-
mêmes en train de jouer (sans les priver de la liberté de saisir autre chose à portée de viseur : le ciel,
une voiture de police qui passe dans la rue, le sommet d’un bâtiment,…), à leur soumettre des
objets basiques pour qu’ils imaginent des formes. Autant de scènes qui figuraient, en images
numériques imprimées, sur une cloison de l’atelier, et qui servirent de support à un entretien
informel avec l’artiste ce même matin de filmage. Il parla de réalités observées dans la cour : tel jeu
discret sous un buisson entre enfants, telle histoire imaginée à partir d’éléments naturels ou
matériels existants. Ainsi satisfaisait-il un propos de notre entretien du printemps précédent : pour
ce travail sur la cour, l’objectif était de « placer un peu les enfants dans un rapport, un peu,
d’ethnologie ou d’anthropologie de leur propre pratique, et de voir si à partir de ça, il peut y avoir
des expressions de projet de marquage des espaces, ou de transformation des espaces, mais qui
restent sur le plan du rêve, du projet, où tout est possible, où on peut tout envisager ».
Curieuse situation : dans ce premier contact avec le terrain, l’ethnographe côtoyait un sujet ayant
réalisé un travail d’observation et de collecte dans la cour, avec des enfants dont il pensait qu’il
fallait qu’ils fassent leur « propre anthropologie » 7. Soumis à ce drôle d’univers à “ethnographies
sédimentées”, je me persuadais, une fois de plus, que le travail ethnographique ne consiste pas à
décrire une réalité en tentant de la neutraliser, dans une posture ultra-objective, qui tient d’ailleurs
plus du fantasme ou de la défense que de la démarche scientifique. Le travail ethnographique se vit
en interaction avec des sujets nourris de conscience, d’intentions et d’interprétations. Il s’agit
d’ailleurs moins de « lire par-dessus l’épaule » des sujets (Geertz 1983 : 215), que de partager une
lecture des réalités avec eux ou à côté.
Dans l’atelier et au-delà : déploiements parallèles
Les trois temps de mon filmage expérimental d’auparavant se succéderont : après l’école à vide et
l’entretien informel avec Loïc dans l’atelier, je saisissais l’action et les interactions. J’attendais dans
la cour, l’œil-caméra rivé sur l’horloge située au-dessus de la porte d’où allaient surgir les enfants-
élèves. Dans l’axe, flottaient au vent des pinces à linge suspendues à de fines cordes étendues entre
les quatre arbres de la cour. Objectif : que les enfants viennent y accrocher, à la manière des
cimaises d’exposition, leurs travaux réalisés en classe, complémentaires des expériences vécues
dans la cour : Loïc leur avait donné une feuille avec le dessin d’un arbre en pied, au bas duquel un
carré représentait l’espace entourant l’arbre et délimité par des murets : “qu’allons-nous mettre dans
ces « îles » ?”, chacun devait dessiner quelque chose, le projet cabanes était né. Dans les « îles » de
la cour, Loïc avait déposé des pommes de terre rassemblées dans des filets jaunes, des balayettes
vertes, et enfoui des bouteilles, goulot en terre. Les enfants arrivent en courant, les enseignantes ne
sont pas loin, l’artiste est là, appareil à photo numérique autour du cou, je filme 8.
Au bout du compte, suivre le travail artistique m’a emmené au-delà de l’atelier, lieu où j’ai
toutefois passé plus de temps que, par exemple, dans les salles de classe. Sans doute la présence
régulière d’un artiste et la création d’un « atelier » dans une école sont un phénomène assez rare
pour qu’on s’y attarde. Mais justement : là où d’autres artistes ont surtout investi l’atelier du fait de
leur spécificité disciplinaire (par exemple une sculpteure), Loïc s’est répandu dans l’ensemble de
l’école. À cela, plusieurs raisons :
Loïc est diplômé des Beaux-Arts comme des Arts Appliqués (BTS de plasticien de
l’environnement architectural). Il semble développer plus un rapport à l’espace qu’un
attachement à un lieu où on crée des œuvres. Ce rapport à l’espace est à la fois conceptuel et
7 Expression de Georges Perec (1989 : 11), proche de celle que Loïc a employée.
8 La « densité » de la « description ethnographique » (resp. Geertz 1998 et Laplantine 1996) permet d’envisager une
restitution consistante de l’objet étudié. À ce titre, la question de l’exploitation des matériaux iconiques est cruciale,
notamment dans les espaces d’exposition des résultats de recherche, comme nous le verrons plus loin.

5
pratique, Loïc semble vouloir rendre concrète la dimension philosophique du rapport à l’espace
(Lévy et Lussault 2003). Concilier le grand et le petit, le gros et le détail, le général et le
particulier, le collectif et l’individuel, la démarche s’apparente à celle des professionnels de
l’espace, y compris les anthropologues (Paul-Lévy et Segaud 1983).
Il accorde beaucoup d’importance aux « processus » et à l’articulation des choses : il faut
réaliser des liens entre des espaces, des personnes, des supports, matériaux et objets, y compris
naturels, et des liens entre tout cela. Dessins en classe, constructions et affichages dans l’atelier
comme dans la cour, puis construction d’une cabane par classe, recours fréquent aux travaux en
cours à l’aide d’un usage pluriel de la photographie numérique (Filiod 2006),… le travail
artistique s’inscrit dans cette dynamique.
Enfin, le projet de l’artiste s’accorde avec le projet d’école déterminé par les membres de
l’équipe éducative avec lesquels l’artiste est obligé de composer (et vice versa). La logique de
projet étant au cœur du programme expérimental, l’articulation des objectifs des uns et des
autres est une nécessité ; d’autant que la démarche de l’artiste et sa manière de travailler sont
adaptées à la situation.
Le travail artistique dépasse donc le strict cadre de l’activité de l’artiste, et faire “l’ethnographie du
travail artistique” implique un déplacement de l’ethnographe. La question de l’étendue du travail
artistique et de sa dynamique se pose conjointement à celle de l’étendue du travail ethnographique
et de sa dynamique : le chercheur est amené à déployer ses modes d’observation, de collecte, de
participation. L’objet de la recherche est alors moins le travail artistique en soi que le projet
d’éducation artistique, dans lequel l’artiste joue toutefois un rôle central.
Projet d’éducation artistique, travail artistique et pédagogique,
l’ethnograph(i)e dans l’environnement politico-institutionnel
Suivre l’artiste dans le projet, c’est finalement se déplacer sur les différentes composantes du projet.
En la circonstance, pratiquer une ethnographie définie par les seules observations directe et
participante limiterait le champ des connaissances. Si le travail ethnographique de terrain se
caractérise par l’observation fine et détaillée des réalités humaines et sociales, alors il convient de
multiplier les techniques de collecte : observations directes, avec écriture différée ou enregistrement
direct (cerveau, stylo, photo, vidéo), observation participante, entretiens formels et informels, non-
dirigés et semi-dirigés. Le terrain se vit dans un assemblage de lieux, d’interactions entre des
espaces, des temps, des objets, des sujets, des activités : le déploiement conjoint du travail artistique
et du travail ethnographique engage donc le chercheur dans une « ethnographie combinatoire » qui
élargit le domaine de l’observable et de la réflexion (Baszanger et Dodier, 1997 : 49-62).
Dès lors, aucune signification portée par tel ou tel acteur ne peut être laissée au hasard, y compris
les tenants et aboutissants institutionnels et politiques. Les acteurs engagés dans le programme sont
nombreux, et les enjeux aussi : discours pour dire les bonnes pratiques éducatives, ce permettent ou
entravent les arts à l’école, la prolongation de l’innovation, avec pérennisation ou non d’emplois
pour des artistes,… Le chercheur n’est pas isolé de cet environnement politico-institutionnel, il
n’est pas rivé à une observation dans un espace confiné ; on lui demande de présenter des résultats,
de proposer un « regard », « croisé » à d’autres, dans un document faisant le bilan du programme (et
dont le titre commence bien sûr par Regards croisés).
Bien qu’il faille y regarder de plus près, les discours se sont focalisés sur les compétences
développées par les enfants-élèves et sur les relations entre artistes et enseignants. C’est sur ce
second point que les résultats de recherche et les évaluations académiques sont les plus loquaces.
Tout le monde, depuis sa position spécifique, a quelque chose à dire là-dessus. Spécifier le discours
de l’ethnograph(i)e dans cet ensemble est délicat, mais essayons, sans singulariser à l’extrême 9.
La tendance générale des discours accorde une place de choix aux catégorisations professionnelles :
on parle des « artistes » et des « enseignants ». C’est une réalité, mais le point de vue des acteurs
9 Ce qui suit doit être lu comme des résultats en cours d’approfondissement. La Convention signée en mai 2006
engageant notre nouvelle équipe jusqu’en juillet 2008, de nouvelles données permettront d’affiner.
 6
6
 7
7
1
/
7
100%