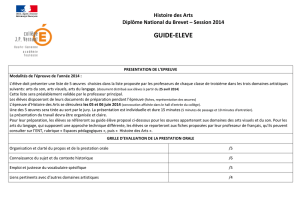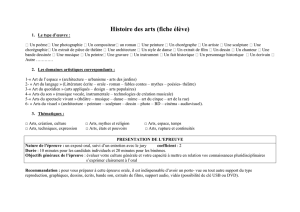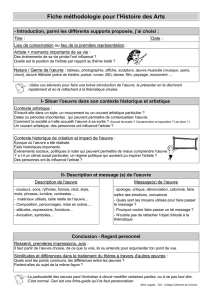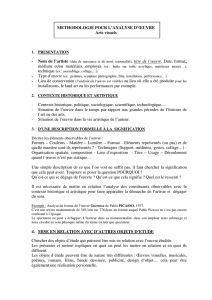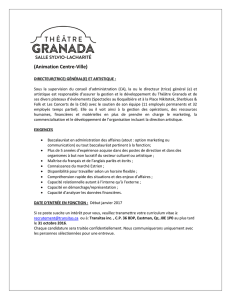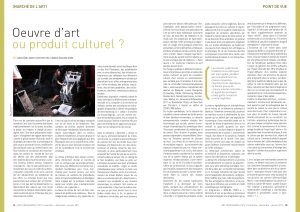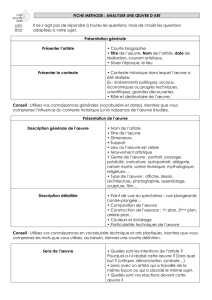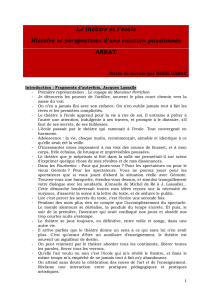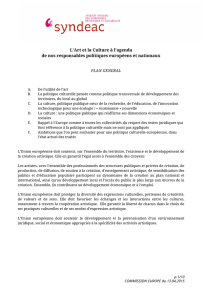Entretien Gwénola David : Éducation artistique et culturelle
Telechargé par
gwenola.david

Entretien
Gwénola David
Gwénola David dirige ARTCENA - centre national des arts du cirque, de la rue et du théâtre.
Particulièrement attentive à l’éducation par l’art, elle a assuré la coordination générale de la Belle
Saison avec l’enfance et la jeunesse, lancée en 2013, manifestation nationale dédiée au jeune public
et la mise en lumière de la création qui lui est dédiée.
Que ressentez-vous du rapport qu’entretiennent les artistes avec l’éducation par l’art ?
Gwénola David : Je ressens surtout, à ce propos, une différence entre les générations. En gros, la génération
des artistes de plus de cinquante ans a été marquée par une conception dévalorisante et condescendante de
l’éducation populaire, et par conséquent de l’éducation artistique et culturelle. Effets de la politique publique
sans doute, les jeunes compagnies sont, depuis quinze à vingt ans, systématiquement sollicitées à l’endroit de
la médiation par les chargés de relations publiques des théâtres, et invités à proposer des projets à destination
des publics. Lorsqu’une compagnie cherche à se produire, ceux qui la programment lui demandent quelles
actions elle peut organiser sur le territoire du lieu où elle compte jouer. La diffusion unique est aujourd’hui
devenue rare, même si cela varie évidemment en fonction des lieux. Un metteur en scène internationalement
reconnu comme Thomas Ostermeier, par exemple, passe sur des grandes scènes et a un calendrier de tournées
qui ne permet pas une inscription sur un territoire. En revanche, la demande est très forte vis-à-vis des
compagnies régionales, voire nationales et des artistes en résidence. Le risque est évidemment celui d’une
condescendance redoublée : on considère que certains artistes ont plus important à faire que de rencontrer le
public par la pratique, et on établit des différences, voire des hiérarchies souvent délétères. Cela étant dit, il est
évident qu’il faut reconnaître à chacun le droit d’avoir du goût pour ça ou pas, et l’envie d’en nourrir ou pas son
travail. Ces prestations sont vidées de leur sens quand elles deviennent des obligations. Pour ma part, je milite,
dans la plus grande des clartés, pour une éducation artistique et culturelle où l’artiste est placé dans son statut
d’artiste et pas dans celui de l’enseignant : chacun son rôle ! L’artiste doit se mettre à hauteur d’enfant mais il
faut aussi qu’il demeure dans sa posture d’artiste pour déplacer les représentations de l’enfant. Son
intervention n’a donc de sens que s’il intervient en tant qu’artiste. Il faut, en plus, qu’il y ait coanimation et
coconstruction : un atelier se construit et s’imagine entre l’artiste et l’enseignant ou le médiateur. L’éducation
artistique ne se décrète pas en lâchant des artistes dans une classe !
Quels sont les handicaps qui empêchent encore son complet déploiement ?
G. D. : Il est certain que cette question est affichée comme une priorité des politiques publiques, ce qui ne veut
pas dire que les crédits suivent. Le but de l’éducation artistique n’est pas de fabriquer des spectateurs pour
demain mais pour aider l’enfant à construire son humanité. Il y a beaucoup de confusions assez prégnantes sur
ce sujet. Cette préoccupation est affichée depuis dix ans par le ministère de la Culture mais il manque encore
beaucoup de choses, notamment pour ce qui concerne la formation initiale des enseignants. La collaboration
interministérielle est complexe, autant que l’est celle entre l’Etat, les collectivités territoriales et les structures
culturelles, même si tous développent des programmes culturels pour arriver à sensibiliser les publics. La
conséquence en est – et tout le monde le reconnaît, que ce soit les artistes ou les enseignants – une grande
lourdeur des montages de projets et de leurs cahiers de charges. Pour dire les choses encore autrement :
l’éducation artistique et culturelle est une préoccupation nationale réelle, mais beaucoup de choses manquent
encore pour que tous les enfants fassent un parcours artistique et culturel pendant toute leur scolarité. Trois
angles morts demeurent : d’abord le manque de moyens, ensuite le mille-feuilles administratif, l’imbrication de
dispositifs pas toujours cohérents et logiques et le manque d’outils de coordination. Il en est un troisième un
peu moins évident et qu’a à nouveau posé le débat à propos du pass Culture. S’opposent en effet les
défendeurs d’une vision descendante de la culture, à la Malraux, selon laquelle il existe des œuvres majeures
de la culture qu’il faut rendre accessible au plus grand nombre, et les partisans de la demande, qui considèrent
que la subvention de l’offre n’a pas permis une démocratisation de l’accès à l’art et qu’il vaut mieux soutenir la
demande. Cela suppose que chaque enfant soit capable d’élaborer librement ses choix et que les effets du
lavage médiatique des cerveaux est sans effet sur cette demande, ce qui est, reconnaissons-le, au moins à
discuter !
Dans quelle mesure participez-vous à la promotion de l’éducation artistique et culturelle ?
G. D. : ARTCENA est un centre de ressources qui aide les professionnels à mener leurs projets, les secteurs de
la création à se développer et soutient la création contemporaine. Informations et documentations sont
disponibles sur place, rue de la Folie-Méricourt, à Paris, et par internet. En plus de conseils et de formations,
nous développons toute une action de ressources sonnantes et trébuchantes, et de promotion nationale et
internationale des spectacles. Nous sommes associés à la Coopérative pour l’éducation par l’art, mise en place
en 2018 après l’appel de Robin Renucci pour une vraie mise en œuvre de l’éducation artistique et culturelle. Elle
regroupe une trentaine de structures (petites et grandes) dans les différents champs artistiques. Les
participants œuvrent concrètement à la mise en place de l’éducation artistique et culturelle par le partage
d’expériences, tout bêtement parce que, là comme ailleurs, la bonne idée du voisin peut être utile. Nous avons
choisi un fonctionnement horizontal, et, au fil du temps, des chantiers ont été dégagés au-delà des constats.
Parmi ces chantiers, un des plus important est consacré à la formation, en veillant toujours à rester très
attentifs aux retours du terrain. Un autre est consacré à la mise en place d’une veille des ressources afin d’aider
à la mutualisation des expériences et de réussir à dégager des critères d’évaluation des projets d’éducation
artistique et culturelle. C’est dans cet esprit que nous lançons un projet très concret sur la fabrique de l’écriture
en lien étroit avec Les Grand Prix de littérature dramatique et littérature dramatique jeunesse que nous
décernons chaque année. Avec quelques classes des académies de Paris et de Créteil et en partenariat avec le
Conservatoire, nous proposons tout un parcours qui commencera le 12 octobre 2020 et qui croisera lecture des
œuvres, ateliers d’écriture, découverte du Conservatoire et de ses métiers, rencontre avec les dramaturges et

les comédiens. Soyons clairs : l’éducation artistique, c’est bien d’en parler mais c’est mieux d’en faire, alors
allons-y !
1
/
2
100%