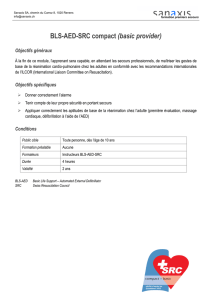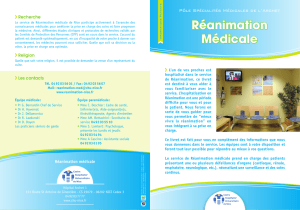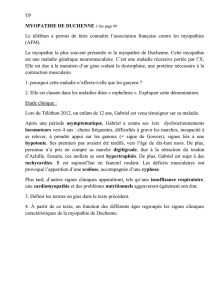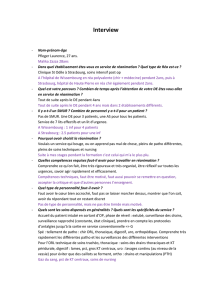Complications neurologiques et musculaires de la

COMPLICATIONS
NEUROLOGIQUES ET MUSCULAIRES
DE LA REANIMATION PROLONGEE
F. Gouin*, M-L. Ayem*, J-F.Pellissier** - * Département d'Anesthésie
Réanimation Pr F. Gouin, Hôpital Sainte-Marguerite, 270 Bd de Sainte -
Marguerite, 13009 Marseille. ** Laboratoire de biopathologie nerveuse et
musculaire. Faculté de médecine 13005 Marseille.
INTRODUCTION
En 1977, Mac Farlane et Rosenthal [1] décrivent une myopathie sévère avec
quadriparésie survenant chez une patiente traitée par de fortes doses de corticoïdes
pour un état de mal asthmatique. Au cours des années 80 apparaît la notion de
polyneuropathies acquises en réanimation, à l'origine d'échec du sevrage de la
ventilation artificielle [2, 3, 4, 5]. Bolton et coll. [2, 3] proposent le terme de Critical
Illness Polyneuropathy (CIP). Les facteurs incriminés dans ces observations sont
nombreux : sepsis, défaillances multiviscérales, corticothérapie au cours du
traitement de l'état de mal asthmatique, utilisation prolongée des curares [3, 4, 5].
Les cas rapportés paraissent assez fréquents pour que, dans les années 90, soient
réalisées des études prospectives pour évaluer l'incidence des atteintes

MAPAR 1997
622
neuromusculaires survenant chez des patients présentant un sepsis ou nécessitant
une ventilation mécanique prolongée [6, 7, 8, 9]. L'existence d'une atteinte
neuromusculaire devient ainsi un facteur étiologique qu'il convient de rechercher
systématiquement en présence d'un sevrage difficile [5, 7].
Plusieurs mises au point ont été présentées [10, 11, 12, 13] mais de nombreux
travaux ont été récemment publiés modifiant en partie les conceptions d'ensemble
de ces pathologies [14, 15, 16, 17].
1. LA POLYNEUROPATHIE DE REANIMATION
Les malades décrits [1, 2, 3, 6, 15] présentent une polyneuropathie sévère
sensitivomotrice se déclarant au cours d'un séjour en réanimation avec ventilation
mécanique (VM) prolongée souvent dans un contexte de sepsis, de syndrome
inflammatoire réactionnel sévère (SIRS) et de défaillance multiviscérale (SDMV).
Les signes cliniques sont dominés par un sevrage difficile de la VM sans cause
évidente et une faiblesse musculaire. Le déficit moteur est le plus souvent
symétrique, atteignant au maximum les 4 membres, avec une aréflexie. L’examen
électrophysiologique révèle une atteinte axonale aiguë primitive atteignant les fibres
motrices et sensitives avec intégrité de la jonction neuromusculaire.
1.1. DIAGNOSTIC CLINIQUE
L’examen neurologique est particulièrement difficile à réaliser chez des malades
ventilés, sédatés et parfois même curarisés. La séméïologie clinique ne peut être
correctement appréciée qu’après arrêt de la sédation et début du sevrage respiratoire
donc lorsque la maladie causale initiale, le sepsis et le SDMV semblent contrôlés.
Le diagnostic clinique est rendu plus difficile par la coexistence fréquente d’une
atteinte neurologique centrale précédant les premiers signes de CIP [16].
L’attention doit être attirée au tout début par des signes d’atteinte musculaire
respiratoire entraînant une difficulté, voire une impossibilité de sevrage ventilatoire.
Cette constatation clinique doit faire évoquer le diagnostic après élimination des
autres causes de difficultés de sevrage.
L’atteinte motrice est retrouvée au niveau des membres avec impotence
fonctionnelle, réduction des mouvements tant spontanés que provoqués. Ce déficit
moteur est le plus souvent symétrique. Son intensité va de la parésie simple jusqu’à
la tétraplégie flasque. Une amyotrophie majeure, quoique non spécifique, est
souvent décrite avec constatation parfois de fasciculations musculaires. Il existe
fréquemment une hypo- voire une aréflexie ostéotendineuse. Cependant un travail
récent insiste sur la possibilité de conservation voire d'exagération des reflexes
ostéotendineux [18].
Le déficit sensitif est inconstamment rapporté, ce qui parait lié à la difficulté de
sa mise en évidence dans ce contexte [14].

Réanimation et pathologie neuromusculaire
623
Il faut souligner que tous ces signes peuvent être plus ou moins prononcés selon
la sévérité de la polyneuropathie et qu’ils sont absents dans environ 50 % des cas où
existent des signes électriques [2, 8, 14, 15]. Il ne semble pas exister d’atteinte du
système nerveux autonome.
Au total l’examen clinique présente une très faible sensibilité pour le diagnostic
positif. Les méthodes électrophysiologiques sont donc nécessaires pour affirmer le
diagnostic.
1.2. EXAMENS PARACLINIQUES
L'examen électrophysiologique comporte une étude des conductions nerveuses,
motrices et sensitives, après stimulation et recueil par électrodes de surface :
vitesses de conduction et amplitude des potentiels d'action moteurs et sensitifs. Un
électromyogramme (EMG) avec aiguilles est aussi réalisé avec étude de l'activité
spontanée et des potentiels d'unité motrice à l'effort.
Les caractéristiques électrophysiologiques sont celles d’une dégénérescence
axonale, donc théoriquement très différente de ce que l'on observe dans les lésions
de démyélinisation (Tableau I). Les vitesses de conduction nerveuse, motrice et
sensitive, sont normales (40 à 80 m/s) ou légèrement diminuées, sans bloc de
conduction. Les potentiels d'action musculaires sont d'amplitude diminuée
(< 5 à 10 mV). Les potentiels d'action des nerfs sensifs sont normalement de petite
amplitude (10 à 50 microV) et donc plus difficiles à obtenir. Ils sont eux aussi
d'amplitude diminuée.
TABLEAU I
Caractéristiques électrophysiologiques de la CIP
Vitesses de conduction nerveuse motrice et sensitive :
normales ou légèrement diminuées
Diminution nette de l'amplitude des potentiels moteurs et sensitifs.
Transmission neuro-musculaire non altérée
EMG au repos :
persistance d'une activité d'insertion
potentiels de fibrillation
potentiels lents de dénervation
EMG à l'effort :
tracés pauvres: diminution du recrutement
potentiels d'unité motrice polyphasiques
A l'EMG le muscle au repos présente une importante activité de dénervation
avec fibrillations et potentiels lents de dénervation, prédominant au niveau des
muscles distaux des membres et intéressant également les muscles intercostaux. Les
tracés d’effort sont pauvres avec diminution du recrutement et des potentiels
polyphasiques d’amplitude non augmentée. La transmission neuromusculaire
évaluée par stimulation répétitive n’est pas altérée.

MAPAR 1997
624
Au niveau biologique, aucune anomalie spécifique n’est retrouvée.
L‘examen biochimique du liquide céphalorachidien ne retrouve pas de
dissociation albuminocytologique franche.
L’examen histologique (biopsie neuromusculaire ou étude nécropsique) retrouve
une atteinte axonale primitive de sévérité variable et intéressant les fibres motrices
et sensitives. L’étude en coupes semi-fines révèle une raréfaction des fibres
nerveuses en particulier des fibres myélinisées de gros calibre expliquant dans
certains cas la diminution modérée de la vitesse de conduction nerveuse. Il n’existe
pas de lésions inflammatoires ou vasculaires.
1.3. DIAGNOSTIC DIFFERENTIEL
Avant de poser le diagnostic de polyneuropathie de réanimation, il convient tout
d’abord d’éliminer les autres atteintes neurologiques périphériques se manifestant
elles aussi par une faiblesse musculaire avec signes déficitaires et insuffisance
respiratoire [2, 3, 8, 10, 13]. De nombreuses pathologies peuvent être évoquées
(tableau II). Parmi les pathologies à éliminer la plus fréquente est la
polyradiculonévrite de Guillain et Barré caractérisée par une paralysie symétrique,
extensive, ascendante, touchant souvent les paires crâniennes (en particulier le
facial) et survenant le plus souvent au décours d’une affection fébrile et/ou
digestive. Le processus physiopathologique se caractérise par une atteinte
inflammatoire probablement d’origine auto-immune avec démyélinisation. La
différenciation entre CIP et Guillain et Barré est possible sur des bases cliniques et
surtout électrophysiologiques.
TABLEAU II
Diagnostic différentiel de la CIP
Syndrome de Guillain Barré
Pathologie neurologique méconnue
Polyneuropathies toxiques
Polyneuropathies infectieuses
Polyneuropathies médicamenteuses
Polyneuropathies des maladies de système
Polyneuropathies des insuffisances respiratoires chroniques
Porphyrie
1.4. EPIDEMIOLOGIE ET PATHOGENIE
L’incidence de la CIP est difficile à apprécier. Les premières études publiées
sont des observations rétrospectives de malades. Depuis le début des années 90
plusieurs études prospectives ont été réalisées [6-9, 14, 15]. L'incidence rapportée
est très variable : de 0 % [9] à 50 % et plus [14] des patients «à risque».
Ces résultats discordants tiennent à plusieurs raisons. D'une part les critères
d'inclusion dans les études sont variables : patients septiques et présentant au moins

Réanimation et pathologie neuromusculaire
625
une défaillance viscérale, patients ayant un SDMV, patients dont la durée
d’hospitalisation en soins intensifs ou la durée de ventilation sont prolongées...
D'autre part les critères de CIP sont soit seulement cliniques soit
électrophysiologiques, utilisant des EMG systématiques pratiquées au lit du patient.
Enfin la nécessité d'exclure les patients présentant des atteintes neurologiques
initiales, ceux n'ayant pu bénéficier d'un EMG ou ceux chez lesquels l'EMG est
ininterprétable aboutit à exclure un très grand nombre des patients éligibles :
respectivement 64 % et 51% des patients sont exclus dans les deux travaux
prospectifs parus en 1996 [14, 15].
Au total, les anomalies neuromusculaires paraissent avoir une incidence
particulièrement élevée dans les suites d'états infectieux graves ou de syndromes
inflammatoires sévères et chez les patients présentant des défaillances
multiviscérales. La survenue d’une CIP serait corrélée étroitement à la gravité du
patient et à l'importance de dysfonctions viscérales [15, 16].
Aucune étiologie précise n’est pour l’instant individualisée. Une origine
multifactorielle semble probable pour beaucoup d'auteurs. Plusieurs hypothèses
physiopathologiques sont avancées mais aucune n’a pu être confirmée : déficits
vitaminiques, toxicité médicamenteuse, malnutrition [13]. Dans une mise au point
récente, Bolton [16] présente la polyneuropathie de réanimation comme l'une des
complications du SIRS, l’atteinte neurologique périphérique étant probablement
secondaire au processus physiopathologique affectant les autres organes. Les
médiateurs de l’inflammation (cytokines, Tumor Necrosis Factor, leucotriènes,
prostaglandines, histamine, sérotonine) sont produits en quantité excessive au cours
du sepsis. Ces substances pourraient avoir une toxicité neuronale directe ou
indirecte.
2. LES MYOPATHIES DE REANIMATION
2.1. INCIDENCES ET MANIFESTATIONS
Bien que quelques observations aient été décrites dès le milieu des années
70 [1], les myopathies de réanimation paraissent avoir été «oubliées» au cours des
années 80 au profit des CIP. Elles font à nouveau l'objet de
travaux [8, 12, 17, 19, 20, 21, 22].
Les manifestations cliniques de ces atteintes musculaires sont très proches de
celles observées dans les polyneuropathies : déficit moteur et difficultés de sevrage
de la ventilation artificielle. Comme pour les atteintes neurologiques les conditions
d'examen sont souvent difficiles.
Les caractéristiques électrophysiologiques sont théoriquement nettement
différentes de celles de la CIP : amplitude des potentiels d'action diminuée mais lors
de l'effort il existe un recrutement complet. En fait la distinction dans les conditions
d'examen d'un patient de réanimation est souvent difficile et les tracés ne permettent
 6
6
 7
7
 8
8
 9
9
 10
10
 11
11
 12
12
1
/
12
100%