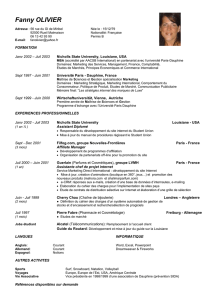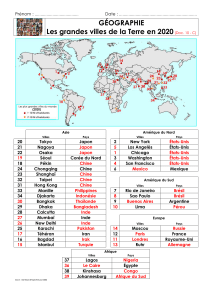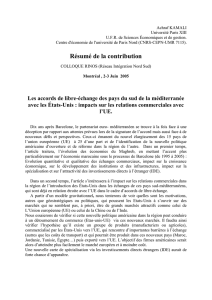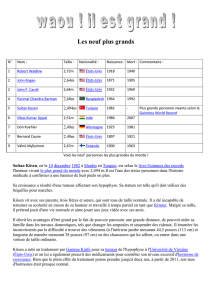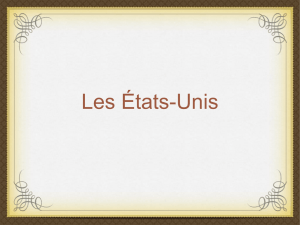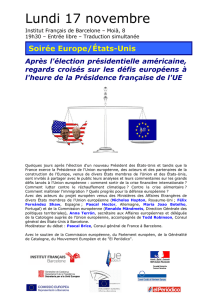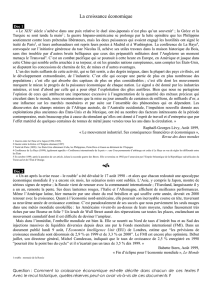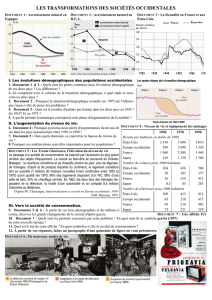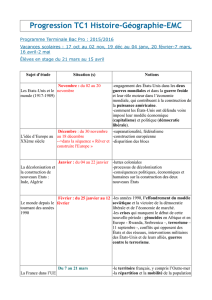Vente de la Louisiane - napoleon bonaparte | belgique

Vente de la Louisiane
La vente de la Louisiane (en anglais :Louisiana Pur-
chase « l'achat de la Louisiane ») est la cession par la
France de plus de 2 144 476 km2(529 911 680 acres) de
territoire aux États-Unis en 1803 au prix de 3 cents par
acre, soit plus de 15 millions de dollars[1] ou 80 millions
de francs au total[2].
Ce territoire représente 22,3 % de la superficie actuelle
des États-Unis. En effet, la colonie française de Louisiane
comprend beaucoup plus de territoires que l'État actuel
de Louisiane. Les territoires vendus incluent des parties
situées à l'ouest du fleuve Mississippi dans l'Arkansas, le
Missouri, l'Iowa, et le Minnesota actuels, des parties du
Dakota du Nord, le Dakota du Sud, le Nebraska, des par-
ties du Nouveau-Mexique, du nord du Texas, l'Oklahoma,
le Kansas, des portions du Montana, du Wyoming, et
la partie du Colorado située à l'est des montagnes Ro-
cheuses, des portions au sud du Manitoba, au sud de la
Saskatchewan et au sud de l'Alberta situées dans le bassin
fluvial du fleuve Missouri, et la Louisiane actuelle de part
et d'autre du Mississippi, incluant la ville de La Nouvelle-
Orléans.
Le territoire vendu dépasse les 2 millions de km2
1 Le préalable : l'achat secret de
Bonaparte en 1800
En cinq ans, la France a obtenu deux concessions
majeures de l'Espagne : la partie orientale de Saint-
Domingue, par le traité de Bâle (22 juillet 1795), et la
Louisiane, par le traité de San Ildefonso (1800). Les deux
traités, signés par un Empire espagnol en difficulté, ne
sont pas appliqués. L'Espagne a aussi cédé tout le nord
du Mississippi aux États-Unis en 1795, par souci de ne
États et territoires des États-Unis d'Amérique entre le 30 avril
1803 et le 27 mars 1804
pas se faire d'ennemi, car l'Angleterre convoite ses colo-
nies d'Amérique du Sud.
La France et l'Espagne sont alors toutes les deux fragi-
lisées, même si les Français ont obtenu des succès mili-
taires. Leurs empires coloniaux sont confrontés à des ré-
voltes, leurs gouvernements instables. Côté anglo-saxon,
la situation politique, clarifiée, facilite l'éclosion d'une in-
dustrie. Les succès des premiers entrepreneurs du coton
britannique dopent les cours du coton et la spéculation sur
les terres de l'Ouest des États-Unis.
En cédant la Louisiane à Bonaparte, l'Espagne espé-
rait reprendre les choses en main à Saint-Domingue,
mais c'est Toussaint Louverture qui agit le premier en
s’emparant de la partie orientale de l'île en janvier
1801, obligeant les planteurs espagnols à fuir vers Cuba.
L'expédition de Saint-Domingue, dont l'échec entraînera
le renoncement à la Louisiane, est un quitte ou double.
Elle est conçue comme une base d'approvisionnement en
bois et produits alimentaires, de Saint-Domingue qui pro-
duisait en 1789 la moitié du coton et du café mondial et
plus du tiers du sucre.
De plus, le contenu du traité secret de San Ildefonso a
transpiré, et le retour en force potentiel de la France dans
le Golfe du Mexique inquiète les Américains. Au point
que le pourtant francophile Jefferson déclare que si la
France prenait possession à nouveau de la Louisiane, il
n'aurait pas d'autre choix que de se jeter dans les bras de
l'Angleterre !
1

24 NOUVELLE IDÉE, PROPOSÉE PAR SAMUEL DU PONT DE NEMOURS : ACHETER TOUT LE TERRITOIRE À L'OUEST
2 Le contexte : la nouvelle vocation
du Mississippi
La Nouvelle-Orléans contrôle le fleuve Mississippi, qui
joue déjà un rôle important dans le transport des produits
agricoles entre les régions de l'ouest des Appalaches et
la côte est. Elle représente aussi un débouché potentiel
sur le golfe du Mexique, ce dont manque cruellement la
jeune république américaine. Grâce au traité de Madrid
(1795) conclu avec l'Espagne, les marchands américains
disposent déjà d'un « droit de dépôt » de leurs marchan-
dises, créant une zone franche de La Nouvelle-Orléans
Après l'armistice du 30 mars 1798, les réfugiés fran-
çais de Saint-Domingue en Amérique commencent à af-
fluer dans le Natchez District et à La Nouvelle-Orléans.
L'histoire de la culture du coton vient d'être bouleversée
par l'invention d'Éli Whitney, le cotton gin. Le négociant
Daniel Clark en fait la promotion auprès des planteurs du
Natchez District, dont la production quadruple en deux
ans[3].
Pour tenter d'attirer les colons français, Daniel Clark et
les Espagnols activent en 1798 la zone franche de La
Nouvelle-Orléans. Mais la majorité des colons, anglo-
phone, arrivée dans les années 1788 à 1790, aspire à une
situation politique stable, sur fond de spéculations sur le
traité de San Ildefonso, resté secret : la Louisiane reste
entre les mains espagnoles jusqu'à une prise de posses-
sion par les Français qui reste à organiser. Le président
Thomas Jefferson estime que la meilleure façon d'assurer
l'accès au Mississippi est d'acheter La Nouvelle-Orléans :
il envoie Robert Livingston et James Monroe àParis pour
en négocier l'achat.
3 Première mission pour Living-
ston, pris par une autre affaire :
acheter seulement La Nouvelle-
Orléans
La première mission des deux envoyés est d'acheter seule-
ment La Nouvelle-Orléans. Mais ils essuient un refus
français.
Robert Livingston est par ailleurs associé, à titre privé, à
un contrat d'approvisionnement des 35 000 soldats fran-
çais de l'expédition de Saint-Domingue[4] par une entre-
prise basée à Wilmington, dans le Delaware, qui vient
d'être fondée par Eleuthère Irénée du Pont de Nemours
et son père Pierre Samuel du Pont de Nemours, qui de-
viendra la multinationale DuPont. Le principal financier
est Pierre de Bauduy de Bellevue, dont le frère, Louis
Alexandre Amélie Bauduy, est capitaine dans l'expédition
de Saint-Domingue.
Le consul de France à Washington,Louis-André Pichon,
y voit un conflit d'intérêt manifeste : en cas de réussite
La Louisiane française vue par les États-Unis
de l'expédition de Saint-Domingue, Napoléon sera moins
enclin à la vente de la Louisiane. Les actifs de la socié-
té sont transférés à sa branche parisienne et une nouvelle
société créé par l'autre fils, Victor du Pont de Nemours,
pour exécuter le contrat. Le père, Pierre Samuel du Pont
de Nemours se concentre sur ses talents de diplomate.
4 Nouvelle idée, proposée par Sa-
muel du Pont de Nemours : ache-
ter tout le territoire à l'ouest
Résident aux États-Unis, Pierre Samuel du Pont de Ne-
mours est en étroites relations avec le président Thomas
Jefferson, qui l'autorise à se lancer dans une diplomatie
parallèle avec Bonaparte, que Nemours rencontre lors de
son voyage en France en 1802. C'est lui qui propose à
Bonaparte une transaction beaucoup plus importante : cé-
der aux États-Unis toute la Louisiane, y compris les im-
menses territoires de l'ouest.
Jefferson affiche une certaine méfiance pour cette idée :
acheter toute la Louisiane implique de reconnaître à la
France des droits sur l'ouest du continent. Il précise que
les présidents ne sont pas compétents pour une telle né-
gociation, car ce n'est pas spécifié dans la constitution.
Côté français, Talleyrand est aussi très hostile à ce pro-
jet, qui selon lui réduirait à néant les plans français de
colonisation de l'Amérique du Nord.
Mais l'idée de doubler la taille du pays séduit quand même
Thomas Jefferson, qui est aussi une figure de ce qu'on

3
appelle le parti français à Washington, et dont la nou-
velle clientèle électorale est au sud et à l'ouest. Coloniser
l'ouest des États-Unis, y développer la culture du coton,
est susceptible de donner une majorité durable au parti
républicain, plus favorable à l'esclavage et à la conquête
de l'Ouest, alors que les fédéralistes tablent plutôt sur
l'industrialisation de la Nouvelle-Angleterre, leur bastion
électoral.
Bonaparte va présenter la vente de toute la Louisiane
comme un geste de bonne volonté à l'égard des Amé-
ricains, dans une stratégie d'encerclement du Royaume-
Uni. Les historiens jugent probable qu'il ait ainsi ten-
té de les encourager à participer au Blocus continental.
Bonaparte craint que la Grande-Bretagne, maîtresse des
mers, ne profite d'un conflit en Europe pour s’emparer
de la Louisiane et accroître ainsi sa puissance. Vendre la
Louisiane aux États-Unis est le moyen de couper l'herbe
sous le pied aux Anglais. Bonaparte fait aussi valoir aux
Américains que l'accord leur permet d'éviter de s’impli-
quer dans le conflit franco-britannique.
Le parti français à Washington de Thomas Jefferson est
sensible à ces arguments, dans la ligne défendue dans les
années 1790 pour prendre ses distances avec l'Angleterre,
préoccupation politique qui est à la racine de la théorie de
la destinée manifeste et de la conquête de l'Ouest, même
s’il est encore trop tôt pour en faire un thème officiel de
campagne électorale.
Durant toute cette période, les services secrets américains
tiennent Thomas Jefferson au courant des activités mili-
taires de Bonaparte. Le président américain axe sa stra-
tégie sur la ruse : donner à Pierre Samuel du Pont de Ne-
mours des informations que Robert Livingston ignore. In-
tentionnellement, il leur donne deux instructions contra-
dictoires. L'un de ses coups les plus habiles est d'envoyer à
nouveau James Monroe à Paris en 1803. Monroe avait été
déclaré officiellement persona non grata lors de sa précé-
dente mission à Paris, mais Thomas Jefferson le choisit à
nouveau, pour signifier qu'il veut être pris au sérieux.
5 L'opposition des fédéralistes,
dans les régions industrielles du
nord-est
Battus lors de l'élection présidentielle américaine de
1800, les fédéralistes s’opposent à l'achat de la Louisiane,
marquant leur préférence pour un rapprochement avec le
Royaume-Uni, même s’ils veulent lui imposer des droits
de douane. Par la convention commerciale tripartite de
1799, soutenant Toussaint Louverture, ils s’étaient fâ-
chés avec le puissant lobby colonial français, qui entoure
Bonaparte et l'aide dans son ascension. Ce soutien à la
première révolution noire a aussi révulsé les grands plan-
teurs blancs du sud des États-Unis, qui entourent Thomas
Jefferson.
L'opposition des fédéralistes américains relève de la
crainte de voir les États-Unis changer de nature, moins de
vingt ans après leur création, en développant à l'ouest et
au sud une économie de plantation, basée sur des cultures
de rente, dépendantes de l'exportation et du maintien de
l'esclavagisme. La Nouvelle-Angleterre, bastion des so-
ciétés abolitionnistes et des fédéralistes table plutôt sur
une industrialisation, protégée par des barrières doua-
nières, et susceptible de diminuer la dépendance aux im-
portations. Étendre le territoire à l'ouest serait faire bas-
culer la majorité du pays au profit des grands planteurs du
sud. Les racines de tous les conflits qui suivront et amè-
neront la guerre de Sécession sont déjà là.
Pour les fédéralistes, l'achat est par ailleurs anticons-
titutionnel, et cette énorme dépense n'éviterait pas un
conflit avec l'Espagne. Un groupe de fédéralistes mené
par le sénateur Timothy Pickering avance même l'idée
d'une confédération du Nord et en propose la présidence
au vice-président Aaron Burr, pourvu que New York se
joigne à la sécession.Alexander Hamilton, s’oppose aussi
à l'achat. L'hostilité entre Burr et lui, qui s’accroît encore
lors des élections de 1801, aboutit au duel au cours duquel
il perd la vie.
6 Bonaparte confronté à une nou-
velle donne dans la Caraïbe
Dès mars 1802 l'expédition de Saint-Domingue, souffre
de l'opposition des généraux français de la Colonie et
de difficultés d'approvisionnement. Le corps expédition-
naire commandé par le capitaine-général Charles Leclerc,
beau-frère de Bonaparte, est plus que décimé par la fièvre
jaune. Fin mars, il a déjà perdu 5 000 hommes. Le main-
tien de l'esclavage dans les colonies restituées par la paix
d'Amiens, du 30 floréal an X, 20 mai 1802, fait craindre
un retour de l'esclavage à Saint-Domingue qui n'était pas
concerné par ce traité, et fait basculer la population dans
une opposition définitive au corps expéditionnaire.
Privé de moyens militaires en Amérique, Bonaparte af-
fiche une nouvelle motivation : il recherche la paix avec
le Royaume-Uni pour prendre possession de la Louisiane
avant que les Britanniques ne s’en emparent. Mais le
Royaume-Uni rompt sa promesse de la paix d'Amiens,
d'évacuer Malte au plus tard en septembre 1802. Dé-
but 1803 la reprise du conflit franco-britannique semble
probable. Le 11 mars 1803, Bonaparte change même de
stratégie : il fait construire une flottille en prévision de
l'invasion du Royaume-Uni.
Ces rebondissements le conduisent finalement à abandon-
ner ses projets d'empire français au Nouveau Monde : le
11 avril 1803, le ministre français du trésor, le marquis
de Barbé-Marbois, propose, cette fois officiellement, à
Robert Livingston la vente non pas de la seule Nouvelle-
Orléans mais de toute la Louisiane, depuis le golfe du
Mexique jusqu'à la Terre de Rupert, et du Mississippi aux

48 POUR RALLIER LA NOUVELLE-ANGLETERRE, RÉPARER LES DOMMAGES CAUSÉS PAR LES PIRATES FRANÇAIS
Rocheuses.
Le traité original de la vente de la Louisiane, conservé aux
National Archives àWashington DC.
Les négociateurs officiels des États-Unis se disent aba-
sourdis par la proposition française : doubler la surface
du territoire des États-Unis, pour 15 millions de dollars,
soit onze fois plus que la transaction envisagée, deux mil-
lions de dollars pour la seule Nouvelle-Orléans. Avec un
prix du kilomètre carré de seulement 7 dollars (ou 3 cents
par acre). Mais James Monroe et Robert Livingston re-
connaissent là une chance historique.
Sur les 80 millions de francs (15 millions de dollars)
de vente de la Louisiane, 20 millions sont réservés au
compte personnel de Talleyrand (ministre des Affaires
étrangères). Et pour payer les 15 millions de dollars en
une fois à Napoléon, désireux de financer sa guerre contre
l’Angleterre, les Américains doivent les emprunter à un
taux de 6 % à la Barings, une banque… anglaise [5] !
7 L'émotion créée par le blocus
surprise du Mississippi en 1802
Entre-temps, une coalition d'intérêts américains favo-
rable à l'opération s’est mise en place. Le 16 juin 1802,
Juan Ventura Morales, l'intendant espagnol, déclare son
intention de suspendre la zone franche de La Nouvelle-
Orléans. L'ambassadeur de France à Washington Louis-
André Pichon (1771-1850) écrit au gouvernement amé-
ricain pour tenter de le rassurer, mais le 1er octobre,
l'intendant espagnol confirme que la zone franche est
suspendue[6], déclenchant la colère des colons, puis des
campagnes de presse enflammées[6]. La polémique donne
des arguments au parti républicain de Thomas Jefferson,
arrivé au pouvoir lors de l'élection présidentielle améri-
caine de 1800[6].
Thomas Jefferson déclara dans un message du 22 dé-
cembre 1802 à la Chambre des représentants qu'il fal-
lait garantir ce droit par « les moyens honorables et justes
qui convenaient au caractère des États-Unis ». On ignorait
alors si la France ne prétendrait pas assigner de nouvelles
frontières à sa province, et faire revivre d'anciens titres
contraires aux traités et aux intérêts des États-Unis[7].
L'historien américain Arthur P. Whitaker[6] estime que
la décision de fermer la zone franche a en réalité été
prise au plus haut niveau, par le président Thomas Jef-
ferson lui-même, pour faciliter la vente de la Loui-
siane, les États-Unis ayant obtenu au même moment la
réparation aux dégâts des pirates français, par Napoléon,
qui prend conscience des handicaps de l'expédition de
Saint-Domingue, mais ne peut pas lâcher immédiatement
son propre beau-frère, déjà en difficulté.
8 Pour rallier la Nouvelle-
Angleterre, réparer les dom-
mages causés par les pirates
français
Pour décider les Américains, il faut vaincre les résistances
des marchands, banquiers et armateurs de la côte est, plu-
tôt proche des fédéralistes. Les Français font alors une
proposition supplémentaire : signer un grand contrat de
Réparation aux dégâts des pirates français, pour 20 mil-
lions de francs, soit le tiers du montant retiré par la France
de la vente de la Louisiane, somme qui bénéficiera à
l'élite commerçante de la côte est, jusqu'alors opposée
aux Français, car elle commerce avec Saint-Domingue,
en bénéficiant de la convention commerciale tripartite de
1799.
Ce type de réparation financière était envisagé, mais de
façon floue, par le traité de Mortefontaine, signé trois ans
avant, en 1800, pour tenter de mettre fin à la quasi-guerre,
appelée aussi « guerre des pirates », entre les corsaires
français et les navires de commerce américains appro-
visionnant l'île de Saint-Domingue[8] lors de l'armistice
du 30 mars 1798. Selon le consul américain à Saint-
Domingue,Edward Stevens : « quelques 1 500 « pi-
rates » embarqués sur trente-sept pinasses[9] attaquaient
les bâtiments marchands américains se rendant à Saint-
Domingue ». Ces corsaires sont à l'origine de la piraterie
des années 1800 dans la Caraïbe, qui vit de grands aven-
turiers comme Jean Lafitte ou Louis-Michel Aury devenir

5
célèbres.
Les réparations des dommages causés par les corsaires
français sont à sens unique, alors que le traité de Morte-
fontaine prévoyait des compensations réciproques. Elles
comptent symboliquement pour les marchands et arma-
teurs de la côte est, car les États-Unis n'ont pas de marine
nationale, ce qui a conduit le 27 avril 1798 le congrès à
voter des crédits militaires pour acquérir six frégates des-
tinées à protéger les navires de commerce battant pavillon
des États-Unis tant contre les corsaires français que contre
la piraterie du dey d'Alger et du bey de Tripoli.
9 La signature du traité, soulage-
ment pour Bonaparte et endette-
ment des États-Unis
La bannière étoilée des États-Unis remplace le drapeau de la
France sur la Place d'Armes de la Nouvelle-Orléans.
La vente de la Louisiane est financée par la banque
Barings via deux conventions financières qui se com-
pensent partiellement. La première, du 30 avril 1803,
organise le paiement de 60 millions de francs (11 250
000 dollars). La seconde dédommage pour 20 millions
de francs (3 750 000 dollars) les citoyens américains vic-
times des corsaires français, par la perte de vaisseaux ou
de cargaisons lors de la quasi-guerre entre 1798 et 1800,
dans l'esprit du traité de Mortefontaine.
Plaque commémorative de la signature du traité à Paris.
Cette manne permettra à Bonaparte devenu l'empereur
Napoléon Ier de lever des troupes importantes, pour ac-
quérir dans les années 1805-1807 la suprématie sur la ma-
jeure partie de l'Europe, l'Autriche et la Prusse étant bat-
tues.
Le 30 avril 1803, le traité est signé à Paris par Robert Li-
vingston, James Monroe, Barbé Marbois et Michael Ryan
Toussaint. Ce traité est signé sans consulter l'Assemblée
nationale, qui aurait refusé une telle perte pour la France.
Selon la Constitution française, la vente de propriétés
d'ordre national nécessitait l'approbation de l'Assemblée
Nationale[réf. nécessaire], ce que Napoléon n'a pas sollici-
té. Il se dépêcha de vendre avant que l'assemblée s’en
rende compte. Les frères de Napoléon, Lucien et Joseph,
étaient si indignés de cette vente qu'ils ont eu une sé-
rieuse confrontation avec Napoléon lorsqu'il prenait son
bain aux Tuileries. Napoléon leur a dit qu'il se moquait de
la constitution française ou de l'assemblée des députés. Il
se leva de son bain furieux, lança une boîte de tabac par
terre, et dit à ses frères qu'il les écraserait comme cette
boîte de tabac s’ils osaient questionner son jugement à
nouveau. [réf. nécessaire]
Les États-Unis ratifient le traité le 20 octobre[10] et, le 31
octobre, autorisent le président Jefferson à prendre pos-
session du territoire et à y établir un gouvernement mi-
litaire provisoire. On décide également d'organiser une
mission d'exploration et de cartographie : l'expédition Le-
wis et Clark.
Le 30 novembre 1803, la France prend officielle-
ment possession de la Louisiane après rétrocession des
Espagnols[11]. Puis la France remet La Nouvelle-Orléans
aux États-Unis le 20 décembre 1803[12]. Les lois du 31
octobre 1803 établissent la continuité de l'administration
locale civile en prolongeant les usages acquis durant les
périodes de souverainetés française et espagnole et auto-
risent le président à utiliser l'armée pour le maintien de
l'ordre.
Les 9 mars 1804 et 10 mars 1804, une cérémonie for-
melle dénommée Journée des trois drapeaux, est conduite
 6
6
 7
7
 8
8
1
/
8
100%