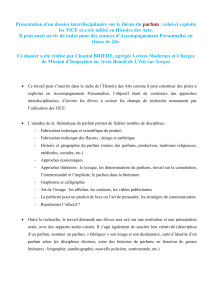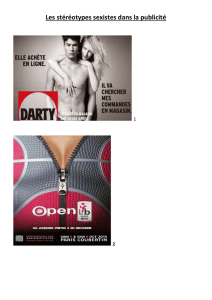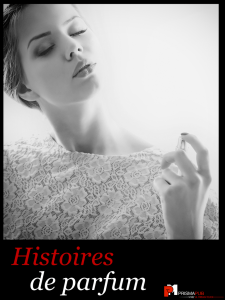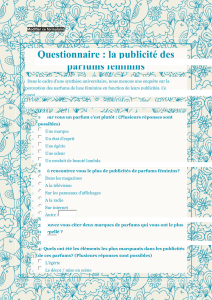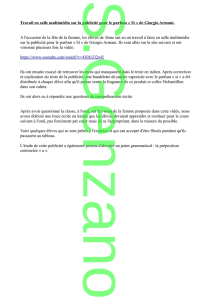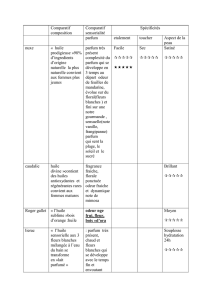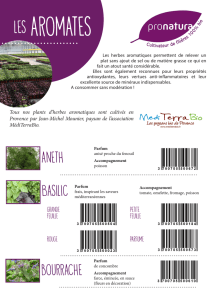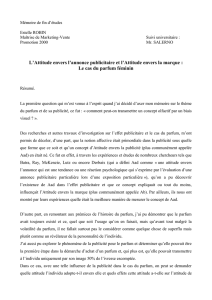documentation pédagogique - Musée Royal de Mariemont

Documentation pédagogique
P
ARFUMS
DE
L
’
ANTIQUITÉ
LA ROSE ET L’ENCENS EN
MÉDITERRANÉE
Musée royal de Mariemont
B-7140 Morlanwelz
064 21 21 93
www.musee-mariemont.be
Exposition ouverte tous les jours
(sauf les lundis non fériés)
7 juin - 30 novembre 2008

Parfums de l’Antiquité
La rose et l’encens en Méditerranée
Exposition 7 juin – 30 novembre 2008
Commissaires de l’exposition: Annie Verbank-Piérard (Musée royal de Mariemont) et Nata-
cha Massar (Musées royaux d’Art et d’Histoire, Bruxelles)
Exposition ouverte tous les jours, sauf les lundis non fériés, de 10h à 18h de juin à septem-
bre et de 10h à 17h d’octobre à novembre.
Entrée : 4€ tarif plein (3€ senior, 2€ étudiant)
Couronnes fleuries, huiles capiteuses, fumées entêtantes de l’encens,… Dans l’An-
tiquité classique, comme dans le monde d’aujourd’hui, les parfums accompagnent
tous les moments de la vie et laissent dans leur sillage un rêve de luxe et de séduc-
tion. Or les parfums antiques, tant célébrés par les textes, par les images, et bien
attestés par des flacons aux formes élégantes retrouvés par milliers, n’ont guère
été étudiés si ce n’est dans des travaux ponctuels.
L’exposition inédite du Musée royal de Mariemont a donc l’ambition de présenter un
bilan des connaissances sur ce produit d’une richesse incomparable mais difficile à
saisir et qui, jusqu’ici, n’a jamais fait l’objet d’une présentation au public. Toute la
chaîne de vie du parfum est évoquée, depuis sa fabrication jusqu’aux contextes
d’utilisation : gymnases et banquets, marchés et habitats, fêtes et funérailles...
Cette exposition rend compte de la diversité des pratiques sociales, médicales, reli-
gieuses, qui régissent les « gestes du parfum » dans l’Antiquité et qui témoignent
des structures et de l’imaginaire des sociétés classiques.
Emportant le visiteur dans une promenade odorante de la Grèce et des rives
orientales de la Méditerranée jusqu’en Etrurie et en Gaule, en passant par
Athènes, Alexandrie ou Rome, elle révèle les pouvoirs et les mystères des
senteurs antiques.
Bien plus qu’un plaisir futile et éphémère, cette approche novatrice des parfums an-
tiques permet de redécouvrir le sens profond de leurs arômes : l’espoir de l’éter-
nelle jeunesse et le bonheur de vivre. Sentir l’Antiquité est peut-être l’une des meil-
leures façons de l’approcher.
L’exposition bénéficie de la collaboration internationale de nombreux chercheurs et
fait appel à de grands musées européens. Elle est accompagnée d’un catalogue
scientifique très complet et superbement illustré.
Résumé du parcours de l’exposition
Introduction
L’introduction est consacrée à une première présentation des principes de base de
la parfumerie antique : l’environnement de plantes fraîches et d’aromates, les par-
fums huileux, les résines (encens) qui se consument en fumées odorantes. A partir
de recettes transmises par divers auteurs, on peut déterminer les ingrédients et les
manipulations requises pour la fabrication d’huiles parfumées. Ces textes permet-
tent de reconstituer la fonction des diverses composantes, mais également d’évo-
quer les goûts et les modes antiques en matière de senteurs. Par ailleurs, les ana-
lyses chimiques contemporaines aident à déceler et redécouvrir certains des pro-
duits utilisés.
Bref prologue : les traditions à l’âge du bronze
Dans les cultures de l’âge du bronze en Méditerranée orientale, la production et l’u-
tilisation des parfums sont déjà bien développées, et de mieux en mieux connues
des chercheurs modernes. Après un rappel général des traditions attestées en
Egypte et à Chypre, l’accent sera mis brièvement sur le monde mycénien.
1. De la Grèce de l’Est à l’Etrurie archaïque et classique
Dans le monde grec historique, la première mention d’huile parfumée (à la rose) se
trouve dans les poèmes homériques, où elle a fonction d’onguent protecteur. Dès le
7e siècle et surtout au 6e siècle av. J.-C., les cités du monde grec , en particulier
dans certaines îles (Rhodes, Samos, Chypre), ont développé une gamme de vases
à parfums qui s’inspirent de représentations, parfois de matériaux, venus d’ailleurs,
Égypte ou Perse. Ces objets en céramique ou en faïence, aux symboliques évoca-
trices (sirène, guerrier, lièvre…), trouvés dans les tombes locales, seront également
exportés vers l’Ouest, pour eux-mêmes ou pour leur contenu. Ces vases, et ceux
produits à Corinthe, ont été retrouvés en grand nombre en Etrurie. Notre regard se
portera dès lors vers l’Italie : quels usages les Etrusques ont-ils fait des parfums ou
des encensoirs? Les peintures funéraires étrusques, les reliefs ou les terres cuites
permettent de mettre en évidence certaines croyances, certains gestes associés
aux odeurs agréables dans cette culture.
2. Athènes archaïque et classique
Les parfums et l’encens sont d’un usage fréquent dans le monde grec. Pour abor-
der les époques archaïque et classique, nous nous arrêtons à Athènes où l’abon-
dance des sources permet de rendre compte des pratiques dans un certain détail.
Que ce soit les hommes et les jeunes gens, au gymnase et lors de jeux de séduc-
tion, ou les femmes et les jeunes filles, au gynécée et à l’agora, tous les Athéniens
font usage de fragrances pour se mettre en valeur. Les parfums représentent un
ingrédient essentiel de la cérémonie de mariage. Les images et les objets révèlent
également la place importante des vases à parfum lors des rites funéraires. L’en-
cens est utilisé dans de nombreuses cérémonies, lors de rituels publics et privés.
Les mythes viennent préciser les nombreuses valeurs symboliques des senteurs.
Enfin, les images et les textes permettent d’évoquer concrètement la boutique du
parfumeur, les gestes qu’on y accomplit, et les conversations qui s’y déroulent.

3. Le 4e siècle et la Méditerranée hellénistique
Le 4e siècle est une période de grand épanouissement en Grèce et en Italie du
Sud. Les usages du parfum et de l’encens y sontévoqués à travers la peinture sur
vases et les objets. Les pratiques cultuelles des cités de Grande Grèce sont tout
particulièrement mises en évidence. L’époque hellénistique, marquée par un élar-
gissement significatif du monde grec vers l’Orient, voit l’ouverture de nouvelles rou-
tes commerciales vers des régions productrices de denrées exotiques, comme la
cannelle. De nombreux usages du parfum et de l’encens déjà mis en évidence per-
sistent à l’époque hellénistique, mais s’expriment d’autres manières, selon des mo-
des et des goûts nouveaux. Si l’on ne trouve plus guère de représentations sur va-
ses, en revanche les statuettes en terre cuite connaissent un énorme succès, évo-
quant par un autre biais les pratiques et les croyances. Les parfums et les couron-
nes, toujours utilisés au banquet, font dorénavant l’objet d’études savantes. Des
médecins consacrent des traités à leur usage thérapeutique. Des fouilles récentes
à Délos, à Paestum et à Pompéi, ont révélé les vestiges d’ateliers de parfumeurs.
Les trouvailles de Délos, plus particulièrement, permettent de reconstituer le cadre
de travail de ces artisans. Les couronnes de fleurs et de feuilles fraîches sont sour-
ces de fragrances délicieuses et leur fabrication est une activité modeste mais in-
dispensable à travers toute l’Antiquité.
4. L’époque impériale : Rome et les provinces
La Rome impériale rassemble tous les produits du monde et l’étalage de luxe y de-
vient monnaie courante. Les parfums, surtout ceux aux odeurs exotiques, permet-
tent de participer à cette surenchère ; les contenants, dans des matières toujours
plus luxueuses, signalent le prix de leur contenu. Des techniques nouvelles modi-
fient également l’aspect des vases à parfum les plus répandus : le verre soufflé
supplante dorénavant la céramique. Si certains usages persistent à travers le
temps et l’espace (le rôle du parfum dans la séduction, par exemple), certaines pra-
tiques spécifiques du monde romain, comme les bains publics et privés, connais-
sent un développement considérable. Les thermes allient l’utile à l’agréable et les
huiles parfumées y trouvent tout naturellement leur place. L’encens est toujours
omniprésent dans le culte et pour les funérailles. Les végétaux accompagnent éga-
lement le sacrifice et ornent l’autel sous forme de guirlandes ou de rameaux. Pour
l’évocation des provinces, c’est la Gaule romaine, en particulier la cité des Tongres,
qui est mise en évidence.
L’héritage
Le monde romain voit la naissance de la religion chrétienne qui adopte ou rejette
certaines des pratiques païennes, comme en attestent les présents des rois mages
et l’usage cultuel des brûle-encens.
Thèmes intéressants à développer dans l’exposition
▫ La fabrication des parfums dans l’Antiquité classique : les matières premiè-
res, les techniques de fabrication (enfleurage à froid, enfleurage à chaud).
▫ Les contenants : les différentes formes de « vases » à parfum, l’évolution de ces
formes au cours des siècles, les matières utilisées pour leur fabrication (céramique,
métal, verre).
▫ Les sources d’information : - les sources littéraires : Théophraste (4
e
siècle
av. J.-C.) et son traité « des Odeurs », Pline l’An-
cien (1
er
siècle de notre ère) et son « Histoire na-
turelle », Dioscoride (1
er
siècle de notre ère) et le
« De materia medica »
- les représentations
- les découvertes archéologiques : les analyses
des résidus anciens conservés dans les objets
archéologiques
▫ Les antécédents : le parfum en Egypte, en Étrurie, en Grèce archaïque
▫ Le monde des hommes : l’utilisation du parfum et des substances parfumées au
gymnase, au banquet
▫ Le monde des femmes : l’utilisation du parfum et des substances parfumées
dans le gynécée
▫ Le monde cultuel et funéraire : l’utilisation du parfum dans les cérémonies reli-
gieuses et funéraires dans le monde égyptien, grec, romain et gallo-romain
▫ L’importance des couronnes : dans les banquets, les cérémonies religieuses…
▫ Parfumerie, médecine et pharmacopée
▫ Le rôle et l’importance des parfums aux cours des siècles dans le monde
grec et romain : évolution, parallélismes et différences selon les civilisations
(Egypte, Grèce Rome)
▫ Le parfumeur et son atelier : le métier du parfumeur, sa boutique, la vente à l’a-
gora
▫ Le parfum dans la mythologie : Aphrodite et Adonis, quelques métamorphoses
en plantes, arbres ou fleurs : Narcisse, Lotis, Hyacinthe, Dryopé, Myrrha… ou en-
core Phaon
▫ Le parfum dans le monde romain : les thermes, les jardins d’agrément, le
culte…
▫ L’héritage de l’Antiquité dans le culte chrétien

Visites guidées de l’exposition dans le cadre scolaire
•
pour l’enseignement fondamental :
-un parcours dans l’exposition : des objets à observer, comparer, … comprendre
-un atelier au choix : ♦ Jardin de papier : une simple feuille de papier se transforme
en jardin en 3D, investie par les feuillages.
♦ Odorama : jeu d’association d’odeurs, de goûts et d’images.
•
pour l’enseignement secondaire
La visite guidée (1h30 à 2h) se fonde sur une « feuille de route », support pédagogique définissant
un parcours dans l’exposition. Les objets conservés constituent un corpus documentaire mobilisant
observation, analyse, réflexion.
Possibilité de combiner plusieurs modules au choix :
-parcours chronologique, du 2ème millénaire avant J.-C. aux prémisses de l’ère chrétienne
-monde des hommes/monde des femmes : espace privé/ espace public, égalité des sexes ?
-les échanges en Méditerranée : idées, savoir-faire, matières premières ... vers une mondialisation ?
-l’hygiène : du gymnase aux thermes en passant par le gynécée
-les auteurs grecs et latins : sociologie et mythologie du parfum
-les rapports entre formes et fonctions de vase : question de design ?
Atelier olfactif
à partir de 9 ans
Olivier Kummer, parfumeur, explore les matières premières olfactives qui ont joué un rôle dans la vie
sacrée ou profane de l’Antiquité.
Prix : Visite guidée : 75 euros + 2 euros / élève (entrée exposition)
Atelier olfactif : 125 euros
Possibilité de combiner visite et atelier olfactif sur une journée : 200€
Renseignements :
Service pédagogique : 064 27 37 84 - 064 27 37 72
Chaussée de Mariemont, 100 7140 Morlanwelz

Outil 1 : Au fil de la visite, rencontre des compétences ….
A. Enseignement fondamental
Matière
Compétences
Exemples d’exploitation au cours de la
visite et/ou en classe
Education
plastique
S’ouvrir au monde
visuel pour percevoir,
s’approprier des
langages et
s’exprimer
• Découvrir des formes, des couleurs et des
techniques nouvelles, se questionner sur le
lien entre fonction et forme d’un objet, les
raisons qui ont poussé l’artiste à choisir
telle ou telle voie.
• Tirer parti des rencontres esthétiques :
modeler en classe un objet tridimensionnel
à partir d’un souvenir de l’exposition, d’une
photographie, d’un croquis pris sur place…
Eveil historique
L’enfant structure le
temps
• Replacer sur la ligne du temps différents
objets vus dans l’exposition, situer dans le
temps les civilisations égyptienne, grecque,
romaine…et comparer les données avec ce
qui se déroule au même moment ailleurs
(par exemple dans nos régions).
• Aborder le thème de l’arrivée des Romains
dans nos régions à travers des usages, des
objets et des produits qui voyagent de
Rome vers chez nous et rencontrer des
situations similaires avec d’autres
civilisations. Qu’en est-il aujourd’hui ?
• Lire des traces du passé à travers des
documents de natures diverses sur un
même sujet, les identifier et les classer en
fonction de leur nature : objet
archéologique, reconstitution, textes
antiques, odeur, document audiovisuel,
document iconographique, analyses
chimiques…
• Découvrir le mode de vie des gens à une
époque déterminée : les représentations de
la vie quotidienne des Grecs sur les vases,
les formes, le contexte dans lequel ils ont
été retrouvés… nous permettent de récolter
des informations sur leur vie quotidienne et
leur organisation sociale.
Eveil scientifique
L’enfant découvre les
végétaux
• Découvrir des différentes parties de la
plante à partir de l’utilisation de celles-ci
dans les recettes de parfums antiques
(feuille, pistil, racine, rhizome, résine,…)
•
Elaborer un tableau collectif des végétaux
(à partir des végétaux présentés dans
l’exposition ou de végétaux régionaux
choisis pour leur parfum).
L’enfant découvre le
rôle des organes des
sens
• Travailler sur la perception par l’odorat,
reconnaître les odeurs habituelles ou non,
établir des relations entres images,
souvenirs et odeurs, identification d’une
senteur sans l’aide d’autres sens,
notamment par l’atelier Odorama qui
complète la visite.
• Se questionner sur la signification des
bonnes/mauvaises odeurs dans notre vie et
les comparer avec celles que côtoyaient les
hommes de l’Antiquité, établir le « paysage
olfactif » d’une journée de la vie
quotidienne.
Langue française
Savoir lire
Orienter sa lecture en
fonction de la
situation de
communication
• Préparer un dossier de lecture sur le thème
de la vie quotidienne chez les Grecs.
• Rassembler de la documentation en vue de
faire un exposé sur l’histoire du parfum :
qu’en est-il du parfum aux époques
postérieures ? Et aujourd’hui ?
Savoir écrire
Elaborer des
contenus
• Raconter par écrit l’origine mythologique
d’une plante ou d’un animal sur le modèle
du mythe d’Adonis évoqué dans
l’exposition.
• Inventer des dialogues entre les
personnages de scènes représentées sur
les vases.
• Choisir un objet et le faire parler, raconter
son histoire passée et présente.
• Créer des « portraits chinois » d’une odeur,
intégrer l’élément olfactif dans un poème ou
un récit narratif, une description.
 6
6
 7
7
 8
8
 9
9
 10
10
 11
11
 12
12
 13
13
 14
14
1
/
14
100%