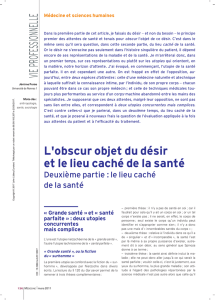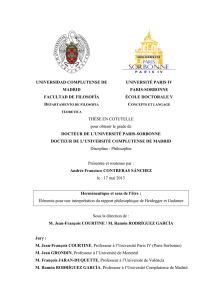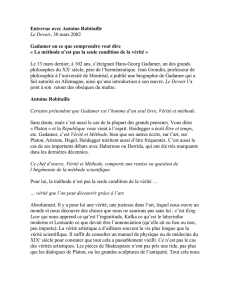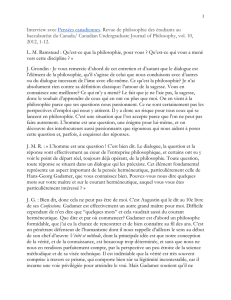L'être comme langage chez Gadamer : herméneutique et tournant linguistique
Telechargé par
bambala72

1
L’être comme langage chez H.-G. Gadamer, dans Pensée agissante, vol.30, n°54,
Kinshasa, juillet-décembre 2022, p.189-204.
INTRODUCTION
L’être susceptible d’être compris est langage
1
. La question de l’être a toujours
été au centre de la réflexion philosophique. Elle change de formulation avec les
courants de pensée, mais reste toujours présente. Dans l’antiquité grecque, Platon par
exemple, l’assimile dans Phédon à l’Idée, à l’Etre en soi, à l’intelligible
2
. Les
Médiévaux eux aussi vont construire leur métaphysique en gardant la question de l’être
au centre de leur réflexion. C’est ce qui ressort de la Somme théologique de Saint-
Augustin
3
. Avec les modernes, qui mettent en exergue la raison, la question de l’être
est posée autrement. Pour eux, c’est la raison qui est au centre de la réflexion
philosophique.
Du côté des contemporains, influencés par le tournant linguistique, la question
de l’être est supplantée par celle du langage. C’est dans ce dernier contexte qu’il faut
situer Gadamer pour qui « l’être susceptible d’être compris est langage »
4
que nous
allons commenter dans cet article. Dans une démarche d’interprétation ou de recherche
de sens de compréhension des textes, la lecture de quelques textes de Gadamer nous
permet de dégager l’idée qui fonde le rapport entre langage et compréhension pour
arriver à celle qui définit l’être comme langage.
Dans ce texte, nous exposons l’idée de Gadamer en trois parties. La première
aborde
le Tournant linguistique et situe l’adage que nous explorons dans le contexte
de son auteur. La deuxième présente l’appréhension que cet auteur fait du langage dans
son herméneutique. La dernière rapporte le langage à l’être chez le même auteur.
I. LE TOURNANT LINGUISTIQUE
Grondin, parlant du sens de cet adage selon lequel l’être qui peux être compris
est langue, dit « qu’on peut y voir tantôt une thèse sur notre compréhension, tantôt une
1
H-G. GADAMER, Vérité et Méthode. Les grandes lignes d’une herméneutique philosophique, Paris,
Seuil, 1996, p. 500.
2
Cf. PLATON, Phédon, Paris, Flammarion, 1991, 65d, 75d, 78d, 92d.
3
THOMAS D’AQUIN, Somme théologique, t.1., Paris, Cerf, 1984, I, q. 5, a. 1.
4
H-G. GADAMER, Vérité et Méthode. Les grandes lignes d’une herméneutique philosophique, Paris,
Seuil, 1996, p. 500.

2
thèse sur l’être lui-même »
5
. Avec le premier sens, l’être épouse nécessairement une
forme langagière. La thèse de Gadamer, loin d’être une intuition personnelle, s’inscrit
dans le tournant linguistique marqué par la place centrale qu’occupe le langage dans
la réflexion philosophique contemporaine. Il se différencie de la tradition antique et
médiévale centrée essentiellement sur la question de l’être.
En effet, le centre d’intérêt de la recherche philosophique tourne autour de trois
principales thématiques. Ces thématiques sont relevées par Jean Onaotsho pour qui, «
Une lecture paradigmatique de l’histoire de la pensée permet de répartir la production
philosophique occidentale en trois axes, trois centres d’intérêts particulièrement
marqués par l’affairement de la réflexion autour de la question de l’être, de la raison
et du langage »
6
. Le premier centre d’intérêt identifie l’être comme le paradigme
ontologique tandis que le deuxième met en exergue la raison ou le paradigme de la
philosophie de la conscience (sujet) et le troisième centralise le langage ou le
paradigme de la philosophie de l’intersubjectivité. Ainsi, Être, raison (conscience),
langage, apparaissent comme trois axes, ou trois paradigmes distincts.
Cet auteur relève que le paradigme ontologique a surtout été développé par
Aristote et ses épigones tandis que l’être comme raison par Descartes, Kant et les
Lumières. À la suite de ces penseurs, il ressort que le tournant le plus caractéristique
de la philosophie de notre temps, concentre ses investigations sur le langage et « pose
le primat du langage désormais entendu non plus comme organon, mais plutôt comme
a priori de la connaissance »
7
. C’est le linguistic turn ou le linguistic hermeneutic
pragmatic turn dont les principaux tenants sont Wittgenstein, Carnap, Frege, Austin,
Searle, Apel, etc. Et, « c’est dans ce dernier courant de la pensée que s’inscrivent les
questions soulevées par l’herméneutique de Gadamer »
8
Faisant référence à cette tradition, Heidegger, note : « La question que nous
touchons là n’est pourtant pas une question quelconque. Elle a tenu en haleine Platon
et Aristote dans leurs investigations, il est vrai aussi qu’elle s’est tue à partir de là- en
tant que question et thème d’une recherche véritable »
9
5
J. Grondin, Thèse de l’herméneutique sur l’être, dans « Revue de métaphysique et de morale », Paris
PUF, 2006/4 n° 52 | pages 469 à 481, dans https://www.cairn.info/revue-de-metaphysique-et-de-
morale-2006-4-page-469.htm, consultée 17/03/2020)
6
J. ONAOTSHO, De la raison herméneutique à la raison critique. Linéaments d’une rationalité
pluraliste, dans Revue africaine de théologie Vol. 26, n° 52 (octobre), 2002, p. 233.
7
Ib.
8
Ib.
9
M. HEIDEGGER, Être et temps, Paris, Gallimard, 1986, p. 25.

3
Cette mutation paradigmatique, qui culmine dans le tournant linguistique, est
bien résumée par Habermas lorsqu’il affirme :
« En analysant la base de validité des discours, je voudrais surmonter le
logocentrisme qui a marqué effectivement la tradition occidentale. L’ontologie
était fixée sur l’étant en sa totalité, la philosophie de la conscience, sur le sujet
qui se représente des objets, et l’analyse de langage, sur le discours constatant
des faits, et par là, sur le prima de proposition assertorique »
10
.
Le tournant linguistique se spécifie aussi par rapport à la philosophie moderne
qui remplace la question de l’être par celle de la raison comme le montre Habermas
qui écrit : « le thème fondamental de la philosophie est la raison… En parlant ainsi,
j’utilise le langage de la philosophie des temps modernes »
11
. En effet, pour Habermas,
« les concepts fondamentaux des chercheurs empiriques devraient en réalité pouvoir
être raccordés aux reconstructions rationnelles des relations de sens et des solutions
données aux problèmes »
12
. Cet auteur note que c’est à la sociologie que la rationalité
se rattacherait le mieux et accuse cette sociologie des préjugés égocentriques de l'agir
téléologique. Habermas reste convaincu qu’on ne peut faire ressortir le noyau rationnel
des réalisations que si l’on abandonne le paradigme de la philosophie de la conscience,
du sujet au profit du paradigme de la philosophie du langage
13
.
Comme palliatif à cette démarche des modernes, il remplace la rationalité
sociologique par une interaction langagière axée sur l'intercompréhension et pose
l’agir communicationnel. Il note à ce propos :
« Le concept de l’agir communicationnel fait entrer en ligne de compte la
présupposition supplémentaire d’un médium langagier dans lequel les rapports de
l’acteur au monde se reflètent comme tels. A ce niveau conceptuel, la problématique
de la rationalité qui, jusque-là n’intéressait que les sociologues, est rendue à présent à
la perspective de l’acteur lui-même »
14
Dans cette logique des contemporains, le langage comme médium, dans le
modèle communicationnel, place le locuteur et l’auditeur dans l’horizon de leur monde
objectif. En remplaçant la raison par le langage, les contemporains opèrent une
révolution. De cette façon, ils pensent non plus l’être, l’absolu, l’homme ou le monde
en soi, mais plutôt le discours sur l’être, sur l’absolu, sur le monde et sur l’homme. De
10
J. HABERMAS, Théorie de l’agir communicationnel, t.1. Rationalité de l’agir et rationalité de la
société. Paris, Fayard, 1987, p. 11.
11
Ib., p. 17.
12
Ib., p. 19.
13
J. HABERMAS, op.cit., p. 393-394.
14
Ib., P. 110.

4
ce point de vue, le langage est perçu comme la médiation nécessaire de la saisie de la
réalité.
Avec la notion du langage placé au centre de la réflexion, les contemporains
développent l’herméneutique inspirée de la théologie biblique, démarche qui pose,
selon Heidegger, la question du sens de l’être
15
et met le langage au centre de la
réflexion philosophique en remplacement de l’être vu comme le concept « le plus
général »
16
.
C’est dans ce contexte que Gadamer, partant de l’approche de Heidegger parle
du « tournant ontologique pris par l’herméneutique sous la conduite du langage ».
Avec l’herméneutique, le tournant linguistique place le langage au centre du
comprendre et le considère comme condition de possibilité de la saisie de la réalité.
Ainsi, la philosophie devient essentiellement une démarche d’interprétation que
Wittgenstein présente comme but de la philosophie qui cherche la clarification logique
de la pensée
17
. Pour Habermas ce tournant s’inscrit dans le cadre de
l’intercompréhension
18
.
II. LE LANGAGE DANS L’HERMENEUTIQUE DE GADAMER
Gadamer rencontre la philosophie herméneutique à l’école de Heidegger et lui
donne plus de force dans son ouvrage Vérité et méthode. Avec cet ouvrage, il place
l’herméneutique au centre des débats philosophiques et s’oriente vers l’herméneutique
des sciences humaines et l’herméneutique universelle du langage. En effet,
l’affirmation qui fait l’objet de cette leçon prend sens à partir de l’herméneutique des
sciences humaines et du rapport que Gadamer établit entre langage et compréhension.
Mais le rapport que Gadamer établit entre langage et compréhension suppose une
relecture de la question du langage dans la pensée occidentale dont le philosophe
allemand rejette l’héritage platonicien au profit de la théorie augustinienne du langage.
II.1. Le langage dans l’histoire de la philosophie
Une lecture attentive de l’histoire de la pensée occidentale permet de
reconnaître que la question du langage est bien présente dans l’histoire de la
philosophie occidentale bien avant le Tournant linguistique. Et, s’il y a eu oubli du
15
J. HABERMAS, op.cit., p. 28.
16
Ib., p. 26.
17
Cf. L. WITTGENSTEIN, Tractatus logigico-philosophicus, Paris, Gallimard, 1993, Prop., 4.112.
18
Cf. J. HABERMAS, op.cit., p. 296-301.

5
langage, ce n’est donc pas un hasard, c’est à cause de son « imprépensable »
insaisissabilité qui menace la souveraineté de la pensée. La réflexion s’attelait au
rapport qui unit la pensée au monde et « le nominalisme qui tend à réduire les mots à
des désignations d’êtres individuels pour en faire des signes d’une pensée
essentiellement logique ou noétique, n’en fut que l’expression la plus franche »
19
.
Bien que toute la pensée occidentale ait succombé à cet oubli du langage,
Gadamer trouve une exception, chez Saint Augustin. Cette exception que soulève Jean
Onaotsho dans son article sur l’Actualité herméneutique de Saint Augustin
20
. Cet
article expose « d’une part la théorie platonicienne du langage que Gadamer présente
comme parrain de l’oubli occidental du langage, et d’autre part la pensée augustinienne
de la trinité à travers laquelle s’articule une ontologie du langage qui rompt avec
l’héritage platonicien »
21
.
Du côté de la pensée grecque, Gadamer indique que l’erreur est partie de la
considération que cette pensée s’est faite du nom. Il écrit : « La philosophie grecque a
précisément commencé par reconnaître que le mot n’est que nom, c’est-à-dire qu’il ne
représente pas l’être véritable »
22
. Ce préjugé avait détourné la pensée grecque de ce
qui était à l’origine ou le mot, le nom faisait partie de l’être qu’il identifie dans un
rapport qui unit langage et logos. Il reproche à Platon, dans la discussion du Cratyle,
et la pensée grecque d’avoir modifié arbitrairement « le mode d’être de la langue »,
c’est-à-dire « ce que les mots signifient », et de « reprocher à la langue que les mots
ne restituent pas correctement les choses »
23
.
Il reconnaît cependant que l’oubli du langage dans la pensée occidentale n’est
pas total. La pensée chrétienne de l’incarnation rend mieux justice à l’être de la langue.
Cette pensée de l’incarnation est portée par Saint Augustin qui établit une unité entre
le langage et le verbe. Gadamer s’inspire de la théorie ontologique de l’incarnation
développée par Saint Augustin. Pour lui, cette théorie exprime mieux le rapport qui lie
l’être au verbe ou au langage que celle de l’incorporation des Grecques. À ce sujet
Onaotsho écrit :
« L’intérêt de l’herméneutique de Gadamer pour une telle théorie, celle d’Augustin,
réside dans ce qu’elle permet de repenser le rapport entre l’esprit et la matière, entre
19
J. HABERMAS, op.cit., p. 192.
20
J. ONAOTSHO Kawende, Actualité Herméneutique de Saint Augustin, dans Saint Augustin et la
situation du Congo Démocratique. Actes des dixièmes journées philosophiques du philosophât Saint-
Augustin du 20 au 22 décembre 2006, Kinshasa, Médiaspaul, 2007, p. 81-93.
21
J. ONAOTSHO Kawende, art.cit., p. 81.
22
H.-G. GADAMER, op.cit., p. 428.
23
Ib., p.429.
 6
6
 7
7
 8
8
 9
9
 10
10
 11
11
 12
12
1
/
12
100%
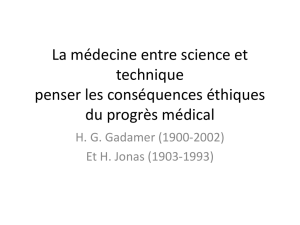
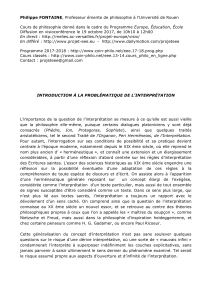

![Un pape philosophe [La Presse, 3 avril 2005] Jean Grondin](http://s1.studylibfr.com/store/data/004602676_1-91381956bcf4047a8f22ff5ea2c9d984-300x300.png)