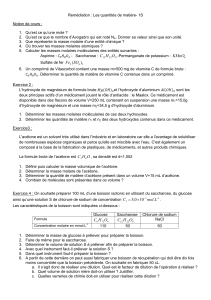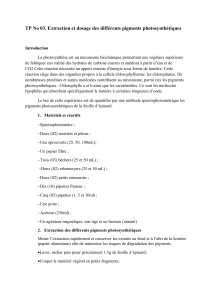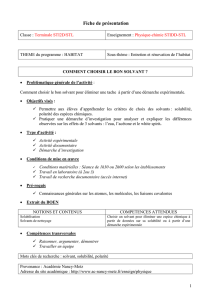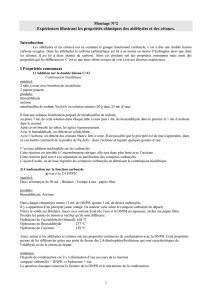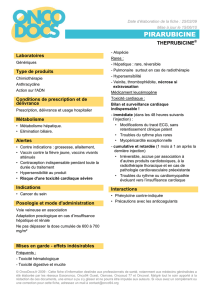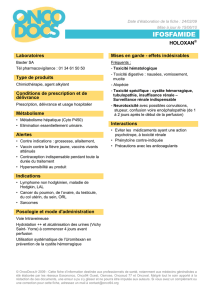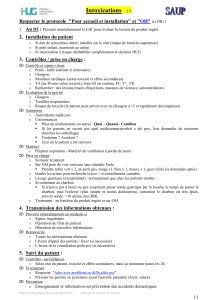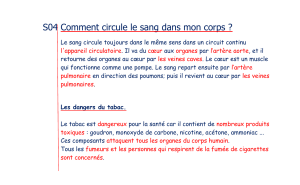Cétones : Toxicité, utilisations et prévention - Support de cours
Telechargé par
damabiahore

1
Les cétones
Pr Bruno MEGARBANE, PU-PH
Toxicologue, Réanimateur médical
Hôpital Lariboisière de Paris
Université Paris Diderot France
A. Généralités sur les cétones
1. Utilisations
Elles sont très utilisées comme solvants de peintures, laques, vernis, colles, encres et des
matières plastiques comme agent d’extraction et intermédiaire de synthèse dans la fabrication
de certaines matières plastiques et pesticides.
2. Toxicocinétique
En milieu professionnel, la voie principale d’absorption est pulmonaire par inhalation de
vapeur. L’absorption cutanée est possible en cas de contact avec du liquide. L’élimination se
fait par voie pulmonaire et par voie urinaire sous forme de métabolites.
3. Toxicité aigue
La toxicité des cétones est réputée faible mais certains (méthyl-n-butylcétone) a une toxicité
neurologique périphérique spécifique. A forte concentration, on observe les effets classiques
des solvants associés à une irritation oculaire et respiratoire et une action dégraissante
cutanée.
4. Toxicité spécifique et biométrologie
- L’acétone : les manifestations apparaissent vers 750 ppm. Son principal métabolite est le
1,2-propanediol. Le principal test utilisable est le dosage de l’acétone urinaire mais il est non
spécifique.
- La méthyléthylacétone : le métabolite principal est la 3-hydroxy-2-butanone. Le principal
test utilisable est le dosage de la méthyléthylcétone urinaire.
- La méthyl-n-butylcétone : elle est responsable de polyneuropathies sensitivo-motrices. Le
principal métabolite est la 2,5-hexanedione, commun avec le n-hexane. Le dosage des
métabolites est possible en fin de poste.
- La méthylisobutylcétone : une grande partie est métabolisée et éliminée sous forme de
CO2. Le principal test utilisable est la méthylisobutylcétone urinaire.
- La cyclohexanone : son métabolisme est mal connu mais le principal métabolite urinaire est
le cyclohexanol dont le dosage est possible.

2
- La N-méthyl-2-pyrrolidone : elle a une très bonne pénétration cutanée. C’est un puissant
irritant oculaire. Elle est en partie métabolisée en 5-hydroxy-n-méthyl-2-pyrrolidone éliminée
par voie urinaire.
5. Prévention technique et médicale
Les principes de la prévention technique et médicale sont communs à tous les solvants.
6. Métrologie d’ambiance
Les dosages atmosphériques instantanés se font par tube colorimétrique avec risque
d’interférences avec d’autres solvants. Les dosages différés se font après pompage actif sur
tube charbon ou silice, ou diffusion passive sur badge.
La VLE du 2-hexanone est de 8 ppm et 35 mg/m3.
7. Réparation
Tableau 52.
B. Acétone
1. Propriétés et utilisations
L'acétone est un liquide incolore très volatil.
L'acétone est miscible à l'eau et à un grand nombre de solvants organiques (éthanol, oxyde de
diéthyle et esters). C'est par ailleurs, un excellent solvant d'un grand nombre de produits
organiques et minéraux.
L'acétone, stable dans les conditions usuelles d'emploi, peut réagir avec les oxydants puissants
et avec certains hydrocarbures halogénés (trichlorométhane) en présence d'une base forte.
Utilisation :
- solvant (industrie des peintures, vernis, encres et colles)
- intermédiaire de synthèse
- solvant de l'acétylène.
2. Toxicocinétique
L'acétone est un produit lipophile, ayant un tropisme pour le système nerveux central.
Son absorption se fait à 75 % environ par voie pulmonaire du fait de sa haute volatilité.

3
Il existe également une absorption percutanée.
L'acétone est transformée, en 1,2-propanediol qui est ensuite incorporé au métabolisme du
glucose, ou en méthylglyoxol qui se transforme en glucose
L'élimination se fait :
- pour 40 à 70 % par voie pulmonaire sous forme inchangée
- pour 30 % dans les urines soit sous forme inchangée, soit sous forme métabolisée : les
métabolites sont les acides acéto-acétique et béta-hydroxybutyrique.
3. Toxicité
3.1. Toxicité aiguë
Après inhalation, les symptômes sont :
- locaux (irritation des yeux et des voies aériennes)
- neurologiques (céphalées, asthénie, vertige, coma)
- digestifs (nausée, vomissement). Après ingestion et contact cutané, on peut assister à une
symptomatologie identique, de moindre importance et avec un intervalle libre de plusieurs
heures.
- Sur le plan digestif, on peut avoir une irritation avec hématémèse mais sans complications
caustiques.
- En application cutanée, on peut observer un érythème et un léger oedème.
3.2. Toxicité chronique
Au cours d'expositions répétées, en dehors des phénomènes d'irritation oculaire et respiratoire,
il est parfois noté des signes neurologiques subjectifs, à type d'asthénie, de somnolence et de
vertiges.
Sur le plan cutané, on peut observer une dermatose d'irritation. L'acétone potentialise la
toxicité d'organe de l'éthanol, de l'hexane et des hydrocarbures chlorés (tétrachlorure de
carbone).
4. Métrologie
VME = 750 ppm, soit 1800 mg/m3.

4
Biométrologie : L'acétone urinaire est le paramètre le mieux corrélé aux
concentrations atmosphériques. Dosage d'acétone dans les urines (ACGIH) : 100 mg/l
fin de poste (valeur maximale tolérable).
5. Prévention médicale
Rechercher à l'embauche et lors des examens périodiques les atteintes neurologiques,
oculaires, cutanées ou respiratoires chroniques. Il sera utile de vérifier périodiquement les
fonctions hépatiques et rénales.
6. Traitement d'urgence
En cas de projection cutanée : laver à l’eau après avoir retiré les vêtements imprégnés. Si des
signes persistent ou apparaissent, consulter un médecin.
En cas de projection oculaire : laver immédiatement à l’eau pendant au moins 10 minutes. Un
examen ophtalmo sera pratiqué si des signes persistent.
En cas d’inhalation : éloigner le sujet de la zone polluée ; s’il est conscient, le placer en
position latérale de sécurité.
En cas d’ingestion : si la quantité est peu importante (pas plus d’une gorgée) administrer du
charbon médical activé et consulter un médecin. Dans les autres cas, si le sujet est
parfaitement conscient, tenter de faire vomir, donner du charbon médical activé et faire
hospitaliser.
Exercices d’auto-évaluation
1. Décrire les éléments diagnostiques de la toxicité aiguë de l’acétone
2. Décrire la toxicité et les biomarqueurs lors des intoxications par les cétones
3. Conduite à tenir devant une intoxication par l’acétone
4. Citer les emplois et secteurs exposant à l’acétone
5. Décrire les éléments de la prévention technique collective et médicale lors d’une
intoxication par les cétones
1
/
4
100%