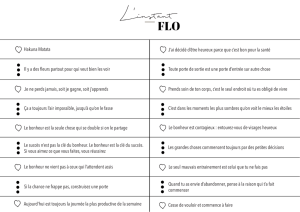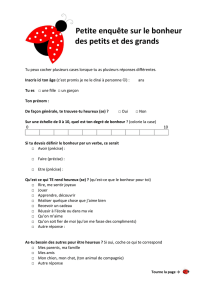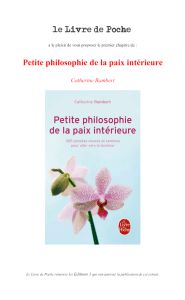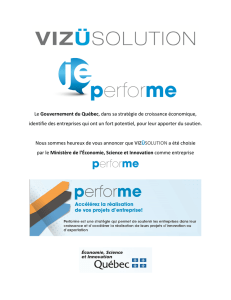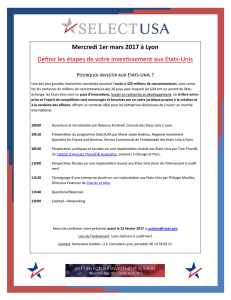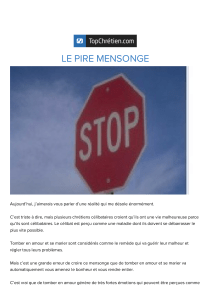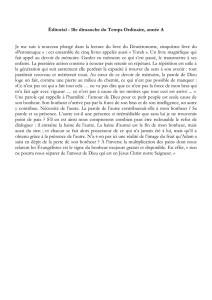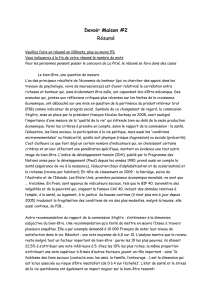Atelier d'écriture philosophique : Qu'est-ce qu'une vie réussie ?
Telechargé par
caroline.boinon75

Atelier d’écriture philosophique
32 thémaques à Paris 11e, 15e et 17e
Retrouvez notre calendrier sur stylosophie.net
Bienvenue à tous les curieux !
Stylosophie du 06 septembre 2025
Qu’est-ce qu’une vie réussie ?
« J’ai réussi » pensait Georges Duroy qui « se sentait un homme arrivé, un homme riche, un homme
heureux, un homme envié ». C’est ainsi que Guy de Maupassant dans Bel-Ami (1885) décrit son
personnage principal : un homme ayant le senment d’avoir « réussi sa vie » après avoir gravi les
échelons sociaux grâce à sa carrière de journaliste, à ses mariages avantageux, à son habileté à
s’enrichir et à obtenir du pouvoir. Dans ce roman, l’expression « réussir sa vie » renvoie à son sens le
plus courant qui l’associe principalement à l’ascension sociale, à la richesse et à la reconnaissance
professionnelle.
Bien sûr, l’auteur montre toute la vacuité d’une telle vie, dépourvue de toute joie véritable et le lecteur
comprend vite que cee réussite n’est qu’un leurre.
Au-delà de cet exemple, il semble surtout intéressant de constater qu’il est dicile de trouver des
exemples dans la liérature qui fassent réellement l’apologie de ce type de réussite. Comme s’il ne
pouvait s’agir là que du bonheur des « vulgaires » : un bonheur sans grâce et sans profondeur.
Et, pourtant, en signant son Bel-Ami, Maupassant n’était-il pas, lui aussi, en recherche de gloire ?
Notons, en tout cas, que son succès d’écrivain fut si net qu’il pu s’acheter un yacht, voyager beaucoup,
construire une maison à Etretat et « mener la grande vie » pour reprendre une autre expression qui
pourrait être considérée comme synonyme de la première (« réussir sa vie »).
Citons également l’exemple de Francis Sco Fitzgerald. D’un côté, il n’a cessé de vouloir démontrer, à
travers ses nombreux romans dont le si célèbre Gatsby le Magnique (1925), à quel point la soif de
possessions et de reconnaissance sociale était non seulement méprisable mais rendait profondément
malheureux. D’un autre côté, avec l’immense succès de ses écrits, cet auteur était réputé pour sa vie
fastueuse, mulpliant les fêtes, les voyages et les dépenses extravagantes.
Ces deux célèbres et talentueux écrivains ne feraient-ils pas preuve, comme la plupart d’entre nous
tous, chacun à son échelle, d’une contradicon aussi profonde que non véritablement avouée et
assumée ?
Cee hypothèse n’est pas sans rappeler les propos de Cicéron dans son traité philosophique et moral
Des devoirs (44 av. J.-C.) : « Les gens blâment l’ambion, accusent l’avidité, et pourtant ils ne rêvent que
d’honneurs, de dignités et de richesses. (…) Le langage des hommes est vertueux ; leurs actes sont pleins
de duplicité ». Cicéron observe que les hommes se plaisent à tenir un discours moral, condamnant
publiquement l’ambion et la cupidité tout en y consacrant l’essenel de leur temps et de leur énergie.
Dénoncer la supercialité des biens matériels et des honneurs tout en peinant à trouver de véritables
movaons en dehors d’eux, ainsi pourrait-il donc être décrite une des caractérisques essenelles de
la condion humaine ?

Au cœur de cee contradicon se loge donc une queson essenelle : qu’est-ce qu’une vie
véritablement réussie ? Entre les valeurs armées, revendiquées, et les désirs réels, penser une telle
queson, en pleine conscience et en toute honnêteté, est loin d’être simple.
Tout d’abord, la noon même de « vie réussie » supposerait qu’il existe des critères de réussite
permeant d’évaluer s’ils sont ou non aeints. A supposer que de tels critères puissent être idenés,
conennent-ils une part d’universel ou sont-ils exclusivement relafs à chacun ? Surtout, avant de se
lancer dans la recherche de tels critères, une queson se pose : la valeur d’une vie peut-elle être
évaluée ? Comment tenter de répondre à une telle queson sans se demander préalablement ce que
désigne, ici, « une vie » ? Est-ce un ensemble d’événements ? Un récit que l’on se construit ? Une
réalité plus inme et existenelle ?
Surtout peut-on vraiment évaluer une vie dans son ensemble ? Si oui, comment « noter » ce qui
constue un tout non réducble à l’ensemble de ses pares ? Une totalité qui a pour principale
caractérisque d’être sa propre nalité ? N’est-ce pas plutôt seulement certains de ses aspects qui
peuvent éventuellement être soumis à une telle appréciaon et non pas une vie dans son ensemble ?
A moins que « réussir sa vie » soit l’équivalent d’être heureux. La queson « qu’est-ce qu’une vie
réussie ? » deviendrait alors « qu’est-ce qui rend heureux ? » Mais est-ce vraiment le même
quesonnement de fond ? Ne peut-on, en eet, imaginer une vie réussie qui ne rende pas
nécessairement heureux ? Que penser, par exemple, des personnes qui ont réalisé des œuvres ou des
découvertes, sources d’éclairages considérables pour l’humanité, mais qui ont vécu dans la misère ou
dans le malheur ? Les exemples sont légion ! Citons-en seulement quelques-uns, au hasard, tels que
Van Gogh ou Mozart, Camille Claudel ou Antonin Artaud, Galilée, Alan Turing ou Marie Curie, ou encore
Edward Snowden ou Julien Assange.
Bref, on peut accomplir quelque chose de grand, laisser une trace, être ule ou dèle à un idéal, sans
nécessairement être heureux. Pire ! Dans certains cas, il semblerait même que l’un fasse obstacle à
l’autre puisque « faire œuvre » exige parfois de mere la queson de son bonheur au second plan.
Et si, paradoxalement, on cherchait les moyens de réussir sa vie surtout quand on se sent
parculièrement malheureux ou peu apte au bonheur ?
Bref, une vie réussie doit-elle viser principalement le bonheur ou la grandeur ? La paix ou
l’accomplissement ? La joie ou la vérité ?
Entre une personne célèbre, riche, et ayant accompli une œuvre majeure et ule pour l’humanité mais
malheureuse et une personne inconnue, aux revenus et à la carrière modestes mais comblée de
bonheurs simples, laquelle nous semblerait avoir le plus réussi sa vie ?
A parr d’exercices d’écriture aux consignes simples et progressives, chacun sera invité à cheminer,
d’une manière libre et créave, le long de ces nourrissantes et smulantes quesons.
Caroline BOINON
Paris, le 03 septembre 2025
1
/
2
100%