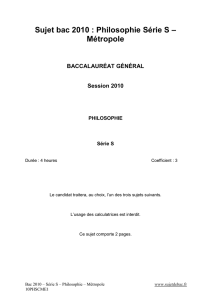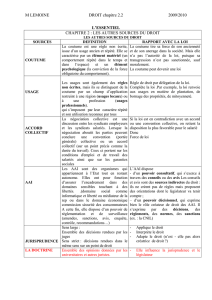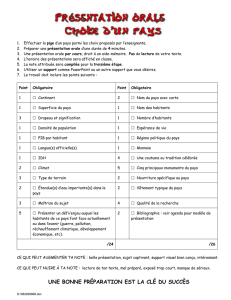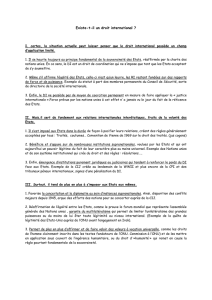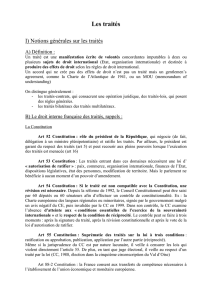Droit International Public : Histoire, Institutions et Théories
Telechargé par
berenicegnamien57

1
DROIT INTERNATIONAL PUBLIC
Le droit international public est constitué par l’ensemble des normes et des institutions
destinées à régir la société internationale par opposition au droit international privé qui
s’applique également dans le cadre international mais concerne plutôt les rapports entre les
personnes privées. Le droit international public s’adresse principalement aux Etats et par
extension aux groupes fonctionnels, c’est-à-dire aux organisations internationales, et de
manière accessoire aux individus et aux sociétés transnationales.
Le droit international s’est édifié dans un cadre qui s’est structuré aussi bien sur le plan
matériel que sur le plan organisationnel.
La formation progressive du droit international a favorisé l’élaboration de certains instruments
juridiques internationaux. Ainsi, la forme classique des traités s’était développé au moins des
faisceaux des traités bilatéraux pour fixer les relations entre les Etats, notamment par
l’occasion des grands traités de paix du XVIème et XVIIème siècle fait place pour la première
fois en 1815 lors du deuxième congrès de vienne à un traité multilatéral, instrument unique
signé par toutes les parties prenantes, ouvrant la voie à une universalisation et à une
institutionnalisation plus poussée. Bien plus, l’acte final du congrès de Vienne comporte une
déclaration adoptée le 08 février 1815 visant l’abolition de la traite négrière comme répugnant
au principe d’humanité et de morale universelle.
Les premières organisations internationales, d’abord techniques, apparaissent dans le courant
du XVIIIème siècle avec la création de la commission centrale du Rhin de 1831, puis la
commission du Danube de 1856. Dans la seconde moitié du XIXè siècle, les règles et les
progrès des télécommunications imposent la mise en place de régimes juridiques
internationaux à travers les organisations techniques comme les premières unions
télégraphiques internationales, l’Union postale Universelle. L’arbitrage comme moyen de
règlement pacifique des différends connaît lui aussi un essor important, alors que l’arbitrage
par souverain était essentiellement un arbitrage politique. L’arbitrage prend une forme
technique après le traité de juillet 1794 conclut entre les Etats Unis d’Amérique et l’Union
européenne avec la mise en place de commission mixte pour régler les séquelles de la guerre
d’indépendance.

2
Les grandes conférences de la paix de La Haye convoquées à l’initiative du Tsar en 1899 et en
1907 marqueront l’aboutissement de ces efforts pour rationaliser les relations des Etats, en
codifiant les lois communes, les lois et coutumes de guerre et en institutionnalisant le
règlement pacifique des différends. D’une certaine manière, on peut dire que le système
multilatéral des conférences de La Haye était l’embryon d’un véritable ordre institutionnel
mais il était limité à une vingtaine d’Etats européens et étroitement intégrés dans le Conseil
Européen.
Le traité de Versailles qui fonde en 1919 la Société des Nations et l’Organisation
Internationale du Travail est à l’origine du premier système des organisations de nature
politique à vocation universelle. Dépassant les précédentes tentatives d’arbitrage
institutionnalisées, la SDN créé une Cour Permanente de Justice Internationale chargée de
dire le droit entre les faibles et les forts. L’idéologie qui sous-tend cette création est celle qui a
animé la guerre pour le droit avec les 14 points du Président Wilson. Et en refusant de ratifier
le traité de Versailles, le Sénat américain affaiblira l’embryon qui était établi le système alors
même qu’il incarnait des valeurs profondément américaines fondées sur l’universalisme et le
juridisme.
D’une certaine manière, la SDN reste une organisation essentiellement européenne même si
les Etats latino-américains y jouent un rôle non négligeable. Et c’est en Europe comme en
Asie que l’échec de la SDN lors de 1930 avec la montée des dictatures puis la Seconde Guerre
mondiale va mettre en péril ces valeurs.
La création de l’ONU en 1945 est une nouvelle tentative, là encore fortement influencée par
l’idéalisme américain de créer un ordre fondé sur le droit. Il s’agit bien sûr du droit des
vainqueurs qui occupe une place privilégié au cœur du système et reste tenté par toutes les
formes d’hégémonie. Mais c’est aussi un droit poussant jusqu’au bout le principe universaliste
et la logique égalitaire à travers un multilatéralisme grandissant. La Charte des Nations Unies
pose sans ambigüité les principes d’un système fondé sur l’égalité et la souveraineté des Etats.
De même les principaux organes de l’ONU, à commencer par la Cour Internationale de
Justice son organe judiciaire principal, ont pour vocation de faire pleinement respecter ses
principes.
1/ Le droit international, entre tensions et actions

3
Il faut savoir aussi que le droit international prend sa source dans les tensions qu’il va avoir
entre les civilisations. Entre les différentes guerres, les théoriciens qui vont réfléchir sur les
règles qu’il faut pour établir la paix et la sécurité internationales. On part de l’idée d’une
universalité des Etats égaux en droit qui fondent le droit international contemporain. Cette
idée sera une conquête récente, mais le concept de grande puissance et le rôle de directoire
internationaux de fait ont continué à dominer les relations internationales de la Conférence
des trois grands à Yalta, qui a fondé plus tard l’ONU en février 1945 qui est à l’origine de la
Charte des Nations Unies où les grandes puissances ont un siège permanent de sécurité
jusqu’au sommet des 7 pays les plus industrialisés du monde devenus G8 avec la participation
de la Russie récemment. Avec plus tard le G8 plus 1 avec la Chine, la crise des subprimes en
2008, l’émergence des BRICS c’est-à-dire Brésil, Russie, Inde, Chine et Afrique du Sud
montrent qu’il y a une évolution dans les relations internationales et dans la formulation des
règles qui vont constituer les instruments juridiques sur lesquels va se fonder la société
internationale qui se met en place et qui s’institutionnalise. On a une origine lointaine mais
une origine plutôt liée à l’époque moderne à partir du XVIème siècle à partir de la mise en
place des Etats modernes européens.
Après la deuxième guerre mondiale, la société internationale a été marquée par une volonté
exprimée dans le cadre de la Charte des Nations Unies qui a mis l’accent sur la valorisation du
droit international ainsi que sur la solidarité des Etats et des peuples. Mais le DIP procède des
règles élaborées par les Etats européens à partir du 17ème siècle. Ce droit est appelé
interétatique.
Suite à la vague des indépendances, notamment des territoires d’Amérique du nord, du sud,
des pays d’Asie et plus tard des pays d’Afrique, le droit international cessera d’être
interétatique pour devenir le droit de la société internationale. La création de l’ONU ouvre
une période marquée par le désir de fonder un monde partageant des valeurs communes en
dépit des différences, notamment dans les domaines économiques, culturels et même
religieux. On va également assister à une succession de périodes de guerres froides avec les
tensions Est et Ouest, et les fractures économiques entre le Nord riche et le Sud pauvre. Il se
développe une vision conflictuelle du droit international qui malgré tout se construit autour
des bases communes que partagent toutes les nations.
Le principe de l’interdiction du recours à la force est affirmé par l’article 2 paragraphe 4 de la
Charte des Nations-Unies. Il acquiert en 1986 une valeur coutumière avec l’arrêt relatif aux

4
activités militaires et paramilitaires au Nicaragua et contre lui-même, paragraphe 186 de
l’arrêt en question. Pourtant, on observe l’usage régulier des armes justifié selon les cas par
l’invocation de la légitime défense ou la lutte contre le terrorisme ou les luttes de libération
des peuples opprimés. Du fait de la possession des deux blocs des armes de destruction
massive, on doit plus à l’équilibre de la terreur qu’à la vénération des principes de la Charte
des Nations Unies d’avoir pu éviter au plus fort de la rivalité est-ouest un affrontement
généralisé. C’est par exemple le cas de la crise de cuba de 1962. Lorsque les confrontations ne
dégénéraient pas en conflit ouvert, elles alimentent cependant les tensions entre nations et
perturbent la marche des négociations, encombrent l’essor de la coopération. Cependant, ni
les uns ni les autres ne s’arrêtent jamais et la collectivité internationale est en conclave
incessante.
2/ Les apôtres du droit international public
Parmi les premiers auteurs qui se sont penchés sur cette question, on peut citer Francisco de
Victoria (1480 à 1546) et Francisco Suarez (1548 à 1617). Ils sont les héritiers directs
d’Aristote et ont été également inspirés par Saint Thomas dans sa recherche du bien commun.
Ces auteurs ont mis l’accent sur le droit naturel, c’est l’ensemble des règles non écrites
d’essence divine qui s’imposent à tous. Ce courant reconnaît l’existence d’une communauté
internationale et subordonne l’Etat au respect du droit naturel voulu et dicté par Dieu. Le droit
naturel sera à la fois laïcisé et systématisé par Grotius dans son ouvrage de jure belli ac pacis
publié en 1625. Considéré comme le véritable fondateur du droit de la nature et des gens, il a
indiqué que le droit naturel consiste en certains principes de la droite raison qui fournissent
aux Etats et aux individus les critères du bien et du mal et doivent guider leur conduite. Le
courant persiste jusqu’aujourd’hui même s’il est très souvent supplanté par le positivisme
juridique.
Le courant positiviste est porté sur une démarche scientifique inspiré par Auguste Comte,
George Scelle. Partisans de l’objectivisme sociologique, héritiers de Durkheim rattaché au
poids des contraintes sociales, la subordination des Etats doit se faire en tenant compte de ce
que sont les textes en eux même. Ce courant prend se faisant le contre pieds du positivisme
volontarisme. Il y a ici une opposition positivisme sociologique et positivisme volontarisme
classique. Ce dernier courant est animé tout particulièrement au début du XXème siècle par le
Professeur Italien Dionisio Anzilotti. Pour lui , il n’existe pas d’autres fondements à l’autorité
de la règle de droit dans l’ordre international en dehors de la volonté de l’Etat. La volonté de

5
l’Etat s’impose ainsi de manière prioritaire selon ce courant. Il reste aujourd’hui dominant et
ceci pour au moins deux raisons. La première est le caractère très efficace de la formalisation
logique de divers éléments de la doctrine juridique à laquelle. Il parvient notamment pour
rationnaliser et simplifier la théorie des sources du droit international et celle de la
responsabilité internationale en partie parce qu’elle repose sur certaines fictions opératoires.
La doctrine positiviste fournit en effet un instrument d’analyse cohérent et rationalisé.
La seconde raison de son succès tient au fait que tant dans ses présupposés que dans ses
techniques d’analyse, elle fait le jeu des souverainetés c’est-à-dire des gouvernements et
naturellement soucieux de faire respecter leur liberté. Le courant positivisme volontariste à
l’inverse des naturalistes et des objectivistes n’est pas d’abord préoccupé par l’affectation du
droit à la réalisation de certains objectifs définis par référence à une fonction sociale du droit
plus ou moins idéalisé.
Particulièrement à ses origines, cette sécularisation radicale du droit international envisagée
avant tout sous l’angle des techniques et des procédures de production normative résiste
encore aujourd’hui massivement à la prise en compte du retour à l’idéologie dans les
fondements et les objectifs du droit international tels qu’il découle de la lettre et de l’esprit de
la Charte des Nations Unies.
La troisième branche du positivisme est le normativisme fondé au début du XXème siècle par
le grand juriste et philosophe du droit autrichien Hans Kelsen dans sa théorie pure du droit.
Elle s’attache à assurer une connaissance pure du droit seul en excluant ce cette connaissance
tout ce qui ne se rattache pas à l’exacte notion de cet objet. Partant de ces prémices, le
normativisme partage cependant le souci des volontaristes de ne pas inclure dans le champ de
la science juridique, la prise en considération de ces finalités idéelles, idéales et sociales à
l’inverse du sociologisme de George Scelle. Comme ce dernier cependant, mais par des
chemins fort différents, Kelsen parvient à la disparition ou tout au moins à la mise en tutelle et
la fonctionnalisation de la souveraineté parce que le droit n’est qu’un complexe hiérarchisé de
normes dont il procède mais auquel demeure également subordonné les compétences de
l’Etat.
3/ La négation du droit international
Plusieurs arguments sont invoqués quant à l’existence ou non du droit international.
 6
6
 7
7
 8
8
 9
9
 10
10
 11
11
 12
12
 13
13
 14
14
 15
15
 16
16
 17
17
 18
18
 19
19
 20
20
 21
21
 22
22
 23
23
 24
24
 25
25
 26
26
 27
27
 28
28
 29
29
 30
30
 31
31
 32
32
 33
33
 34
34
 35
35
 36
36
 37
37
 38
38
 39
39
 40
40
 41
41
 42
42
 43
43
 44
44
 45
45
 46
46
 47
47
 48
48
 49
49
 50
50
 51
51
 52
52
 53
53
 54
54
 55
55
 56
56
 57
57
 58
58
 59
59
 60
60
 61
61
 62
62
1
/
62
100%