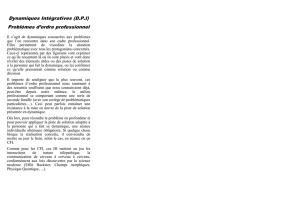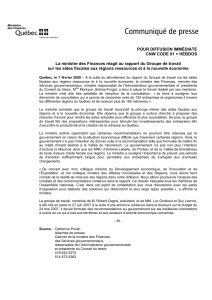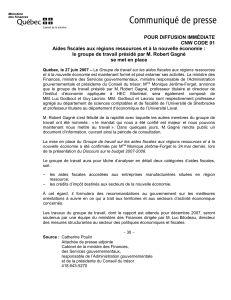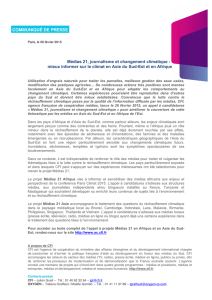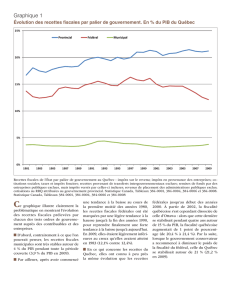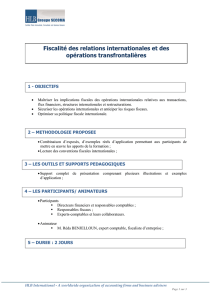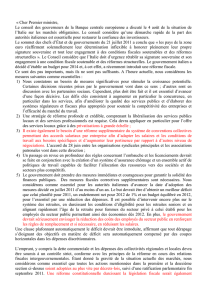Conventions Fiscales Internationales : Définitions, Objectifs et Modèles
Telechargé par
Zineb Dlimi

Les conventions fiscales internationales
Les conventions fiscales internationales : sont des accords entre États visant exclusivement à encadrer la fiscalité
transfrontalière. Elles fixent les règles de répartition du droit d’imposer entre les pays signataires, organisent la
coopération administrative (notamment l’échange d’informations fiscales) et prévoient des mécanismes de
résolution des différends.
Typologies de CFI: Les CFI sont le plus souvent bilatérales, mais peuvent aussi être multilatérales (ex. : UMA, UE,
Amérique latine).
Elles peuvent être générales, couvrant plusieurs secteurs, ou sectorielles, ciblant des domaines précis comme le
transport ou les technologies de l'information.
Objectifs des CFI : Objectifs principaux := Éviter ou réduire la double imposition entre États. =Lutter contre la
double non-imposition et prévenir la fraude et l’évasion fiscales internationales.
Objectifs secondaires : =Favoriser la coopération entre les administrations fiscales. =Assurer l’égalité de traitement
fiscal entre résidents et non-résidents.
Modèle OCDE des CFI : (1977, dernière version 2017) sert de référence pour la négociation des conventions fiscales
bilatérales. Il fixe des principes communs pour traiter les questions fiscales transfrontalières.
Modèle ONU des CFI : 1980 (dernière version : 2017), le modèle de l’ONU facilite la négociation de CFI entre pays
développés et en développement. Il accorde plus de droits d’imposition aux pays sources, mais reste moins utilisé
que le modèle OCDE
Principes: = Primauté des CFI : en cas de conflit, les conventions fiscales internationales prévalent sur les lois fiscales
internes des États signataires. = Principe de non-aggravation : une CFI ne peut empêcher l’application de règles
internes plus favorables au contribuable
Étapes d’élaboration des CFI :
• Prise de contact : début des discussions entre
États.
• Négociations : élaboration du texte sur base
OCDE ou ONU.
• Paraphe : accord technique provisoire.
• Signature : validation officielle par une
autorité compétente.
• Ratification : approbation selon les
procédures internes (au Maroc : Roi +
Parlement).
• Publication : insertion au Bulletin Officiel
après entrée en vigueur
Définition de la résidence : Déterminée par les lois fiscales internes (critères : domicile, résidence, siège de direction,
lieu de constitution, etc.) ex : Un expatrié français vivant au Maroc plus de 183 jours peut être considéré comme
résident fiscal marocain.
État de résidence :
C’est l’État où une personne est domiciliée
fiscalement, selon le droit interne ou les règles de la
convention en cas de double résidence.
État de source :
C’est l’État où le revenu est généré, où le bien est
situé, ou où l’activité est exercée

Fiscalité internationale : Étude des règles juridiques et fiscales applicables aux opérations transfrontalières
impliquant plusieurs États
Souveraineté fiscale : Droit exclusif de chaque État d’élaborer et d’appliquer ses propres lois fiscales sur son
territoire.
Modèle territorial : Imposition des revenus provenant d’une source située dans l’État, quelle que soit la résidence
du contribuable.
Modèle mondial : Imposition de tous les revenus mondiaux d’un résident, peu importe leur origine géographique
Double imposition juridique : Deux États imposent le même contribuable, sur le même revenu, pour la même
période
Double imposition économique : Deux États imposent des personnes différentes sur un même revenu (ex. : société
et actionnaire)
Filiale : Société juridiquement distincte, contrôlée par une société mère (qui détient > 50 % du capital), disposant de
sa propre personnalité morale et financière
Succursale : Entité sans personnalité morale propre, dépendante juridiquement de la société mère, mais autonome
dans la gestion
Établissement stable : Installation fixe d’affaires par laquelle une entreprise exerce, tout ou partie de son activité
dans un autre État , ses caractéristique sont Fixité de l’installation / Présence physique (bureau, usine, chantier…)/
Existence dans le temps /Activité opérationnelle ou de direction exercée
Agent indépendant : Agit en son propre nom, de manière autonome (courtier, commissionnaire), n’engage pas
l’entreprise → pas d’établissement stable.
Agent dépendant ; Mandaté pour agir au nom de l’entreprise, peut l’engager juridiquement → considéré comme un
établissement stable.
. Cycle commercial complet : Ensemble cohérent d’opérations (achat, vente, production, services…) réalisées
intégralement à l’étranger, formant une activité autonome
1
/
2
100%