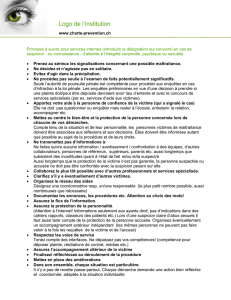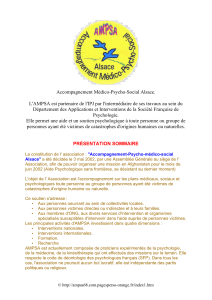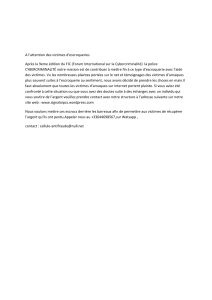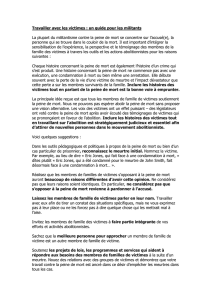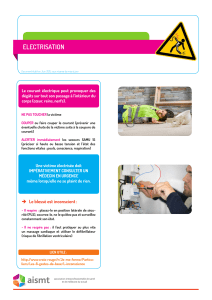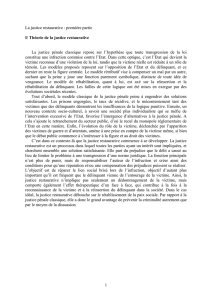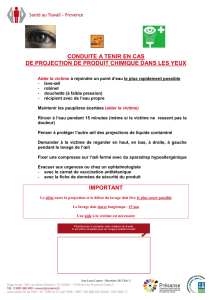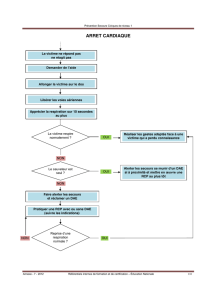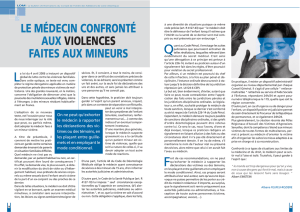1
Revue d’étude et de recherche sur le droit et l’administration dans les pays d’Afrique
Afrilex Décembre 2024
http://afrilex.u-bordeaux.fr/
LES AMBIGUÏTES NORMATIVES DU STATUT DE VICTIME EN MATIERE DE
REPRESSION DES CRIMES INTERNATIONAUX
Sidy Alpha NDIAYE
Agrégé des Facultés de Droit à l’Université Cheikh Anta Diop de Dakar (UCAD)
Desailly G. Camille YA
Docteur en Droit public de l’Université Cheikh Anta Diop de Dakar (UCAD)
La figure antagoniste du procès pénal est commune à tous les systèmes juridiques étatiques ; le
prétoire criminel mettant en scène un individu aux prises avec la machine répressive de l’État
1
.
Cet antagonisme renvoie l’image d’une confrontation judiciaire se tenant, en principe, entre la
société et l’auteur de l’infraction. Une telle configuration des joutes au sein de l’arène judiciaire
criminelle conduit à exclure la victime comme protagoniste des hostilités opposant le ministère
public et la personne mise en cause. En effet, quel que soit le système juridique considéré, ni la
présence de la victime ni son identification ne sont indispensables au déclenchement ou au
déroulement du procès pénal
2
. La répression internationale des crimes, elle aussi, plutôt tournée
vers la punition des coupables de graves violations des droits de l’homme et du droit
international humanitaire, a longtemps mis les victimes en marge des procès de leurs
bourreaux
3
.
L’humanisation amorcée du droit international permit de mettre en exergue la condition
juridique des victimes de crimes de masse. Ce changement de paradigme pro-victima doit être
mis à l’actif d’une société civile engagée en faveur de la défense des droits humains et du projet
de la communauté internationale de réprimer les crimes internationaux
4
. La communauté
internationale a d’ailleurs proposé, pour la première fois, une définition de la victime de la
criminalité internationale au sens pénal du terme. La solution fut porteuse d’une révolution là
où les législations nationales — peu importe le statut réservé à la victime — ne l’avaient ni
1
R. MERLE et A. VITU, Traité de droit criminel, Tome I, Problèmes généraux de la science criminelle, droit
pénal général, Dalloz, 2000, 7ème éd., § 108.
2
La solution vaut tant pour le système de common law que pour le modèle de droit continental où la place de la
victime dans le procès pénal est généralement exagérée. Ainsi, même en droit interne de tradition romano-
germanique, il n’est pas, en principe, obligatoire qu’une victime dépose plainte ou soit identifiée dans la cause
pour l’engagement du procès pénal. Le parquet y est même fondé à poursuivre l’auteur de l’infraction contre l’avis
de la victime. Sur ce point, l’article 2, alinéa 2 du Code de procédure pénale français dispose que « La renonciation
à l’action civile ne peut arrêter ni suspendre l’exercice de l’action publique (…) ».
3
S. PELLET, « La place de la victime », in H. ASCENSIO, E. DECAUX et A. PELLET (dir.), Droit international
pénal, Paris, A. Pedone, 2012, 2ème éd., pp. 933 -944.
4
C. QUETEL, La Seconde Guerre mondiale, Paris, Perrin, 2018, pp. 615-654.

2
Revue d’étude et de recherche sur le droit et l’administration dans les pays d’Afrique
Afrilex Décembre 2024
http://afrilex.u-bordeaux.fr/
conceptualisée ni formellement définie. La Déclaration des principes fondamentaux de justice
relatifs aux victimes de la criminalité et aux victimes d’abus de pouvoir de l’O.N.U. définit les
victimes comme toutes « (…) personnes qui, individuellement ou collectivement, ont subi un
préjudice, notamment une atteinte à leur intégrité physique ou mentale, une souffrance morale,
une perte matérielle ou une atteinte grave à leurs droits fondamentaux, en raison d’actes ou
d’omissions qui enfreignent les lois pénales en vigueur dans un État membre, y compris ceux
qui proscrivent les abus criminels de pouvoir »
5
.
Cette conceptualisation universelle de la victime, en lien avec les droits et garanties qui lui sont
reconnus, a été, in fine, endossée dans le cadre de mécanismes régionaux ou sous-régionaux.
On peut, à cet égard, rappeler une disposition du droit de l’Union européenne, aux termes de
laquelle la victime est une « (…) personne qui a subi un préjudice, y compris une atteinte à son
intégrité physique ou mentale, une souffrance morale ou une perte matérielle, directement
causée par des actes ou omissions qui enfreignent la législation d’un État membre »
6
. La
définition onusienne a pareillement influencé les autorités étatiques. Ainsi, sur le plan national,
même dans les législations qui n’en donnent pas une définition précise, la victime est
appréhendée par la procédure pénale comme toute personne lésée dans ses droits ou biens par
la suite d’une infraction pénale
7
. Pour ne citer que ces exemples, le Code de procédure pénale
allemand considère la victime comme la personne — uniquement — lésée directement dans ses
droits ou biens juridiques
8
. Les droits français et espagnol voient en la victime toute personne
physique ou morale qui, en conséquence d’une infraction pénale, a souffert des dommages. Ces
dommages pouvant être des blessures physiques, mentales, des dégâts matériels ou
économiques
9
.
Le droit de la Cour pénale internationale (C.P.I.) se nourrit des mêmes lignes directrices
onusiennes. À l’instar de la définition pionnière des Nations Unies, et peut-être même mieux
qu’elle, la réglementation de la Cour de La Haye constitue un référent pertinent à l’adresse des
autorités étatiques, aussi bien pour la définition de la notion de victime de crimes internationaux
5
AG-NU, Résolution A/RES/40/34, « Déclaration des principes fondamentaux de justice relatifs aux victimes de
la criminalité et aux victimes d’abus de pouvoir, Annexe », 29 novembre 1985, accessible en ligne sur :
http://www.unhchr.ch. Consulté le 15 septembre 2024.
6
Article premier de la Décision — cadre du Conseil de l’Union européenne du 15 mars 2001 relative au statut des
victimes dans le cadre de procédures pénales. V., Journal officiel des Communautés européennes (2001/220/JAI),
22 mars 2001.
7
H. HENRION, « Y a t-il une place pour la victime en procédure pénale allemande ? », in G. GIUDICELLI-
DELAGE et C. LAZERGES (dir.), La victime sur la scène pénale en Europe, Paris, PUF, 2008, 1re éd., pp. 23 et
s.
8
Ibid.
9
R. BRENES et A. M. P. ADORNO, « La victime en Espagne : acteur privilégié du procès pénal », in G.
GIUDICELLI-DELAGE et C. LAZERGES (dir.), La victime sur la scène pénale en Europe, op. cit., pp. 86 et s.

3
Revue d’étude et de recherche sur le droit et l’administration dans les pays d’Afrique
Afrilex Décembre 2024
http://afrilex.u-bordeaux.fr/
qu’en faveur de l’élaboration d’un véritable droit des victimes. De l’économie de la Règle 85
du Règlement de preuve et de procédure (R.P.P.) de la C.P.I., il ressort que la victime est « toute
personne physique qui a subi un préjudice du fait de la commission d’un crime relevant de la
compétence de la Cour
10
». Constitue aussi une victime — ce qui est une nouveauté — « (…)
toute organisation ou institution dont un bien consacré à la religion, l’enseignement, aux arts,
aux sciences ou à la charité, un monument historique, un hôpital ou quelque autre lieu ou objet
utilisé à des fins humanitaires a subi un dommage direct »
11
.
Les définitions internationales susvisées, dont le Statut de la C.P.I. constitue le point culminant,
ont été surtout élaborées dans l’intérêt des victimes d’atrocités et d’éminentes violations des
droits de l’homme. Ces graves violations sont considérées comme des crimes internationaux.
L’idée commande alors de préciser les contours de la notion de crimes internationaux, le statut
des victimes de ces crimes intéressant la présente étude. L’analyse se fera, sur ce point, à la
lumière de la spécificité du droit international pénal et des crimes qu’il a vocation à réprimer.
Deux conceptions du crime international sont généralement proposées par la doctrine. La
première, fondée sur un critère formel, qualifie de crime international toute infraction grave
prévue par une norme de droit international, conventionnelle ou coutumière
12
. Cette définition
parait à la fois vaste, incertaine et insuffisante
13
. On comprend qu’elle ne rende nullement
compte du droit des crimes internationaux pratiqué devant la justice pénale internationale, de
Nuremberg à La Haye. Elle ne sera donc pas retenue dans le cadre de cette étude. La seconde
définition des crimes internationaux repose sur une approche matérielle tenant compte de l’objet
et de l’incidence du crime considéré. Elle apparait dans les travaux du professeur Olivier De
Frouville, qui conçoit l’existence d’une société d’États souverains et d’une société humaine
universelle
14
. Certains crimes internationaux se commettent au préjudice des États composant
la société d’États souverains. La corruption, le terrorisme, le faux monnayage et autre
blanchiment de capitaux seraient de cette catégorie d’infractions. D’autres crimes, dépassant
les intérêts des seuls États, portent, en revanche, atteinte aux droits de l’ensemble de la
communauté internationale. Ces crimes menacent les « fondements de l’ordre
international »
15
. Faisant écho à la jurisprudence pertinente du T.P.I.Y. et du T.P.I.R., les
10
V., la Règle 85 (a) du R.P.P.
11
V., la Règle 85 (b) du R.P.P.
12
B. KANDJOURA, « La réparation en droit international pénal », accessible en ligne sur : 2022. hal-03763239.
Consulté, le 15 septembre 2024.
13
F. BELLIVIER, M. EUDES et I. FOUCHARD, Droit des crimes internationaux, Paris, P.U.F., 2018, pp. 48 et
s.
14
O. De FROUVILLE, Droit international pénal, Sources, incriminations, Responsabilité, Paris, Pedone, 2012,
p. 3.
15
F. BELLIVIER, M. EUDES et I. FOUCHARD, Droit des crimes internationaux, op.cit., p. 9.

4
Revue d’étude et de recherche sur le droit et l’administration dans les pays d’Afrique
Afrilex Décembre 2024
http://afrilex.u-bordeaux.fr/
crimes contre la société humaine universelle auraient vocation à nier l’Humanité même des
victimes. La définition matérielle des crimes internationaux rend aisément compte de la mise
en œuvre contentieuse du droit international pénal devant les juridictions pénales
internationales. Devant les Tribunaux de Nuremberg et de Tokyo, le T.P.I.Y., le T.P.I.R., la
C.P.I. et même les juridictions pénales internationalisées (J.P.I.), les crimes dont les auteurs
sont poursuivis et réprimés dépassent de simples violations au préjudice des États. Ils
s’attaquent généralement à ce qui est commun à tous les êtres humains peu importe leur race,
origine, sexe, culture ou condition sociale. Sont ainsi protégées, dans la notion de crimes
internationaux, les valeurs humaines universelles comme la dignité, l’intégrité physique, morale
ou mentale, l’environnement essentiel à la sureté de la terre et à la survie de l’être humain. Le
recours à la notion d’Humanité a servi de dénominateur commun à la création des juridictions
pénales internationales chargées de réprimer les auteurs de crimes internationaux ; ce qui
participe de la juridictionnalisation de la notion par le Conseil de sécurité
16
. C’est un lieu
commun d’affirmer que la notion d’Humanité sort davantage de l’abstrait pour pénétrer le droit
positif, conventionnel et prétorien. La position est fortement entérinée par la jurisprudence
internationale dans la définition même du crime contre l’humanité. À ce propos, le T.P.I.Y.
décida, depuis l’affaire Dražen Erdemović, que « (…) Les crimes contre l’humanité couvrent
des faits graves de violence qui lèsent l’être humain en l’atteignant dans ce qui lui est le plus
essentiel (…) Mais les crimes contre l’humanité transcendent aussi l’individu puisqu’en
attaquant l’homme, est visée, est niée, l’Humanité. C’est (…), l’Humanité, qui marque
d’ailleurs la spécificité du crime contre l’humanité »
17
. L’Humanité, critère du crime
international, apparait encore dans la qualification du génocide. La nécessité de l’incrimination
réside, ainsi que l’admettent les juges internationaux, dans la volonté de la communauté
internationale d’interdire tout crime déniant à des groupes humains le droit à l’existence.
À ce propos, dans son avis consultatif du 28 mai 1951, au sujet des Réserves à la Convention
sur le génocide, la C.I.J. précise que « les origines de la Convention révèlent l’intention des
Nations Unies de condamner et de réprimer le génocide comme un crime de droit des gens
impliquant le refus du droit à l’existence de groupes humains (…), inflige de grandes pertes à
l’humanité (…) »
18
. Dans la même logique, pour le T.P.I.Y., « (…) ceux qui conçoivent et
commettent le génocide cherchent à priver l’humanité des innombrables richesses qu’offrent
16
S. A. NDIAYE, Le Conseil de sécurité et les juridictions pénales internationales. Thèse de Doctorat en Droit
public, Université d’Orléans, 2011, p. 21.
17
T.P.I.Y., Chambre de première instance, 29 nov. 1996, Le Procureur c./ Dražen Erdemović, jugement portant
condamnation, IT -96-22, § 28.
18
C.I.J., 28 mai 1951, Réserves à la Convention sur le génocide, avis, Rec. 1951, p. 15.

5
Revue d’étude et de recherche sur le droit et l’administration dans les pays d’Afrique
Afrilex Décembre 2024
http://afrilex.u-bordeaux.fr/
ses nationalités, races, ethnies et religions. Il s’agit d’un crime contre le genre humain dans
son intégralité, qui touche non seulement le groupe dont on cherche la destruction, mais aussi
l’humanité tout entière »
19
.
Du point de vue de la définition matérielle des crimes internationaux, il s’agit de comportements
qui portent nécessairement atteinte aux intérêts et valeurs de la communauté internationale et
qui, comme tels, sont incriminés et punis par une norme de droit international, qu’elle soit
coutumière ou conventionnelle
20
. Partant, les victimes de crimes internationaux doivent être
entendues comme toute personne physique ou morale, à l’exception de l’État, ayant
personnellement souffert, directement ou indirectement, d’un préjudice du fait desdits crimes.
En réalité, la limitation de la qualification de crime international se justifierait par deux
arguments d’ordre pratique. Le premier, déjà évoqué, tient au fait que le droit applicable devant
les juridictions pénales internationales ne concerne que ces seuls crimes jugés essentiels pour
l’ordre mondial. Le second vient de ce que la plupart des autres incriminations internationales
opèrent généralement comme des crimes sous-jacents au triptyque que constituent le génocide,
le crime contre l’humanité et le crime de guerre. Le droit de la C.P.I. et le développement du
droit international pénal invitent, néanmoins, à ajouter à cette liste de crimes internationaux le
crime d’agression et les crimes environnementaux aux dommages graves, étendus et durables
21
.
Pour les mêmes raisons, la torture mériterait, elle aussi, d’être retenue comme crime
international autonome
22
.
Le génocide, le crime contre l’humanité, le crime de guerre et la torture ont ceci de commun
que leur caractérisation suppose, à la base, des crimes ou violations graves contre l’intégrité
physique ou morale des victimes généralement connus des droits étatiques, avec cette nuance
qu’ils s’accompagnent d’une intention criminelle spécifique et/ou interviennent dans un
contexte particulier. Ainsi, la qualification du crime de génocide ne sera retenue que si les
19
T.P.I.Y, Chambre d’appel, 19 avril 2004, arrêt, Le Procureur c/Radislav Krstić, IT -98-33 – A, § 36.
20
En règle générale, les instruments internationaux de droit international pénal se contentent d’incriminer les
comportements prohibés et obligent les États à domestiquer les crimes et à établir des peines pour en sanctionner
les auteurs. Toutefois, le Statut de la C.P.I. a ceci d’innovant qu’il prévoit — en plus des incriminations — un
chapitre relatif aux peines. Sur ces peines applicables aux crimes de la compétence de la Cour et le régime de leur
application, V., les articles 77 et 78 du Statut.
21
Le crime d’agression est incriminé par les articles 5 et 8 bis du Statut de Rome. La prise en compte des dommages
environnementaux devant la C.P.I. a lieu dans le cadre d’un conflit armé international où l’atteinte
environnementale peut être qualifiée de crime de guerre. L’article 8 alinéa 2 (b-iv) du Statut prescrit que puisse
constituer un crime de guerre, dans le cadre d’un conflit armé international « (…) le fait de diriger
intentionnellement une attaque en sachant qu’elle causera incidemment (…) des dommages étendus, durables et
graves à l’environnement naturel qui seraient manifestement excessif par rapport à l’ensemble de l’avantage
militaire concret et direct attendu ».
22
M. ALBARET, « Acteurs et interdépendances dans l’affaire Hissène Habré », Études internationales, Vol. 39,
n° 4, décembre 2008, pp. 563 et s..
 6
6
 7
7
 8
8
 9
9
 10
10
 11
11
 12
12
 13
13
 14
14
 15
15
 16
16
 17
17
 18
18
 19
19
 20
20
 21
21
 22
22
 23
23
 24
24
 25
25
 26
26
 27
27
 28
28
 29
29
 30
30
 31
31
 32
32
 33
33
 34
34
 35
35
 36
36
 37
37
 38
38
1
/
38
100%