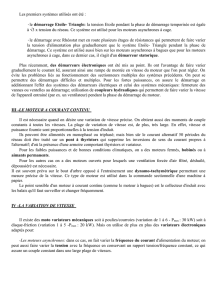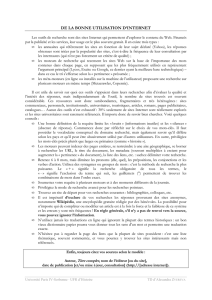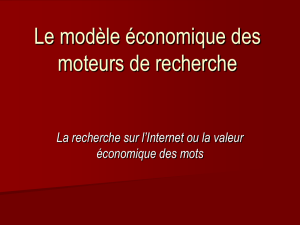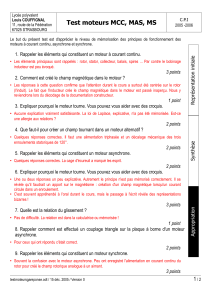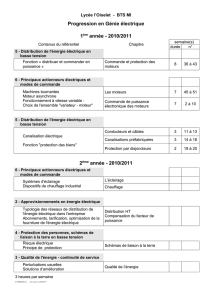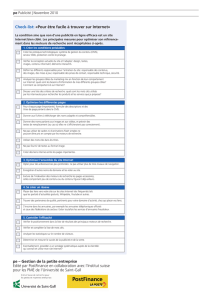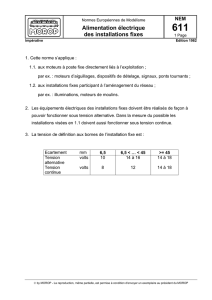Toute reproduction sans autorisation du Centre français d’exploitation du droit de copie est strictement interdite.
© Techniques de l’Ingénieur, traité Génie électrique D 3 490 − 1
D 3 490 6 - 1996
Moteurs asynchrones
Choix et problèmes connexes
par Maxime DESSOUDE
Ingénieur de l’École Nationale Supérieure d’Électricité et de Mécanique de Nancy
Ingénieur-Chercheur du Département Machines Électriques à la Direction des Études
et Recherches d’Électricité de France
Cet article est une mise à jour du texte rédigé par Michel FALLOU. Une grande partie de ce
texte a été conservée.
e moteur asynchrone est de beaucoup le moteur le plus utilisé dans toutes
les applications industrielles ou domestiques de l’électricité, du fait de sa
facilité d’installation, de son bon rendement et de son excellente fiabilité.
Il existe plusieurs types de moteurs asynchrones : monophasé, triphasé à cage,
triphasé à rotor bobiné (§ 1 et § 2).
1. Caractéristiques ....................................................................................... D 3 490 - 2
1.1 Généralités ................................................................................................... — 2
1.2 Moteur asynchrone triphasé....................................................................... — 3
1.3 Moteur asynchrone monophasé ................................................................ — 4
2. Différents types de moteurs asynchrones........................................ — 5
2.1 Généralités ................................................................................................... — 5
2.2 Rotor bobiné ................................................................................................ — 5
2.3 Rotor à cage ................................................................................................. — 5
2.4 Rotor à double cage .................................................................................... — 5
2.5 Rotor à encoches profondes....................................................................... — 5
3. Choix du moteur monophasé ............................................................... — 6
3.1 Comparaison entre moteur monophasé et moteur triphasé................... — 6
3.2 Démarrage des moteurs monophasés ...................................................... — 7
4. Choix des caractéristiques.................................................................... — 7
4.1 Tension nominale ........................................................................................ — 7
4.2 Réduction du courant de démarrage ......................................................... — 9
4.3 Détermination du couple ............................................................................ — 10
4.4 Puissance nominale et service nominal .................................................... — 12
4.5 Rendement................................................................................................... — 12
4.6 Conception ................................................................................................... — 13
5. Perturbations de la tension................................................................... — 14
5.1 Origine.......................................................................................................... — 14
5.2 Répercussions des coupures brèves.......................................................... — 14
5.3 Répercussions des creux de tension.......................................................... — 15
5.4 Contacteurs .................................................................................................. — 15
6. Vitesse variable ........................................................................................ — 15
6.1 Intérêt............................................................................................................ — 15
6.2 Réglage discontinu de la vitesse................................................................ — 16
6.3 Réglage continu de la vitesse..................................................................... — 17
6.4 Choix des variateurs de vitesse pour moteurs asynchrones................... — 21
7. Conclusion ................................................................................................. — 23
Pour en savoir plus........................................................................................... Doc. D 3 491
L

MOTEURS ASYNCHRONES _______________________________________________________________________________________________________________
Toute reproduction sans autorisation du Centre français d’exploitation du droit de copie est strictement interdite.
D 3 490 − 2© Techniques de l’Ingénieur, traité Génie électrique
La généralisation actuelle, au moins en Europe, des réseaux triphasés fait que
les moteurs monophasés, dont les performances sont inférieures à celles de leurs
homologues triphasés, ne sont plus employés que dans des applications
particulières où les puissances sont limitées à quelques kilowatts et où
l’alimentation se fait à basse tension (§ 3).
Plusieurs caractéristiques, dont les principales font l’objet de normalisation,
conduisent donc au choix d’un moteur asynchrone pour une application donnée :
la puissance nominale, le service nominal, la tension d’alimentation, le mode
de construction mécanique et le degré de protection des enveloppes (§ 4). Il faut
aussi veiller à ce que le démarrage se fasse dans de bonnes conditions pour le
moteur et la machine entraînée ainsi que pour le réseau d’alimentation. Deux
facteurs non complètement indépendants sont ainsi à surveiller : le couple et
l’intensité du courant de démarrage. Ces facteurs peuvent ainsi conduire à
orienter le choix technologique du moteur.
Le bon fonctionnement des moteurs peut être altéré par les perturbations de
la tension provoquées par les incidents de nature aléatoire intervenant sur les
réseaux et les installations électriques, qui résultent du fonctionnement des
automatismes de protection. Des précautions de mise en œuvre peuvent être
employées pour réduire la sensibilité des moteurs aux perturbations de types
creux de tension ou coupures brèves (§ 5).
En outre, avec les progrès de l’électronique de puissance, les utilisations de
la variation électronique de vitesse des moteurs se sont développées, en
particulier pour les applications industrielles. Il existe maintenant plusieurs
technologies d’entraînements à vitesse variable utilisant des moteurs
asynchrones qui couvrent une gamme très étendue de puissances et
d’applications (§ 6). La technologie du convertisseur de fréquence à onduleur de
tension commandé en modulation de largeur d’impulsions associé à un moteur
asynchrone à cage tend à s’imposer comme la solution de référence pour des
puissances atteignant quelques centaines de kilowatts.
1. Caractéristiques
1.1 Généralités
Le moteur asynchrone, fréquemment appelé moteur à induction,
comporte :
— un enroulement polyphasé inducteur, réparti sur une armature
cylindrique et parcouru par un système de courants polyphasés qui
engendre un champ tournant ;
Notations et symboles principaux
Symbole Unité Définition
CN · m couple (CD : démarrage, Cr : résistant)
fHz fréquence
g............. glissement
IA courant
LH inductance
H inductance de fuites
Ntr/min vitesse réelle
Nstr/min vitesse de synchronisme
PW puissance active
p............. nombre de paires de pôles
Qvar puissance réactive
RΩrésistance rotorique
SVA puissance apparente
UV tension composée
VV tension simple
α............. coefficient de stabilité (= Cmax /Cn)
η
............. rendement (
η
r : rotor)
ω
mrad/s pulsation mécanique (vitesse du rotor)
ω
rrad/s pulsation des courants induits (= g
ω
s)
ω
srad/s pulsation des courants inducteurs
Liste des Indices
1 primaire
2 ou r rotor
D démarrage
n nominal
s synchronisme
u utile

______________________________________________________________________________________________________________ MOTEURS ASYNCHRONES
Toute reproduction sans autorisation du Centre français d’exploitation du droit de copie est strictement interdite.
© Techniques de l’Ingénieur, traité Génie électrique D 3 490 − 3
— un second enroulement polyphasé, placé coaxialement de
façon qu’il soit balayé par le champ tournant qui y induit un deuxième
système de courants polyphasés.
■De l’action du champ tournant inducteur sur les courants induits
(qui créent à leur tour un champ tournant secondaire ayant la même
vitesse angulaire que le champ inducteur) naît un couple électro-
magnétique dont la valeur moyenne n’est, en règle générale, pas
nulle.
Normalement l’enroulement inducteur est fixe (stator), l’enrou-
lement induit est mobile (rotor). Sauf dans quelques cas particuliers
de fonctionnement, ce dernier enroulement est fermé sur lui-même,
et les courants induits n’en sortent pas.
■Il résulte, du principe même du moteur asynchrone [15] que le
rotor soumis à son seul couple électromagnétique ne peut tourner à
une vitesse angulaire égale à celle du champ tournant inducteur (dite
vitesse de synchronisme) : si, par un artifice quelconque, on le
portait à cette vitesse, il ne serait plus balayé par le champ statorique,
donc ne serait plus le siège de courants induits, et par suite ne serait
plus soumis au couple qui en résulte ; il tendrait à ralentir, jusqu’à ce
que les courants induits atteignent une amplitude suffisante pour
créer un couple égal, et de signe contraire, au couple mécanique
s’opposant à la rotation.
Pour caractériser la vitesse du rotor, on définit le glissement g,
qui est l’écart relatif entre la vitesse de synchronisme Ns et sa vitesse
réelle N soit :
(1)
et, on a :
ω
s = 2πf
ω
r =
ω
s – p
ω
m = g
ω
s
avec ffréquence du réseau,
pnombre de paires de pôles,
ω
mpulsation mécanique,
ω
rpulsation des courants induits,
ω
spulsation des courants inducteurs.
Les vitesses N et Ns sont exprimées en tours par minute et
ω
m
et
ω
s en radians par seconde.
1.2 Moteur asynchrone triphasé
L’étude et le calcul du fonctionnement d’un moteur asynchrone
étant traités dans l’article spécifique référencé [15], nous y
renvoyons le lecteur et nous nous contenterons ici de donner les
principaux éléments qui permettent de caractériser simplement un
moteur asynchrone.
1.2.1 Schéma équivalent
Le schéma équivalent le plus commode d’emploi est le schéma
monophasé de la figure 1 où le moteur asynchrone est assimilé à
un transformateur statique dont le secondaire serait fermé sur une
résistance R/g inversement proportionnelle au glissement. Dans ce
schéma :
I1est le courant primaire,
I2est le courant rotorique ramené au stator,
L1est l’inductance cyclique d’une phase statorique,
est l’inductance de fuites totales ramenée au stator,
Rest la résistance du rotor ramenée au stator,
RFe est une résistance qui représente les pertes fer,
V1est la tension étoilée au primaire.
Nota : les pertes magnétiques du moteur, représentées figure 1, sont faibles (1 à 3 %).
Elles ont globalement peu d’effet sur les caractéristiques du moteur. On n’en tient pas
compte dans les équations (§ 1.2.2), car elles seraient trop complexes.
On peut considérer que le courant :
représente, comme dans le schéma du transformateur, le courant
magnétisant de la machine ; mais alors que, dans un transformateur
ayant une puissance supérieure à quelques dizaines de kilovoltam-
pères, le courant magnétisant est inférieur ou égal à 2 % du courant
nominal, il est, dans un moteur asynchrone, de l’ordre de 30 à 40 %
de ce courant.
L’intérêt fondamental du schéma monophasé de la figure 1, qui
rappelons-le, ne tient pas compte de la saturation et des pertes Joule
au stator, est qu’il permet de déterminer aisément les caractéris-
tiques de fonctionnement d’un moteur asynchrone. En particulier,
on en déduit :
— la puissance active P2 fournie au rotor :
(2)
— la puissance utile Pu sur l’arbre :
Pu = P2(1 – g)(3)
— le couple C :
(4)
— le rendement du rotor
η
r :
η
r = (1 – g)(5)
— la puissance réactive totale Q1 :
(6)
en introduisant la tension composée .
gNsN–
Ns
-------------------
ω
sp
ω
m
–
ω
s
----------------------------==
ω
m2πN
60
--------------=
Figure 1 – Schéma monophasé équivalent
d’un moteur asynchrone triphasé
IµI1I2
–=
P2Rg
R22
ω
s
2g2
+
----------------------------------- U1
2
=
CP
2p
ω
s
-------- p
ω
s
-------- Rg
R22
ω
s
2g2
+
-----------------------------------U1
2
==
Q1
U1
2
L1
ω
s
---------------
ω
sg
R
----------------P2
+=
U1V13=

MOTEURS ASYNCHRONES _______________________________________________________________________________________________________________
Toute reproduction sans autorisation du Centre français d’exploitation du droit de copie est strictement interdite.
D 3 490 − 4© Techniques de l’Ingénieur, traité Génie électrique
On observe que la puissance utile [relation (3)] change de signe
avec g, ce qui correspond au fait que, au-delà de la vitesse de
synchronisme, le moteur se transforme en génératrice.
En revanche, la puissance réactive [relation (6)] est toujours posi-
tive et donc toujours fournie par le réseau ; on peut montrer qu’elle
est la somme :
— de la puissance réactive absorbée par le stator (puissance
magnétisante incluse) ;
— de la puissance réactive absorbée par le rotor, multipliée par
le rapport des pulsations
ω
s/g
ω
s.
Le réseau fournit donc l’énergie réactive du rotor, mais cela avec
un facteur multiplicatif 1/g.
1.2.2 Couple d’un moteur
La courbe du couple d’un moteur asynchrone en fonction de sa
vitesse [relation (4)] a l’allure de la courbe tracée sur la figure 2 :
— elle croît, d’abord, de manière sensiblement hyperbolique à
partir de l’arrêt (glissement égal à 1) ; où le couple initial de
démarrage, à vitesse nulle, a pour valeur :
— elle passe par un maximum :
pour une vitesse correspondant au glissement :
— puis, elle décroît pour atteindre, de façon presque linéaire,
une valeur nulle à la vitesse du synchronisme (g = 0).
Pour de faibles glissements (g de l’ordre de quelques pour-cent),
on peut représenter le couple par la formule simplifiée suivante :
Des impératifs de stabilité, sur lesquels nous reviendrons au
paragraphe 4.3.1, font que seule la partie décroissante de la courbe
C(N), correspondant à g < gmax , est utilisable.
1.2.3 Courant de démarrage
Au décollage d’un moteur, c’est-à-dire au tout premier instant de
son démarrage, la force contre-électromotrice qui s’oppose à la
tension appliquée à la machine est nulle ; il apparaît donc un courant
I1 élevé. Dans le cas du moteur asynchrone, ce courant est de l’ordre
de 5 à plus de 10 fois le courant nominal In, ce qui crée à la fois
une contrainte pour le moteur lui-même et une gêne pour le réseau.
Ce problème sera examiné au paragraphe 4.2.
1.2.4 Antinomie des caractéristiques
Les paramètres constructifs R, L1, intervenant de façon diffé-
rente dans les relations donnant les couples et les puissances (§ 1.2.1
et 1.2.2), il n’est pas possible de modifier une caractéristique d’un
moteur sans réagir de façon contradictoire sur au moins une des
autres.
1.3 Moteur asynchrone monophasé
L’enroulement inducteur monophasé ne peut, a priori, créer un
champ tournant ; toutefois, il engendre un champ alternatif qui est
décomposable en deux champs tournants de même amplitude, et
qui tournent l’un ➀ dans le sens direct, supposé être celui de
l’entraînement du rotor, l’autre ➁ dans le sens inverse : tout se passe
donc, du point de vue électrique, comme si l’on avait affaire à deux
moteurs triphasés identiques ayant des enroulements statoriques
montés en série, dont deux phases sont croisées, et des rotors
couplés sur le même arbre (figure 3a).
La tension étoilée U1 du réseau triphasé fictif alimentant ces
moteurs est égale à la tension réelle appliquée au moteur mono-
phasé.
La valeur du couple d’un moteur monophasé Cres [15], pour un
glissement donné g, est donc égale à la différence de deux couples
(figure 3b) :
— celui (Cd) correspondant au même glissement g, du moteur
triphasé de sens direct ;
— celui (Ci) correspondant au glissement 2 – g, du moteur
triphasé de sens inverse.
Il en résulte immédiatement que :
— le couple de démarrage est nul ;
— le couple maximal est inférieur à celui d’un moteur triphasé
de dimensions équivalentes et de même tension ;
— le couple à la vitesse du synchronisme Ns est négatif.
Nous reviendrons au paragraphe 3 sur les problèmes d’emploi
du moteur monophasé.
C0p
ω
s
-------- R
R22
ω
s
2
+
---------------------------- U1
2p
ω
s
-------- R
2
ω
s
2
-------------- U1
2
≈=
Cmax p
ω
s
-------- U1
2
2
ω
s
--------------
=
gmax R/
ω
s
=
Cp
ω
s
-------- g
R
------ U1
2
≈
■Pour augmenter le couple de démarrage, on peut augmenter
la résistance rotorique R, mais, ce faisant, on augmente le glisse-
ment correspondant au couple maximal, donc celui corres-
pondant au couple nominal, ce qui se traduit par une baisse de
rendement.
■Pour accroître le couple maximal, il faut diminuer la valeur de
, ce qui est également favorable au couple de démarrage, mais
se traduit par une augmentation du courant de démarrage.
Figure 2 – Courbe du couple d’un moteur asynchrone triphasé
en fonction de sa vitesse relative et de son glissement

______________________________________________________________________________________________________________ MOTEURS ASYNCHRONES
Toute reproduction sans autorisation du Centre français d’exploitation du droit de copie est strictement interdite.
© Techniques de l’Ingénieur, traité Génie électrique D 3 490 − 5
2. Différents types
de moteurs asynchrones
2.1 Généralités
■Les différents types de moteurs asynchrones ne se distinguent
que par le rotor.
■Dans tous les cas, le stator reste, au moins dans son principe, le
même : il est constitué d’un enroulement bobiné réparti à l’intérieur
d’une carcasse cylindrique faisant office de bâti et logé à l’intérieur
d’un circuit magnétique supporté par cette carcasse. Ce circuit
magnétique est formé d’un empilage de tôles, en forme de
couronnes circulaires, dans lesquelles sont découpées les encoches
parallèles à l’axe de la machine.
Nota : on trouvera, dans ce traité, dans l’article référencé [15], une figure présentant
les principales parties d’une machine asynchrone. En outre, pour avoir plus d’informations
sur la conception des moteurs asynchrones, il y a lieu de se reporter, dans ce traité, à l’article
référencé [16].
2.2 Rotor bobiné
Le rotor comporte un enroulement bobiné à l’intérieur d’un
circuit magnétique constitué de disques empilés sur l’arbre de la
machine. Cet enroulement est obligatoirement polyphasé, même si
le moteur est monophasé, et, en pratique, toujours triphasé à
couplage en étoile. Les encoches, découpées dans les tôles, sont
théoriquement parallèles à l’axe du moteur, mais, en fait, légèrement
inclinées par rapport à cet axe de façon à réduire certaines pertes
dues aux harmoniques.
Les extrémités de l’enroulement rotorique sont sorties et reliées
à des bagues montées sur l’arbre, sur lesquelles frottent des balais
en carbone. On peut ainsi mettre en série avec le circuit rotorique
des éléments de circuit complémentaires qui permettent des
réglages, par exemple de couple (§ 4.2.2) ou de vitesse (§ 6.3.3).
2.3 Rotor à cage
■Le circuit du rotor est constitué de barres conductrices régu-
lièrement réparties entre deux couronnes métalliques formant les
extrémités, le tout rappelant la forme d’une cage d’écureuil. Bien
entendu, cette cage est insérée à l’intérieur d’un circuit magnétique
analogue à celui du moteur à rotor bobiné.
Les barres sont faites en cuivre, en bronze ou en aluminium,
suivant les caractéristiques mécaniques et électriques recherchées
par le constructeur. Dans certaines constructions, notamment pour
des moteurs à basse tension (par exemple 230/400 V), la cage est
réalisée par coulée et centrifugation d’aluminium.
On démontre que, si le nombre de barres Nb est suffisamment
grand (soit, en pratique, ), la cage se transforme automa-
tiquement en un circuit polyphasé de polarité adéquate.
■Ce type de moteur, beaucoup plus aisé à construire que le moteur
à rotor bobiné, est d’un prix de revient inférieur et a une robustesse
intrinsèquement plus grande. Il n’est donc pas étonnant qu’il
constitue, et de loin, la plus grande partie du parc des moteurs
asynchrones en service.
Son inconvénient majeur est qu’il ne permet pas d’insérer un
rhéostat et qu’il a, au démarrage, de mauvaises performances
(courant élevé et couple faible). C’est pour remédier à cette situation
qu’ont été développés deux autres types de moteur (rotor à double
cage et rotor à encoches profondes).
2.4 Rotor à double cage
■Le rotor comporte deux cages coaxiales (figure 4) :
— l’une (fréquemment réalisée en laiton ou en bronze), externe,
à résistance relativement élevée, est placée près de l’entrefer ;
— l’autre (en cuivre), interne, de plus faible résistance, est noyée
dans le fer, ayant ainsi une inductance de fuites supérieure à la
première.
■Au démarrage, le courant rotorique, de fréquence égale à la
fréquence f du réseau d’alimentation, se répartit de façon inverse-
ment proportionnelle aux réactances des cages, qui sont alors
grandes devant les résistances. Dans ces conditions, c’est la cage
externe qui est parcourue par le maximum de courant ; sa relative-
ment forte résistance réduit l’appel de courant et accroît le couple.
Au contraire, lorsque le moteur atteint son régime nominal de
fonctionnement, normalement caractérisé par un faible glissement
g et une fréquence basse gf, ce sont les résistances qui contrôlent
la répartition du courant, ce qui favorise la cage interne de faible
résistance.
On peut, ainsi, obtenir des couples de démarrage CD de deux à
trois fois supérieurs à ceux du rotor à simple cage.
La figure 5 montre, en fonction de la vitesse, la variation du couple
d’un moteur à double cage, dont la cage externe est calculée pour
obtenir le couple maximal au démarrage.
2.5 Rotor à encoches profondes
Le rotor à double cage est beaucoup plus difficile à construire que
le rotor à simple cage et est donc d’un coût plus élevé.
Figure 3 – Moteur asynchrone monophasé
Nb
8
p
 6
6
 7
7
 8
8
 9
9
 10
10
 11
11
 12
12
 13
13
 14
14
 15
15
 16
16
 17
17
 18
18
 19
19
 20
20
 21
21
 22
22
 23
23
 24
24
 25
25
 26
26
 27
27
1
/
27
100%