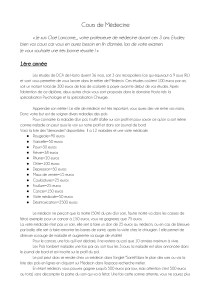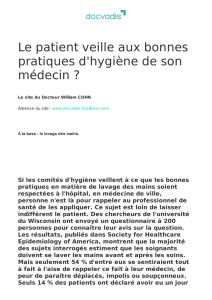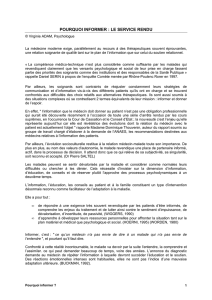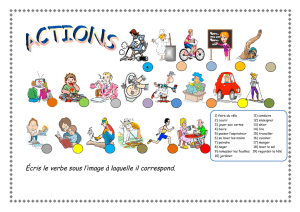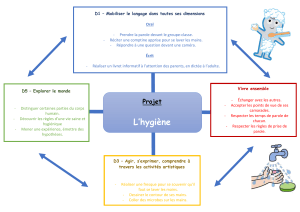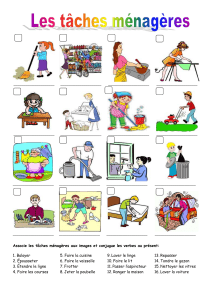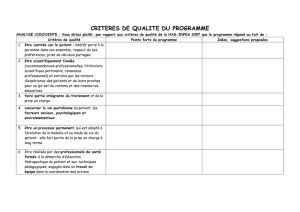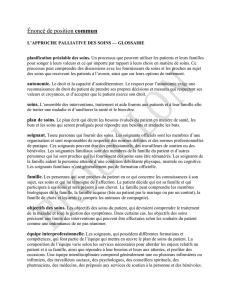Dépendance vs Autonomie : Commentaire sur les pratiques médicosociales
Telechargé par
B. Gattère

Sciences Sociales et Santé, Vol. 25, n° 4, décembre 2007
Dépendance versus autonomie…
De la signification et
de l’imprégnation de ces notions
dans les pratiques médicosociales
Commentaire
Myriam Winance*
« Nous sommes tous interdépendants… »
Dans une acception commune, autonomie est synonyme de liberté,
d’indépendance ; elle est définie comme la capacité du sujet à décider
pour lui-même des règles auxquelles il obéit, et à agir en conséquence.
Cette définition commune de l’autonomie est, comme le rappelle E. Bret,
héritée de la tradition philosophique occidentale, notamment des philoso-
phies cartésienne et kantienne (1). De Descartes, nous avons retenu sa
doi: 10.1684/sss.2007.0404
* Myriam Winance, sociologue, INSERM, CERMES, U750, France ; CNRS,
CERMES, UMR8169, France ; EHESS, CERMES, France ; Univ. Paris-Sud, CER-
MES, France ; Centre de Recherche Médecine, Sciences, Santé et Société (CERMES),
Site CNRS, 7, rue Guy-Môquet, 94801 Villejuif Cedex, France ; [email protected]
(1) Je résume ici de manière schématique une histoire philosophique longue et com-
plexe. Le lecteur pourra trouver des éléments plus développés notamment dans
Schneewind (2001).
SSS-12-07 16/11/07 11:08 Page 83

84 MYRIAM WINANCE
conception dualiste du sujet humain et le primat accordé à l’esprit, à la
rationalité et à la volonté, le corps étant réduit à un instrument, une
machine. Descartes a défini le sujet humain comme conscience de soi,
responsable de ses actes. De Kant, nous avons retenu sa conception de la
morale comme autonomie, comme gouvernement de soi (2). Ces concep-
tions ont profondément et durablement marqué nos manières de nous per-
cevoir, de nous représenter et de nous définir comme êtres humains. Elles
ont imprégné et déterminé certaines de nos pratiques, notamment dans le
champ médical (3).
Ainsi, comme le montre E. Bret dans son article, la notion de dépen-
dance, dans le champ des maladies chroniques et de la gériatrie — on
pourrait ajouter le champ du handicap (Reindal, 1999) — a été définie
par les professionnels par opposition à la notion d’autonomie. Ceux-ci
utilisent ces deux notions pour qualifier les personnes et leur situation, et,
par la suite, pour définir la nécessité d’une prise en charge et d’une aide.
La personne autonome est celle qui décide et agit seule, sans recours à
une aide ; la personne dépendante est celle qui, suite à une maladie ou un
accident, n’est plus capable de réaliser les diverses activités de la vie quo-
tidienne (activités physiques, sociales…) sans recourir à une aide. Ainsi
définie, la notion de dépendance réfère soit aux incapacités fonctionnel-
les de la personne (incapacités que l’on cherche à mesurer), soit à sa rela-
tion, plus ou moins intense, à un dispositif médical, social ou technique
compensant ses incapacités. La notion d’autonomie sert tout à la fois de
point de référence pour qualifier les personnes et d’objectif à atteindre
pour la personne et les soignants. Or, ces définitions ignorent l’ensemble
des relations qui structurent et soutiennent la personne qualifiée d’auto-
nome. L’autonomie n’est pas significative d’absence de liens, bien au
contraire. Une personne autonome n’est pas une personne qui décide et
agit seule, mais dont le pouvoir décisionnel et les capacités d’action sont
soutenus par de multiples relations (sociales, techniques, institutionnel-
les, symboliques…).
Les recherches menées dans le cadre de la sociologie des sciences et
des techniques (Callon, 1986 ; Latour, 1993) ont également conduit à
cette conclusion en montrant que l’action est distribuée et déléguée entre
(2) Kant est celui qui a développé l’idée selon laquelle nous avons tous une égale
capacité à concevoir par nous-mêmes ce que la morale exige et sommes également
capables de nous pousser à agir en conséquence (Schneewind, 2001).
(3) Sur l’utilisation de la notion de dépendance dans le champ de la vieillesse, voir par
exemple Ennuyer (2002). Sur l’imprégnation de la notion d’autonomie dans les pra-
tiques médicales, voir par exemple Gagnon (1998).
SSS-12-07 16/11/07 11:08 Page 84

DÉPENDANCE VERSUS AUTONOMIE 85
les entités humaines et non-humaines auxquelles chacun s’associe. Plus
récemment, plusieurs auteurs appartenant à ce courant (Gomart et
Hennion, 1999 ; Latour, 1996, 2000) ont introduit la notion d’attache-
ment ; celle-ci reprend l’idée selon laquelle l’action est déléguée et par-
tagée entre différentes entités, humaines et non-humaines, mais en
renouvelant la théorie de l’action sous la forme d’un « faire-faire », c’est-
à-dire d’une double causalité (« Lorsque j’agis, je suis en même temps agi
par cela même que je fais ») (4). La personne qualifiée intuitivement, ou
par les professionnels, « d’autonome » n’est pas une personne isolée,
mais une personne qui se fabrique et est fabriquée à travers ses relations
à différents dispositifs (Winance, 2001). Autrement dit, elle est à la fois
dépendante et autonome, ou encore, elle est autonome à travers les mul-
tiples dépendances qui la font.
Dès lors, on ne peut plus décrire la trajectoire des personnes attein-
tes d’insuffisance respiratoire chronique — ou plus largement d’une ma-
ladie chronique — comme le passage d’une situation caractérisée par
l’absence de liens, d’autonomie, à une situation de dépendance ; cette tra-
jectoire se présente comme une situation de « dépendance continue (…)
au monde social passant par un ensemble de liens se transformant tout au
long de la vie » (extrait du résumé de l’article). Ou encore, comme l’écrit
E. Bret, « Le sujet ne cesse pas d’être dépendant : ses liens se redistribuent
et il devient dépendant autrement au sein d’un réseau de relations trans-
formé ». D’où une remise en cause de l’opposition traditionnelle entre
autonomie et dépendance qui ouvre la question de la différence entre ces
deux notions.
En effet, l’apport des recherches empiriques, auxquelles l’article
précédent contribue de manière originale, est d’attirer l’attention sur les
liens et les interdépendances qui fabriquent chacun d’entre nous, que l’on
soit qualifié « d’autonome » ou de « dépendant ». Cependant, si les situa-
tions d’autonomie et de dépendance peuvent toutes deux être décrites
comme des situations d’interdépendance, si par ailleurs la vie des per-
sonnes peut être décrite comme une transformation des formes de dépen-
dance qui les soutiennent, on ne peut en rester à ces deux conclusions et
effacer complètement cet autre fait, émanant également du terrain : cer-
taines personnes se disent et se sentent autonomes, alors que d’autres se
disent et se sentent dépendantes. Autrement dit, qu’est-ce qui différencie
les deux situations ? Je voudrais explorer cette question et donner
(4) « L’attachement désigne à la fois ce qui émeut, ce qui met en mouvement, et l’im-
possibilité de définir ce faire-faire par l’ancien couplage de la détermination et de la
liberté » (Latour, 2000 : 204).
SSS-12-07 16/11/07 11:08 Page 85

86 MYRIAM WINANCE
quelques pistes de réponse, en me centrant d’abord sur la notion de
dépendance, puis sur celle d’autonomie.
« Je me sens et suis dépendant… »
L’un des points originaux que je voudrais souligner dans cet article
est d’aborder cette question des interdépendances et des relations qui
soutiennent tout un chacun, en se centrant sur la notion de dépendance,
moins étudiée que celle d’autonomie. L’objectif de E. Bret est d’analyser
ce qui caractérise la situation de ces personnes qualifiées de dépendantes
par les professionnels. En quoi leur « dépendance » est-elle spécifique ?
En quoi se différencie-t-elle de la « dépendance » qui soutient toute per-
sonne qualifiée d’autonome ? La réponse apportée par E. Bret est la sui-
vante. Ce qui différencie les deux situations, c’est la nature, la forme des
relations sociales que noue la personne, ainsi que leur nombre et leur
diversité. La maladie ou l’accident, en focalisant l’attention de la per-
sonne sur son corps, en concentrant ses efforts sur sa survie, entraîne un
processus de raréfaction des relations qu’elle entretenait avec des
humains (j’ajouterais, et des non-humains), plus ou moins nombreux,
divers et variés (5). À ces relations, se substitue une relation exclusive et
restrictive au dispositif biomédical, celui-ci suppléant les incapacités de
la personne. Cette raréfaction des relations s’accompagne en outre de
leur appauvrissement à leur seule dimension fonctionnelle. L’objectif cen-
tral et par moment unique des pratiques et du dispositif de prise en charge
mis en place (par exemple, dans les phases de décompensation respira-
toire et de réanimation) est de maintenir les fonctionnalités vitales « d’un
corps », lui-même réduit au statut d’organisme défaillant. Cette modifi-
cation de l’insertion sociale des personnes, sous forme d’une limitation au
dispositif biomédical, entraîne alors une transformation des affects et de
l’univers symbolique intériorisé par la personne, dans le sens d’une
régression. Cette transformation marque l’apparition de l’état et du sen-
timent de dépendance. Ceux-ci caractérisent une situation dans laquelle
la pluralité et la diversité des relations a laissé place à une relation exclu-
sive à un type de dispositif (le dispositif biomédical), souvent réduite à sa
seule dimension fonctionnelle. Ainsi, pour reprendre le vocabulaire de la
sociologie des sciences et des techniques, l’autonomie est caractérisée
par un « faire-faire », par une « passivité-activité », qui produit de la nou-
(5) J’ai, pour ma part, appelé ce processus, le processus de rétraction (Winance,
2003).
SSS-12-07 16/11/07 11:08 Page 86

DÉPENDANCE VERSUS AUTONOMIE 87
veauté, en termes d’actions, d’émotions… Elle est caractérisée par une
relation à double sens qui transforme les entités reliées, tout en leur lais-
sant une part d’initiative et en les dotant d’une capacité à agir. Dans cette
optique, « je peux agir parce que je suis agi à travers de multiples atta-
chements ». La dépendance est, quant à elle, caractérisée par un « simple
faire », un « faire à la place de » qui prive la personne de toute possibi-
lité de reprendre l’action à son compte pour la transformer et se trans-
former. La relation d’attachement et de fabrication mutuelle laisse la
place à une relation unilatérale dans laquelle l’une des entités est entiè-
rement définie par l’autre. D’où le sentiment d’enfermement, souvent évo-
qué par les personnes qui se disent et se sentent dépendantes.
L’analyse proposée ouvre des pistes de recherche intéressantes dans
la mesure où elle tient ensemble deux arguments importants, celui selon
lequel nous sommes tous dépendants d’une manière ou d’une autre, mais
également celui selon lequel la notion de dépendance pointe des situations
spécifiques dans lesquelles les relations sont raréfiées, appauvries et
enfermantes. Approfondir ce dernier argument à travers des études empi-
riques me semble essentiel, d’une part, pour comprendre ce sentiment de
dépendance qui, à certains moments, surgit et envahit la personne, la défi-
nit et est pour elle source de souffrance et, d’autre part, pour identifier,
différencier, puis qualifier les diverses formes de dépendance qui définis-
sent les personnes, leur corps, leurs qualités, leurs dispositions, leurs
capacités.
« J’apprends à devenir autonome »
La notion d’autonomie, comme celle de dépendance, est omnipré-
sente dans le champ médical et médicosocial. Tout comme la notion de
dépendance, elle est utilisée pour qualifier des personnes, mais aussi et
surtout pour définir les pratiques dans la mesure où elle s’impose comme
un but à atteindre (6). E. Bret l’évoque à plusieurs reprises : l’objectif du
dispositif médicosocial de prise en charge est de rendre autonomes les
personnes qualifiées au départ de dépendantes. La question qui émerge
est double ; elle est, d’une part, celle de la signification de l’autonomie et,
d’autre part, celle de la manière dont cette autonomie est « performée »,
la manière dont elle devient une qualité de la personne. Pour développer
ces deux aspects de la question, je me baserai sur les travaux de Pols qui
analyse ce que signifie « bien soigner » ou « bien prendre soin de » (en
(6) Dans ce cas, elle est souvent associée à celle de citoyenneté.
SSS-12-07 16/11/07 11:08 Page 87
 6
6
 7
7
 8
8
 9
9
1
/
9
100%