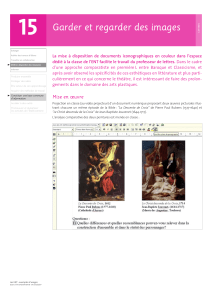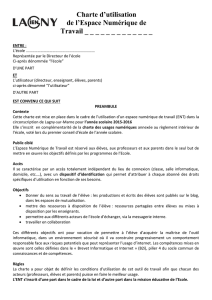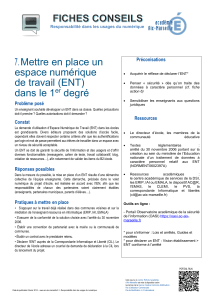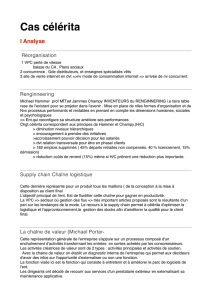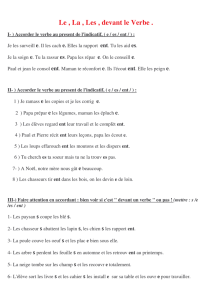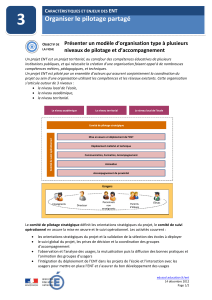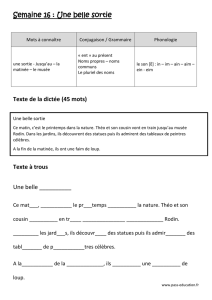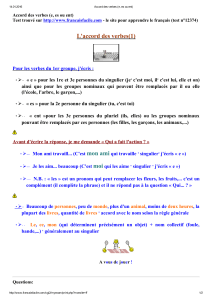Reproduction Artificielle des Roches Volcaniques
Telechargé par
Fatima Zohra BOUHLALI

LA R E P R O D U C T I O N A R T I F I C IE L L E
DES
ROCHES VOLCANIQUES
« N eque enim aliud est n atu ra quam a rs quæ dam m agna. »
Le i b n i z , Protogäa, ix.
Prise à ses débuts, la connaissance de l’écorce ter
restre est tout utilitaire : dans sa première phase, elle
nous apparaît comme imposée à l’homme par la né
cessité d’explorer les couches du globe, pour en extraire
les minerais, les matériaux de construction et les ma
tières combustibles.
Pour quiconque jette un coup d’œil sur l’histoire des
sciences, il devient évident qu’elles doivent toutes leur
origine à un but utile et pratique ; que toutes ont passé
par cette phase initiale pour suivre un développement
régulier, dont je vais esquisser la marche pour la géo
logie.
L’homme commence donc l’exploration des profon
deurs terrestres, aûn d’y puiser les matières qui doi
vent servir à ses besoins. D’abord, il le fait sans règle;
mais à m esure que l’art du m ineur se développe, la re
cherche des richesses m inérales est poursuivie avec
méthode : on observe les conditions dans lesquelles les
minéraux et les roches utiles se rencontrent au sein

du globe. D’empiriques et de locales qu’elles étaient à
l’origine, ces observations ne tardent pas à se généra
liser; elles permettent alors d’entrevoir quelques-uns
des traits saillants de l’architecture de notre planète.
En fouillant les entrailles de la terre, on en vient à se
convaincre que le globe n’a pas été fait d’un seul coup,
qu’il doit sa formation à des époques successives. On
s’était proposé d’abord de découvrir des règles pra
tiques pour le m ineur, et l’on est am ené graduellement
à déchiffrer l’histoire de la terre.
Depuis que, vers la fin du siècle dernier, on com
mença à appliquer Ja méthode inductive à l’étude des
masses minérales formant l’écorce du globe, à leur a r
chitecture et aux êtres dont les débris sont enchâssés
dans' les terrains, il s’est accum ulé un vaste ensemble
de documents sur l’histoire de notre planète.
C’est en m ettant en jeu cette méthode analytique,
en s’appuyant sur l’induction que le géologue inter
prète la formation des roches. L’observation nous ap
prend à y distinguer un prem ier groupe, caractérisé
par la disposition en couches ou en bancs : ce sont les
roches sédim entaires. Un second groupe, qui ne nous
offre point cette disposition stratifiée, com prend les
roches de nature volcanique, à structure massive.
Nous voyons les roches sédimentaires s’édifier,
lorsque nous observons com ment les eaux courantes
et la m er roulent et déposent sur leur lit des cailloux,
du sable et du limon. Après la mort des organismes
qui vivent dans ces eaux, leurs squelettes ou leurs
coquilles viennent se mêler aux substances minérales
et élever avec celles-ci des couches de sédiments. Ces
matières ainsi déposées prennent, par apport successif,
la disposition stratifiée. Toutes les particules qui les
constituent étaient prim itivement des grains isolés et
qui portent encore la trace de leur origine : ce sont
des débris de roches préexistantes ou des dépouilles

d’organismes que des actions physico-chimiques posté
rieures peuvent cimenter.
Le second groupe, dont nous aurons à traiter spé
cialement, comprend les roches massives; celles-ci
s’observent, en voie de formation, dans les manifesta
tions volcaniques. Les m atières fondues, vomies par
les cratères ou injectées dans les couches sédimentaires,
se consolident par refroidissement. Les éléments qui
constituent les laves sont des individus cristallins, dé
veloppés aux dépens de la pâte en fusion qui les en
châsse. Ces cristaux ne présentent rien de détritique
dans le sens que nous attachions, tout à l’heure, à ce
mot. A parler d’une m anière générale, la disposition
par couches des terrains sédimentaires n’est pas ind i
quée pour ces masses éruptives : au lieu de l’horizon
talité primitive, de la superposition régulière des
couches stratifiées, nous avons dans les laves une al
lure qui indique la poussée de bas en haut, à laquelle
elles ont été soumises lors de leur éruption. Enfin, ces
roches massives sont dépourvues de débris d’êtres or
ganisés.
Mais tandis que nous voyons se former, sous nos
yeux, les roches sédimentaires, que les conditions qui
président à leur origine peuvent être suivies d’assez
près, que cette œuvre s’accomplit pour ainsi dire tout
entière au grand jour, les masses éruptives commen
cent à s’élaborer dans les profondeurs de la terre ; leur
genèse est en quelque sorte entourée de mystère, le
regard ne peut sonder les vastes réservoirs souterrains,
où ces matières en fusion se pétrissent et d’où elles
sont projetées lors des éruptions volcaniques.
Pour résoudre les doutes, contrôler et compléter les
observations, on tente alors de reproduire artificielle
ment les roches volcaniques, d’en faire la synthèse.
Armé des données de l’observation qui doivent ser
vir de guide, ou s’efforce, par des manipulations sa

vantes, d’im iter les produits de la nature. La science
de la terre, d’analytique qu’elle était, entre dès lors
dans une dernière phase, celle des expériences synthé
tiques.
Quoique rapetissés à nos appareils, ces essais d’im i
ter la nature, conduits par l’intelligence de l’homme,
exécutés par ses mains, lui perm ettent de faire naître
des faits analogues à ceux qu’il veut approfondir, de
diriger et de surveiller la marche des phénomènes, de
se rendre un compte exact de leurs relations et de faire
varier à volonté les conditions où ils peuvent se pro
duire. Les connaissances acquises par l’observation,
l’analyse et le raisonnem ent sont ainsi, suivant l’ex
pression de Bacon de Verulam, soumises au fer et au feu
de l'expérience.
Nous venons d’indiquer à grands traits trois étapes
dans la marche des connaissances relatives à l’écorce
terrestre. Nous les avons entrevues à leur naissance, au
moment où elles se bornaient à des notions utiles pour
l’hum anité ; nous les avons suivies plus tard, lorsque,
se guidant par l’observation et le raisonnem ent, elles
s’élevaient à la hauteur d’une science. La géologie, en
trée dans une dernière phase, se transform e aujou r
d’hui en science expérimentale.
Nous allons montrer, en étudiant la reproduction ar
tificielle des roches volcaniques récentes, quel puis
sant secours les recherches du laboratoire peuvent ap
porter à l’observation directe de la nature. Mais avant
d’exposer les procédés de la synthèse des roches érup
tives contemporaines, nous avons à résum er ce que
l’analyse et l’observation des faits ont appris sur la
constitution et le mode de formation de ces masses
volcaniques. Le point de comparaison des synthèses se
trouve dans les laves naturelles ; ce sont des modèles
qu’on veut copier : il im porte donc de les connaître

par le menu, pour arriver à les im iter dans les détails
intimes.
Rappelons donc ce que nous savons des laves et des
conditions qui président à leur formation. Nous
n’avons pas à nous arrêter ici sur les grandes manifes
tations des forces internes du globe, ni sur le cortège
de phénom ènes qui les accompagnent, sur ces érup
tions formidables qui ébranlent le volcan jusque dans
ses fondements, et projettent des masses vitreuses pul
vérisées et des pierres embrasées. Au milieu de ce ca
taclysme, le cratère et les flancs de la montagne, en-
tr’ouverts sous la poussée des masses éruptives, laissent
échapper des flots de laves, qui se déroulent sur les
pentes, et s’y solidifient lentement.
Le fait capital de l’éruption, c’est l’émission de la lave
et celle des éléments volatils qui, dans les phénomènes
volcaniques, joue, pour le moins, un rôle aussi im por
tant que les courants de matières fondues. A parler
d’une m anière générale, on ne peut mieux comparer la
lave qu’à un verre liquéfié sous l’influence des hautes
tem pératures qui régnent sous l’écorce solide du globe.
Les observations directes sur la tem pérature de la lave
liquéfiée du cratère, faites au moment même de l’érup
tion, sont entourées de périls que peu d’observateurs
ont osé affronter. Aussi ne possédons-nous sur ce
point que des indications approximatives. Les volcans
où l’épanchem ent des laves ne dépasse pas un certain
degré d’intensité, mais qui sont dans un état d’activité
modérée et permanente, comme à l’île Hawaï, ont per
mis à d’intrépides savants d’approcher assez près du
cratère pour tenter d’évaluer la température de la
masse liquéfiée. Ils ont pu constater ainsi qu’elle oscille
entre 1000° et 2000° C. C’est le lieu de rappeler ici les
expériences sur la température de la lave de l’Etna,
faites en 1865 par M. Fouqué, en introduisant dans la
masse fondue des fils métalliques. Ce sont ces essais
 6
6
 7
7
 8
8
 9
9
 10
10
 11
11
 12
12
 13
13
 14
14
 15
15
 16
16
 17
17
 18
18
 19
19
 20
20
 21
21
 22
22
 23
23
 24
24
 25
25
 26
26
 27
27
 28
28
1
/
28
100%