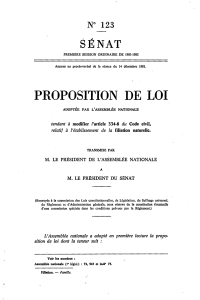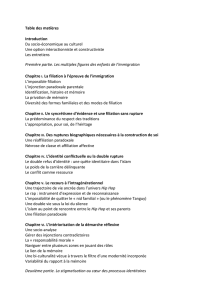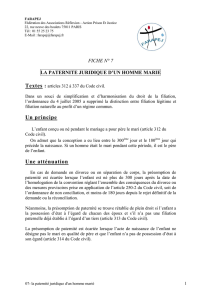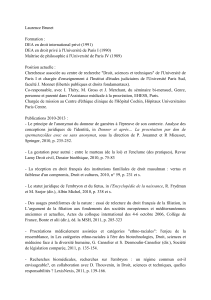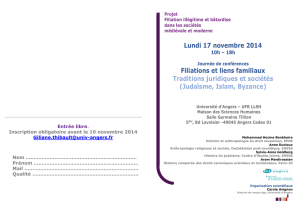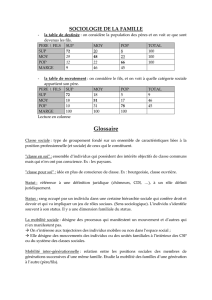Bulletin de psychologie
Devenir parent par l’adoption : étude de cas
Alain Rioux
Citer ce document / Cite this document :
Rioux Alain. Devenir parent par l’adoption : étude de cas. In: Bulletin de psychologie, tome 55 n°460, 2002. pp. 367-371;
doi : https://doi.org/10.3406/bupsy.2002.15143;
https://www.persee.fr/doc/bupsy_0007-4403_2002_num_55_460_15143;
Fichier pdf généré le 27/02/2024

bvlleTÎN de psychologie / tome 55 (4) /460 / juillet-août 2002
Alain François RIOUX*
Devenir parent par l’adoption :
étude de cas
La filiation adoptive, filiation «hors-corps »
peut être définie comme une filiation symbolique
légitimée par la loi. Le désir d’enfant dans le cas
spécifique de l’impossibilité de concevoir un
enfant conduit quelquefois le sujet àposer un acte
d’adoption. Un «choix »inconscient est-il àl’ori¬
gine de l’acte d’adoption ?
La souffrance est souvent associée à l’absence
d’enfant et à la stérilité d’un ou des deux membres
du couple. Si le désir du sujet est àl’origine de la
demande d’adoption, ce dernier doit faire avec une
forme de «castration symbolique », celle imposée
par le corps social dans lequel il vit et représentée
par la loi. Chaque sujet doit, ainsi, «passer du désir
à la loi ».
La recherche présentée dans ce travail concerne
une femme confrontée àune «stérilité psychogè
iîc »non reconnue pur les médecins.
L’ASPECT JURIDIQUE, UNE DÉMARCHE
SYMBOLIQUE LÉGITIMÉE PAR LA LOI
Adopter vient du latin adoptare qui signifie
«prendre par choix ». L’adoption naît de la volon¬
té d’adultes de prendre un enfant en charge et de le
considérer, même s’il n’est pas naturellement le
leur, comme leur fils ou leur fille.
Avec la loi de 1966, l’adoption plénière assimile
entièrement l’enfant adopté àl’enfant légitime. Elle
supprime la différence qui subsistait en matière
successorale et elle entraîne la rupture des liens
avec la famille d’origine. L’adoption plénière est
irrévocable. L’ancienne adoption révocable, qui ne
rompt pas les liens avec la famille d’origine, est
désormais appelée «adoption simple ».
L’adoption est désormais possible pour toute per¬
sonne âgée de plus de 35 ans, célibataire ou mariée.
Avec la loi du 22 décembre 1976 la présence d’en¬
fants légitimes n’est plus un obstacle àl’adoption.
J. Rubellin-Devichi (1991) note que le tribunal
bénéficie de pouvoirs exceptionnels en matière
d’adoption. Elle rappelle que Bonaparte considère
qu’il est de la seule compétence du tribunal de pro¬
noncer l’adoption, de créer ce lien de filiation, «par
une sorte de sacrement civil ». Le prononcé du
jugement d’adoption par le tribunal permet d’asso¬
cier le désir d’enfant de l’adoptant et la loi en
créant un lien de filiation adoptif. En effet, seule
l’adoption, filiation légitimée et garantie par la loi
permet de répondre au désir et àla demande d’en¬
fant du sujet. La filiation adoptive est la seule qui
dissocie la sexualité génitale, la procréation et la
fonction de parent. Cette filiation reconnaît au sujet
la qualité de parent et lui garantit un enfant avec
des caractéristiques propres :abandon, couleur de
peau, ethnie, sexe, handicap (ou non)... Elle donne
donc certaines «garanties »et des «assurances »
qui rassurent et renarcissisent les sujets devenus
parents adoptifs après un agrément donné par un
représentant du corps social.
Mais existe-t-il une problématique psychique à
l’œuvre chez les sujets qui posent un acte d’adop¬
tion ?
LA PROBLÉMATIQUE PSYCHIQUE
S’il existe des sujets non stériles, célibataires ou
vivant en couple qui souhaitent adopter un enfant,
la majorité des candidats àl’adoption sont confron¬
tés àla stérilité d’un ou des deux conjoints.
Le concept de stérilité
Il existe différentes «formes de stérilité »:phy¬
siologique (ou «somatique »), psychologique (ou
«psychogène »). Elles sont liées àl’impossibilité
de la fécondation ou àl’impossibilité de la nidifi¬
cation de l’œuf ou bien, encore, àl’impossibilité de
mener àterme une grossesse. D’une façon généra¬
le, nous utiliserons le terme d’infertilité.
L’origine étymologique du mot «fertilité »est
associée àla famille «offrir ». Picoche (1994) note
qu’offrir, souffrir et fertilité appartiennent àla
même famille d’une racine indo-européenne bher
qui signifie «porter ». Porter un enfant, souffrir
pour mettre au monde un enfant, offrir un enfant au
mari (ou àson père ?) ou encore «souffrir de stéri¬
lité »ou d’infertilité seraient alors liés étymologi¬
quement.
(*) Dialogue familial, Tours (37) ;Laboratoire de psy¬
chopathologie fondamentale et psychanalyse, Université
Paris 7.

368 bullETÎN (Je psycboloqiE
Bydlowski (1983) observe que l’infertilité peut
être considérée comme un avatar de l’ambivalence
dont se teinte le désir d’enfant :elle se présente
comme un échec de la cohésion entre les plans
conscients et inconscients du souhait d’enfant.
L’auteur précise que «se plaindre d’infertilité est
une façon de formuler dans le réel du corps offert
au médecin une souffrance psychique qui ne peut
pas se dire en tant que telle ». Ce peut être le conflit
œdipien incestueux avec le père ou encore «l’en¬
fant réclamé àune mère plus archaïque dans une
relation pré-génitale ». Quelquefois nous repérons,
dans l’histoire racontée par le patient, le scénario
d’une intimité père-fille. La stérilité protège ainsi
imaginairement la femme d’une réalisation du fan¬
tasme incestueux.
La stérilité est pour certains sujets la seule solu¬
tion psychique, le seul barrage àune représentation
catastrophique que la grossesse ou la maternité réa¬
liserait, si elle intervenait. Ainsi un sujet peut
craindre la transmission d’une tare à l’enfant à
naître. La stérilité protège la descendance poten¬
tielle.
Mais la stérilité psychogène est souvent une
«affaire de couple ». Elle concerne alors la ren¬
contre et le dysfonctionnement des deux parte¬
naires. Chacun ade bonnes raisons inconscientes
de rester stérile. Leur partenariat amoureux et
conjugal pourrait être lié àcette «rencontre d’in¬
conscient àinconscient ». Pour Bydlowski (1983)
«la souffrance ne provient pas de la stérilité. La
stérilité témoigne de la souffrance ».
Le rapport àl’identification difficile àla mère
explique après-coup (et dans certains cas) la pro¬
blématique de stérilité. Selon Bydlowski (1983),
c’est le problème de l’identification difficile àune
mère rejetante qui peut conduire àla dépression de
la «mère »adoptante et l’identification réparatrice
àl’enfant àadopter.
La filiation et la fonction du père
L’enfant, dans la filiation de Freud (1917b), est
un cadeau mais aussi, inconsciemment, un possible
excrément. L’enfant est inconsciemment, dans cer¬
tains cas, un cadeau offert au père de la femme. La
déception rencontrée par la petite fille dans la rela¬
tion àson père peut être un élément de la problé¬
matique psychique du sujet devenu adulte qui pose
un acte d’adoption.
Bouchait (1985) analyse «la fonction limitative
remplie par un père réel sur la fonction de décep¬
tion, comme quelque chose de structurant qui per¬
met de s’identifier, qui permet aussi de devenir
adulte àson tour. »
Ainsi les images parentales influencent le
«choix »du sujet pour la filiation adoptive.
L’image paternelle expliquerait ce «choix »
inconscient chez la femme qui pose un acte d’adop¬
tion. Ceci implique une réflexion concernant la
fonction paternelle.
Selon Hurstel (1979), dans ce qui fait désigner
des hommes comme «père carent »ou «père par¬
fait », une même figure est àl’œuvre, celle du père
idéal. Aucun père n’échappe àcette exigence
d’idéal liée au nom même qu’il porte. Par ailleurs
l’image maternelle, sa faiblesse devant le père ou,
au contraire, sa toute puissance peut, chez certains
sujets, conduire la femme àl’impossible identifica¬
tion à la mère.
Legendre (1985) explique :«au moment de sa
reproduction, tout sujet doit céder sa place d’enfant
àson propre enfant ». Hurstel (1979) précise que le
cadre institutionnel où s’opère la «permutation
symbolique des places »est la famille :«les sys¬
tèmes de parenté sont organisés de telle façon
qu’une seule personne ne peut occuper qu’une
place àla fois. Chaque place est articulée aux
autres places pour que, juridiquement aucune
confusion ne soit possible ». Chacun perd quelque
chose et gagne autre chose. La permutation symbo¬
lique des places ne se fait pas par cumul des places
mais par perte et par «la permutation symbolique
du sujet àtravers les places juridiques désignées
sur la base de la relation œdipienne »(Legendre,
1985).
La loi de l’interdit de l’inceste et la différence
entre les générations organisent la filiation humai¬
ne. Ainsi Legendre signifie que la relation œdipien¬
ne établie entre l’enfant et ses parents participe,
dans la société occidentale, àla fondation de la
légitimité juridique :la filiation symbolique (le
nom) est associée soit àla filiation biologique, soit
àla filiation éducative pour que les sujets soient
reconnus comme parents légaux.
L’enfant adoptif présenterait alors certaines qua¬
lités et la conformité nécessaires pour répondre au
désir inconscient du sujet qui pose un acte d’adop¬
tion. Il fournit au couple une «assurance », celle de
la légitimation adoptive, sur ses capacités «paren¬
tales ». Ainsi l’aventure œdipienne produit des ava¬
tars qui expliqueraient le choix de la filiation adop¬
tive.
L’hypothèse générale dans le cadre de laquelle
nous nous situons est que le «choix »de l’adoption
consiste en une stratégie inconsciente de réponse
aux avatars de l’aventure œdipienne pour le sujet
stérile. Nous voulons vérifier que la dissociation de
la procréation et de la sexualité génitale sont des
nécessités psychiques pour le sujet. La filiation
adoptive légitimée par la loi devient alors une solu¬
tion àla problématique psychique du sujet.
MÉTHODOLOGIE DE LA RECHERCHE
Les entretiens se déroulent dans le cadre de la
demande d’agrément en vue d’adoption par des

bullETÎN (Je psycholoqiE 369
sujets vivant en couple ou célibataires. L’objectif
de cette étude est d’effectuer un travail clinique
dans le champ de l’adoption et de mettre àl’épreu¬
ve notre hypothèse. Nous avons rencontré une
quinzaine de cas par an sur une dizaine d’années.
L’étude de cas que nous avons choisi d’analyser
dans ce travail porte sur une femme, Mme Farebuc
(Farebuc est un nom modifié), venue accompagnée
de son mari dans le cadre de la demande d’agré¬
ment du couple, en vue d’adoption. Nous présen¬
tons ce cas pour son intérêt clinique. Il est repré¬
sentatif d’une situation fréquente :la stérilité du
couple sans origine médicale reconnue.
Nous avons conduit un entretien psychologique
avec le couple puis des entretiens individuels avec
chacun des conjoints. Dans le cadre de cette étude,
nous n’analyserons que les entretiens réalisés avec
Mme Farebuc. Us furent au nombre de quatre, espa¬
cés sur une période de six mois et durèrent chacun
une heure environ. Ainsi les entretiens avec le
couple ne sont pas rapportés dans leur intégralité.
Seuls les éléments cliniques qui illustrent notre
hypothèse sont présentés. Ainsi les entretiens avec
le mari, considéré comme «fertile »par les méde¬
cins, ne sont pas rapportés.
Nous émettons ainsi l’hypothèse de travail sui¬
vante :la problématique œdipienne du regard du
père admiré et «décevant »est présente chez Mme
Farébuc, une femme confrontée àune stérilité psy¬
chogène et qui pose un acte d’adoption.
ANALYSE CLINIQUE DES ENTRETIENS
Le couple Farebuc n’a pas d’enfant. Les méde¬
cins n’ont diagnostiqué aucun problème physiolo¬
gique tant chez M. que chez Mme Farebuc. Cette
dernière serait confrontée àune stérilité psychogè¬
ne qui rendrait impossible la procréation. Le couple
arefusé la proposition d’assistance médicale àla
procréation. Il préfère s’orienter vers la filiation
adoptive. Il s’agit de sa première demande d’adop¬
tion.
Un père admiré et «décevant »...
Le deuil de l’amour envers le père ne semble pas
effectué par Mme Farebuc. D’ailleurs elle affirme :
«J’étais admirative devant mon père, il n’a pas
voulu de cette admiration. J’ai laissé tomber, mon
père alaissé tomber cette admiration. Il avait peur,
il ne voulait pas que je devienne une jeune fille.
Mon père avait peur des femmes. Il avait peur de
ma sensualité. Il craignait d’être attiré par moi. Il
craignait que je sois attirée par lui. Il apeur de la
femme en moi. Àl’adolescence, il m’a freinée au
maximum, il ne voulait pas que je sois attirante,
séductrice par rapport aux garçons et par rapport à
lui. Il refusait que je porte des collants à14 ans. J’ai
été déçue par mon père. J’attendais beaucoup de
choses de lui. Il ne m’a rien donné. Il ne jouait pas
avec moi. Avec ma sœur, c’était différent, il jouait.
Il aurait préféré des garçons. Il était largué par rap¬
port àmoi. »Elle ajoute :« Je ne veux pas un mari
comme j’ai un père. Il considérait ma mère comme
plus bas que lui, comme moins intelligente que lui.
Il profitait qu’elle était sans revenu. Il avait son
côté supérieur. Mon père partait en week-end sans
nous, il n’investissait pas ses enfants !»
Mme Farebuc a le sentiment d’avoir été abandon¬
née par le père, de ne pas avoir été l’objet de désir
de sa part, de ne pas avoir été soutenue dans sa
féminité naissante. Non seulement son père «ne
fait pas couple »avec sa mère - lieu de l’identifi¬
cation féminine - sur le plan de l’amour mais il
délaisse sa fille qui aurait pu se substituer à sa
mère. La déception àl’égard du père mais aussi
envers les hommes est grande. Faire couple avec le
père est un fantasme présent dans la problématique
de Mme Farebuc. Celle-ci évoque ainsi sa « sensua¬
lité »naissante.
«Il ne m’a rien donné »:il ne lui asurtout pas
donné d’enfant, l’enfant que Mme Farebuc apu fan
tasmatiquement concevoir avec son père au
moment de sa féminité naissante. Ainsi il ne lui a
pas donné la possibilité d’accepter sa position
sexuelle en accord avec le sexe qui est physique¬
ment le sien.
Du père au mari...
Mme Farebuc explique :«Moi je me suis dit que
je ne voulais pas un man comme j’ai un père !»
M"" Farebuc expose très clairement sa dénégation
de la position de «père idéal »que représente M.
Farebuc. Il est le père idéal qu’elle n’a pas eu. Ace
titre, pour qu’il ne perde pas cette position incons¬
ciente, la conception biologique d’un enfant est
psychiquement impossible. Mme Farebuc maintient
ainsi sa position œdipienne de «petite fille ». Elle
s’est déplacée de sa famille vers son «couple », de
son père vers son mari.
Mme Farebuc explique que Michel, son mari,
effectue un travail d’explication et d’instruction (de
maître ?), tout àfait significatif àson égard. D’une
certaine façon Mme Farebuc reste la petite fille
qu’elle aurait souhaité être avec son père. Nous
pouvons relier l’hypothétique désir d’enfant de Mme
Farebuc -et l’impossibilité de concevoir un enfant
biologique - avec la relation singulière au père et
au choix du «mari-père ».
Elle ne s’aime pas et n’aime pas les autres. Elle
le dit brutalement :«Je me fous des autres, de leur
regard, sauf du regard de mon mari. Le regard de
mon mari et le mien me suffisent !»
La question du narcissisme semble être au cœur
de la problématique psychique àl’œuvre chez Mme
Farebuc. Le mari occupe une place privilégiée pour
cette femme, celle de l’homme le plus important,
celle du premier homme !Le «premier homme »

370 bullETÎH dE psycholoqiE
d’une femme, celui qui porte le regard sur la petite
fille est habituellement le père ou son substitut. Mme
Farebuc considère que son père n’a pas joué son
rôle de père àson égard. Elle adonc trouvé le
regard d’un père chez son «mari-père ». Celui-ci
participe au fantasme de Mme Farebuc qui permet à
celle-ci de se maintenir en vie et de se restaurer nar
cissiquement.
M. Farebuc paraît être une sorte de «maître »
d’école ou «d’initiateur »pour Mme Farebuc. Il est
celui qui la forme :il lui explique les choses
comme àune petite fille qu’elle n’a pas toujours pu
être pour son père. Il joue le rôle qu’elle eut aimé
que son père jouât auprès d’elle. D’ailleurs Mme
Farebuc achoisi un homme dont la profession est
professeur des écoles.
DISCUSSION
La question du père est cruciale pour Mme
Farebuc. Sa relation œdipienne maintenue àl’égard
de son père s’articule au «choix »d’un conjoint à
l’image de certains traits du père. Concevoir biolo¬
giquement un enfant avec le «mari-père »apparaît
alors inconcevable sur le plan psychique parce que
transperçant l’interdit de l’inceste.
Pour Laplanche et Pontalis (1976) le complexe
d’Œdipe «tire son efficacité de ce qu’il fait inter¬
venir une instance interdictrice (prohibition de l’in¬
ceste) qui barre l’accès àla satisfaction naturelle¬
ment cherchée et lie inséparablement le désir et la
loi ». Ils rappellent que, selon Freud (1924), le
complexe d’Œdipe de la fille «culmine dans le
désir longtemps maintenu d’obtenir comme cadeau
un enfant du père, de lui mettre au monde un
enfant ».
Selon Baladier (1993), le Surmoi qui dérive àla
fois du «narcissisme primitif et du complexe
d’Œdipe àla suite d’une identification au parent
rival et interdicteur (...) peut soit stimuler le Moi
dans sa poursuite d’un accomplissement, soit
l’écraser sous le poids de ses prohibitions ». Il
observe que «par masochisme, le Moi cherche àse
faire critiquer et châtier, comme s’il se complaisait
dans cette condition de victime incarnant la figure
parentale punitive ». L’auteur rappelle que, selon
Freud (1917 a), le Surmoi va «se montrer dur,
cruel, inexorable àl’égard du Moi qu’il asous sa
garde ». Kaufmann (1993) ajoute que «le conflit
œdipien tend às’éterniser chez la femme. Peut-être
même n’est-il jamais vraiment résolu ».
Nous rappelons que l’hypothèse générale de
notre recherche est de montrer que le «choix »de
l’adoption consiste en une stratégie inconsciente de
réponse aux avatars de l’aventure œdipienne pour
le sujet stérile.
Nous pensons l’avoir montré àpartir de l’étude
du cas de Mme Farebuc. Nous avons aussi validé
notre hypothèse de travail :la problématique œdi¬
pienne du regard du père admiré et «décevant »est
présente chez Mme Farebuc, femme confrontée à
une stérilité psychogène et qui pose un acte d’adop¬
tion.
Il s’agit de l’étude d’un cas singulier et nous ne
pouvons le généraliser àtoute situation où une
femme confrontée àune stérilité psychogène pose¬
rait un acte d’adoption. Nous avons montré, avec
l’étude de ce cas, que la dissociation de la procréa¬
tion et de la sexualité génitale sont des nécessités
psychiques pour le sujet. La filiation adoptive légi¬
timée par la loi devient alors une solution àla pro¬
blématique du sujet. L’adoption et seule cette filia¬
tion symbolique permet de «résoudre »une pro¬
blématique infantile personnelle. Ce qui est impor¬
tant pour Mme Farebuc, c’est, dit-elle, que l’enfant
soit adopté «grâce àla loi ». Cette problématique
singulière àce cas s’articule àla Loi universelle de
l’interdit de l’inceste et de la différence entre les
générations qui organisent la filiation humaine.
Dans le cas présent, «la mère d’adoption »,
même si elle occupe de par la loi une place de mère
symbolique, répond àune question posée d’une
place d’enfant, celle qui s’est posée pour elle
durant son histoire infantile àl’égard de ses propres
parents. Ainsi adopter un enfant, tente de répondre
àune question qui s’est posée àla mère adoptive
lorsqu’elle était enfant.
RÉFÉRENCES
Baladier (Charles). Culpabilité, dans Kaufmann
(Pierre), L’apportfreudien, Paris, Bordas, 1993, p. 81-86.
Bouchart (Anne), Rapoport (D.). Origines. D’où
viens-tu? Qui es-tu ?, Paris, Stock, 1985.
Bydlowski (M.), Cahen (F.), Dayan-Lintzer (M.),
Fonty (B.), Le Vaguerese (L.). Souffrir de stérilité,
Psychanalyse àl’université, n° 31, juin 1983, p. 459-476.
Freud (Sigmund). Le déclin du complexe d’Œdipe
[1924], Revue française de psychanalyse, 7, n°3, 1934, p.
394-399.
Freud (Sigmund). Deuil et mélancolie [1917a] dans
Freud (Sigmund), Métapsychologie, Paris, Gallimard, 1968,
p. 145-173.
Freud (Sigmund). Sur la transformation des pulsions
particulièrement dans l’érotisme anal [1917b], dans Freud
(Sigmund), La vie sexuelle, Paris, PUF ,1985, p. 106-112.
Hurstel (Françoise). Carence et toute-puissance :la
question du père, Enfance, n° 3-4, 1979, p. 227-235.
Kaufmann (Pierre). Complexe, dans Kaufmann
(Pierre), L’apport freudien, Paris, Bordas, 1993, p. 70-72.
 6
6
1
/
6
100%