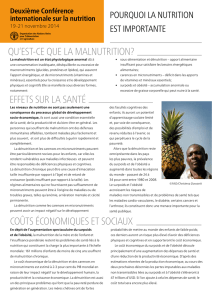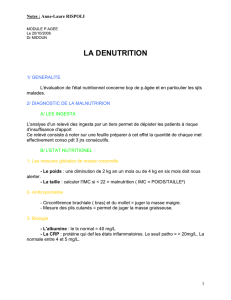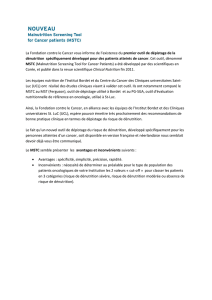Malnutrition infantile au Bénin : Revue de littérature
Telechargé par
sossouhountoarielle

PLAN DE REVUE LITTERAIRE : Mise au point d’aliments thérapeutiques prêts à
l’emploi pour la prise en charge de la malnutrition des enfants de 6-59 mois et des FAP au
Bénin.
Première partie : Revue de littérature
Chapitre 1 : Malnutrition : Définitions, prévalences et manifestations
1-1- Généralités sur la malnutrition
La malnutrition a pour origines étymologiques malus (mauvais) et nutrire (nourrir) (St. Louis,
Elsevier, 2009). Elle définit un statut nutritionnel défavorable, hors des valeurs de référence,
avec soit une dénutrition (carence d’un ou de plusieurs nutriments essentiels) soit une
suralimentation (consommation excessive d’un ou plusieurs nutriments) (Solomons, 2006).
Historiquement, les préoccupations nutritionnelles des sociétés pré-industrialisées à faibles
revenus des régions tropicales et subtropicales sont plutôt du côté de la dénutrition avec des
carences en nutriments. Mais des bouleversements dans la nature de ces sociétés en voie de
développement et notre meilleure compréhension de la nutrition humaine et clinique ont permis
de mettre en exergue des aspects évolutifs sur le problème de la malnutrition dans ces pays. La
présente revue tente d’exposer les principales nouveautés scientifiques et pédiatriques dans ce
domaine en pleine évolution.
Aujourd’hui, pour de nombreuses raisons incluant la pauvreté, la dégradation de
l’environnement, les maladies endémiques et pandémiques, les pays en développement sont le
chaudron des problèmes liés à la dénutrition en médecine clinique et santé publique. Certains
problèmes nutritionnels et carences alimentaires sont connues depuis des siècles. Les famines
de l’antiquité ont permis au monde médical de comprendre que le jeûne cause une inanition et
un épuisement des stocks corporels de graisses et de muscles. Les premiers explorateurs ont
souvent noté que les habitants autochtones rencontrés lors des expéditions sur les côtes ou les
îles maritimes du monde sont souvent de plus petite taille que les marins et les soldats
européens. Cependant, il a aussi été récemment documenté que les groupes ethniques européens
du 19ème siècle étaient plus petits que ceux d’aujourd’hui ( Helmchen , 2002), un phénomène
attribué à des régimes alimentaires moins nourrissants. Les prémices de la nutrition médicale

en santé publique sont généralement attribuées à la description du syndrome de «kwashiorkor»
par Williams (1933), qui travailla dans la région nommée à l’époque «Côte-de-l’Or» (Ghana)
en Afrique de l’Ouest dans les années 1930. Ce syndrome était fortement létal, et pouvait être
traité et guéri par l’administration d’une alimentation de haute qualité (Ashworth ,1979). En
fait, la dénutrition est reconnue comme un problème clinique de santé publique que depuis 7
décennies. Après la description du kwashiorkor, l’attention nutritionnelle du monde s’est
focalisée sur la dénutrition sévère. La première échelle diagnostique pour la classification
clinique de la dénutrition protéino-énergétique a été proposée en 1956 par une équipe de
pédiatres dirigée par le Dr. Federico Gomez (1956) à l’Hôpital Pédiatrique de Mexico (Mexico
City). Ils ont défini trois degrés de dénutrition, le troisième degré étant caractérisé par un poids
inférieur à 60% du poids de référence rapporté à l’âge, associé à des signes cliniques de la
dénutrition. Alors que la classification de Gomez était utilisée dans les services cliniques et
médicaux, elle n’était pas satisfaisante pour répondre à des besoins de santé publique. Dans les
années 1970, le Wellcome Trust (1973) a proposé un système de classification de la dénutrition
basé sur 3 critères. Le premier était une taille trop petite par rapport à l’âge, un arrêt de
croissance indiquant une dénutrition chronique. Le deuxième était une maigreur excessive par
rapport à la taille, une fente musculaire permettant de diagnostiquer une dénutrition aigüe. Le
troisième, dérivé de la classification mexicaine, était un faible poids comparé à la valeur de
référence par rapport à l’âge. Le poids étant systématiquement mesuré avec une précision
raisonnable, contrairement à la taille, le poids rapporté à l’âge est devenu un critère universel
utilisé par les épidémiologistes de santé publique et les organismes des Nations Unies.
Néanmoins, il a été reconnu très tôt que ce critère de poids en fonction de l’âge présentait des
limites (Trowbridge, 1979). Si une personne était trop petite, elle ne pouvait pas s’attendre à
avoir le poids d’un enfant du même âge mais beaucoup plus grand. Un petit enfant pouvait donc
avoir une composition corporelle normale – voire une obésité – tout en ayant un faible poids
par rapport à la valeur de référence pour son âge. De même, un enfant très grand pouvait être
extrêmement maigre pour sa taille mais avoir un poids similaire à la valeur de référence pour
son âge. Il était alors nécessaire de normaliser le poids par la taille, par un indice tel que celui
de masse corporelle de Quetelet (IMC, kg/m 2), pour pouvoir comparer des populations de taille
différente. Il a cependant fallu attendre jusqu’en 2000 pour que des valeurs de référence d’IMC
pour les enfants de la naissance à 20 ans soient publiées et puissent être utilisées
internationalement (National Center for Health Statistics, 2000 ; Cole TJ et al, 2000).

La suralimentation, caractérisée par un excès de graisse corporelle, est restée en marge des
préoccupations de classifications nutritionnelles en nutrition pédiatrique jusqu’à une époque
très récente. Ceci est vrai tant pour les pays développés que pour ceux en voie de
développement. En 1994, Popkin a introduit le concept de « transition nutritionnelle ». C’est
un processus stéréotypé évolutif et généralisé dans le lequel des excès nutritionnels avec des
conséquences négatives sur la santé apparaissent et coexistent avec des problèmes traditionnels
de dénutrition et carences nutritionnelles. La transition nutritionnelle est associée à un
changement de comportement alimentaire, avec l’augmentation de la consommation de
protéines et de graisses d’origine animale, de graisses et huiles séparées, ainsi que de sucres
simples au détriment de la consommation de sucres complexes (Drewnowski et Popkin , 1997).
Les excès et déséquilibres de cette alimentation ne sont pas restreints qu’aux macronutriments.
Des limites supérieures de tolérance pour la consommation de vitamines et minéraux ont été
établies par le comité de Nutrition et d’Alimentation de l’Institut de Médecine des États-Unis
(Food and Nutrition Board of the US Institute of Medicine en 1998. L’introduction croissante
de l’enrichissement des aliments de base et de produits industriels a commencé à devenir une
préoccupation légitime concernant la toxicité des quantités excessives de micronutriments
Allen et al, 2006). Avec le temps, ce double fardeau de la malnutrion – carences et excès pose
un dilemme pour le développement de la politique de santé et la conception puis la mise en
place de programmes nutritionnels (Solomons, 2006).
Selon l’organisation mondiale de la santé (OMS), la malnutrition se définit comme le
déséquilibre cellulaire entre la source de nutriments et d'énergie et les exigences du corps
permettant d’assurer la croissance et l'entretien des fonctions spécifiques (OMS, 2006). Elle se
rapporte à plusieurs maladies, chacune ayant une cause précise liée à une carence d’un ou
plusieurs nutriments. La malnutrition se caractérise par un déséquilibre entre
l’approvisionnement en nutriment, et en énergie d’une part et les besoins de l’Organisme pour
assurer la croissance, le maintien de l’état des diverses fonctions d’autre part (OMS, 2009). La
définition conventionnelle de la malnutrition chez les enfants, proposée par l'Organisation
Mondiale de la Santé (OMS) est le rapport poids pour-âge, taille-pour-âge ou poids-pour-taille
inférieurs à moins 2 écarts-type ; lorsque le niveau atteint moins 3 écarts-type, la malnutrition
est considérée comme sévère (Traoré, 2010).
1-2- Prévalences de la malnutrition

Dans le monde, 20,5 millions de nouveau-nés (14,6 % de l’ensemble des naissances vivantes)
ont un poids insuffisant à la naissance. Parmi les enfants de moins de 5 ans, un sur cinq souffre
d’un retard de croissance (149,2 millions), 45,4 millions (6,7 %), d’émaciation, et 38,9 millions
(5,7 %) sont en surpoids. En outre, 2,2 milliards d’adultes sont en surpoids ou obèses (40,8 %
des femmes et 40,4 % des hommes), 570,8 millions (29,9 %) de filles et de femmes en âge de
procréer (de 15 à 49 ans) sont anémiques, 538,7 millions de personnes (8,9 % des femmes et
10,5 % des hommes) sont diabétiques et 1,2 milliard (19,9 % des femmes et 24 % des hommes)
d’individus souffrent d’hypertension (ONU, 2021)
Au Bénin, 32 % des enfants de moins de 5 ans sont atteints d’un retard de croissance ou de
malnutrition chronique (ils sont trop petits pour leur âge) et 11 % en sont atteints sous la forme
sévère, 5 % sont émaciés ou souffrent de malnutrition aiguë (ils sont trop maigres par rapport à
leur taille), 1 % présente une émaciation sévère et 2 % un surpoids (EDS 2018)
Entre 2006 et 2017-2018 la prévalence du retard de croissance a baissé, passant de 43 % à 32
%. La prévalence de l’émaciation suit la même tendance, passant de 8 % à 5 %. Par contre,
l’insuffisance pondérale est demeurée pratiquement au même niveau (18 % en 2006 contre 17
% en 2017-2018). Dans la même période, le pourcentage d’enfants de moins de 5 ans présentant
un surpoids est passe de 9 % à 2 %. Le pourcentage de naissances de faible poids diminue avec
l’âge de la mère à la naissance de l’enfant, de 18 % lorsque la mère à moins de 20 ans à 11 %
lorsqu’elle a plus de 20 ans. Le pourcentage de naissances de faible poids est plus élevé quand
la mère fume des cigarettes que quand elle n’en fume pas (18 %, contre 12 %). Les résultats
selon le département montrent que c’est le Mono qui présente le plus faible pourcentage
d’enfants pesant moins de 2,5 kg à la naissance (7 %), et les départements de l’Atacora le niveau
le plus élevé (18 %) suivi par l’Alibori (17 %).
1-3- Stratégies de lutte contre la malnutrition
Chapitre 2 : ATPE : Évolution technologique et normative
2-1- Définition

2-2- Production, composition
2-3- Normes et standards internationaux
Chapitre 3 : stratégies de formulation d’un produit alimentaire
3-1- Approche conceptuelle de la formulation alimentaire
3-2- Principes fondamentaux de la formulation alimentaire
3-3- Analyse des paramètres de formulation
Chapitre 4 : Ressources alimentaires locales et potentiel nutritionnel
4-1 Cartographie des ressources alimentaires au Bénin
4-1- 1-Inventaire par région agroécologique
4-1-2- Caractérisation des principales filières
4-1-3- Analyse des disponibilités alimentaires
4-1-4-Potentiel nutritionnel par type de ressource
4-2- Transformations culinaires : Impact sur la qualité nutritionnelle
4-2-1- Techniques de préparation et modification nutritionnelle
4-2-2- Effets des procédés de cuisson sur les nutriments
4-2-3- Préservation de la valeur nutritive des aliments
Chapitre 5 : Facteurs déterminant l’acceptation d’un nouveau produit
5-1- Facteurs socioculturels et anthropologiques
5-2- Facteurs économiques
Références bibliographiques
Mosby Medical Dictionary, ed 8. St. Louis, Elsevier, 2009.
 6
6
1
/
6
100%