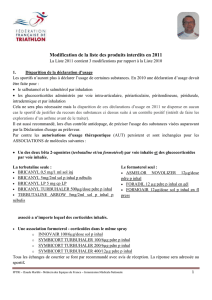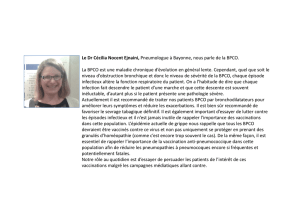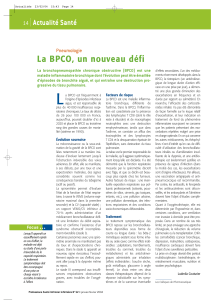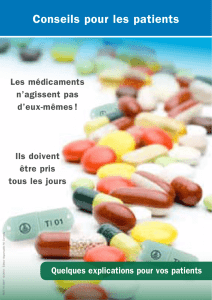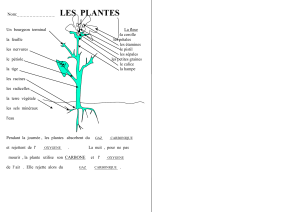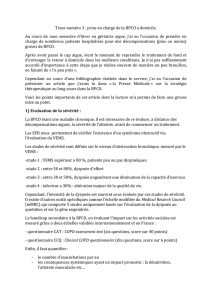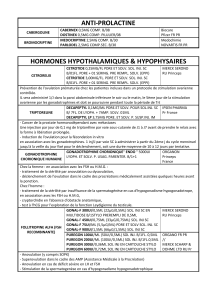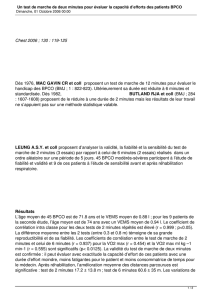BPCO : Guide complet sur la bronchopneumopathie chronique obstructive
Telechargé par
ametepemarius

BPCO
La maladie
La bronchopneumopathie chronique obstructive (BPCO) est une maladie respiratoire chronique caractérisée par une obstruction permanente et
progressive des voies aériennes. Une bronchite chronique non obstructive peut précéder la BPCO. L'asthme et la dilatation des bronches ne font pas
partie de la BPCO, mais peuvent coexister avec elle.
Physiopathologie
La principale cause de la BPCO est le tabagisme. L'obstruction bronchique est associée à une réponse inflammatoire anormale à des toxiques
inhalés (tabac, polluants, notamment professionnels, etc.).
Epidémiologie
La prévalence de la BPCO augmente avec le tabagisme et avec l'âge. On estime qu'elle touche en France environ 3 millions de personnes, soit une
prévalence estimée à 7,5 % dans la population âgée de 45 ans et plus, dont 1 million au moins sont symptomatiques.
Complications
L'évolution est marquée par un déclin accéléré de la fonction respiratoire, des épisodes d'exacerbations, avec aggravation progressive de la
symptomatologie conduisant au handicap et à une réduction de l'espérance de vie. L'évolution peut aboutir à une insuffisance respiratoire chronique.
Une amélioration des débits bronchiques et des symptômes est possible sous traitement, mais sans normalisation.
Diagnostic
Le diagnostic de BPCO repose sur les épreuves fonctionnelles respiratoires (EFR), pratiquées en présence de facteurs de risque (âge > 40 ans,
tabagisme passé ou présent > 10 paquet-années, exposition professionnelle, etc.) et/ou de symptômes chroniques (SC) évocateurs : toux et/ou
expectoration habituelle, dyspnée d'exercice, infections respiratoires basses répétées. La BPCO est définie par la présence d'une obstruction
bronchique permanente, avec rapport volume expiratoire maximal par seconde (VEMS) sur capacité vitale (CV), VEMS/CV inférieur à 0,70 (ou 70 %)
après administration de bronchodilatateurs.
On définit, en fonction du degré d'altération du VEMS (mesuré après bronchodilatateurs), 4 stades de sévérité de l'obstruction bronchique au cours de
la BPCO. (Voir plus loin Évaluation.)
L'évaluation de la sévérité de la maladie doit aussi tenir compte des symptômes (dyspnée d'exercice évaluée par l'échelle du Medical Research
Council modifiée (mMRC), de l'état de santé global (qualité de vie), du niveau de limitation des activités (handicap), de la fréquence des exacerbations
et de leur sévérité.
La mesure des volumes pulmonaires montre souvent une distension thoracique, conséquence de l'obstruction bronchique et mécanisme principal de
la dyspnée.
Quels patients traiter ?
Tous les fumeurs doivent être pris en charge pour un sevrage. Le traitement médicamenteux ou non est adapté aux symptômes et au degré d'altération
de la fonction respiratoire.
Objectifs de la prise en charge
Réduction de la dyspnée, amélioration de la tolérance à l'effort et de la qualité de vie.
Diminution du nombre et de la sévérité des exacerbations.
Réduction des facteurs de risque.
Ralentissement de la vitesse de déclin de la fonction respiratoire et réduction de la mortalité.
Prise en charge
BPCO

1
2
3
4
5
Sevrage tabagique
L'arrêt du tabac est la seule mesure susceptible de rétablir un rythme de décroissance normal du VEMS (qui décroît progressivement tout au long
de la vie). Grade A
Lire Tabagisme : sevrage.
Vaccinations
La vaccination antigrippale est indiquée chez les patients atteints de BPCO. Elle réduit de 50 % la mortalité par infection grippale chez les
patients de plus de 65 ans. Grade A
Le vaccin antipneumococcique est souhaitable au minimum chez les plus de 65 ans ou en cas de BPCO sévère. Grade C
Bronchodilatateurs inhalés
Les bronchodilatateurs bêta-2 agonistes et anticholinergiques inhalés sont le principal traitement symptomatique des BPCO. Grade A Le choix
de la classe dépend de la réponse individuelle et des effets indésirables. Grade C Si utilisation pluriquotidienne de bronchodilatateurs d'action
courte, préférer les formes à durée d'action longue, en particulier pour stades II à IV.
Ils ne seront poursuivis que si bénéfiques sur les symptômes.
À tous les stades, des bronchodilatateurs d'action courte peuvent être utilisés à la demande.
Corticostéroïdes inhalés
Aucun corticoïde inhalé pris isolément n'a l'AMM dans la BPCO. Seules les associations fixes avec un bronchodilatateur ont une AMM, bien plus
restrictive que dans l'asthme, limitée aux patients dont le VEMS est notablement diminué par rapport à la valeur théorique présentant des
exacerbations répétées et des symptômes malgré un traitement bronchodilatateur régulier.
Autres prescriptions

6
Les antitussifs sont contre-indiqués. En cas d'insuffisance respiratoire chronique notamment hypercapnique, les médicaments susceptibles
d'entraîner une dépression respiratoire doivent être utilisés avec précaution et seulement s'ils sont strictement indispensables.
Les fluidifiants bronchiques ne sont pas recommandés.
Traitement symptomatique par voie orale
Les bêta-2 agonistes par voie orale ont une action plus lente qui dure plus longtemps. Ils ont plus d'effets indésirables. Leur usage devrait se
limiter aux patients incapables d'utiliser les formes inhalées.
La théophylline a un rapport efficacité/tolérance inférieur à celui des bronchodilatateurs inhalés et n'est pas recommandée en traitement de
1re intention de la BPCO.
Cas particuliers
Prise en charge des exacerbations
L'exacerbation est un événement aigu caractérisé par une aggravation des symptômes respiratoires au-delà des variations quotidiennes et d'une
durée supérieure à 24 heures, conduisant à une modification du traitement.
La majorité des exacerbations peut être prise en charge en ambulatoire, avec une réévaluation clinique précoce pour vérifier l'efficacité du
traitement.
Des bronchodilatateurs doivent être systématiquement prescrits Grade A jusqu'à l'amélioration des symptômes.
Les causes les plus fréquentes des exacerbations sont des infections virales et/ou bactériennes. Près d'un tiers des causes n'est pas identifié.
Une antibiothérapie est recommandée dans les stades II et III en cas de franche purulence verdâtre des crachats et dans tous les stades IV.
Les antibiotiques à utiliser varient selon le stade et l'existence ou non de facteurs de risque.
En l'absence de facteurs de risque, il est possible de prescrire durant 5 jours :
amoxicilline-acide clavulanique 1,5 g d'amoxicilline par jour,
ou amoxicilline 3 g par jour,
ou pristinamycine 3 g par jour,
ou macrolide.
En présence de facteurs de risque, il est recommandé de prescrire :
amoxicilline-acide clavulanique 3 g d'amoxicilline par jour,
ou céphalosporine de 3e génération (C3G),
ou fluoroquinolone de 2e génération.
Une réévaluation clinique est indispensable à la 48e heure avec, en l'absence d'amélioration, discussion d'une corticothérapie orale et/ou d'un
avis spécialisé ou d'une hospitalisation.
Les critères suivants peuvent être retenus pour décider d'une hospitalisation :
signes cliniques de gravité,
dégradation rapide de l'état clinique,
absence d'amélioration avec le traitement mis en place en ambulatoire,
besoin d'oxygénothérapie,
présence de comorbidité,
exacerbations fréquentes ou épisode récent d'évolution défavorable,
patient isolé ou inobservant.
Hypoxie chronique
L'oxygénothérapie est indiquée en cas d'hypoxie chronique à plusieurs reprises, à distance d'exacerbations et malgré le traitement optimal, avec
PaO2 diurne au repos < 55 mmHg ou < 60 mmHg avec cœur pulmonaire chronique ou hypertension artérielle pulmonaire ou polyglobulie ou
désaturations nocturnes.
Les modalités de prise en charge de l'oxygénothérapie par l'assurance maladie sont précisées dans l'arrêté du 23 février 2015 portant
modification des modalités de prise en charge de dispositifs médicaux et prestations associées pour l'oxygénothérapie et ses forfaits associés
visés au chapitre 1er du titre 1er de la liste des produits et prestations prévue à l'article L. 165-1 du code de la Sécurité sociale.
Évaluation
On définit, en fonction du degré d'altération du VEMS (mesuré après bronchodilatateur), 4 stades de sévérité de l'obstruction bronchique au cours
de la BPCO.
Stades Caractéristiques des valeurs prédites
Stade I
Obstruction bronchique légère VEMS/CV < 70 %
VEMS ≥ 80 %
Stade II
Obstruction bronchique modérée VEMS/CV < 70 %
50 % ≤ VEMS < 80 %
Stade III
Obstruction bronchique sévère VEMS/CV < 70 %
30 % ≤ VEMS < 50 %
Stade IV
Obstruction bronchique très sévère VEMS/CV < 70 %
VEMS < 30 %
L'évaluation de la sévérité de la maladie doit aussi tenir compte des symptômes (dyspnée d'exercice évaluée par l'échelle du Medical Research
Council modifiée (mMRC), de l'état de santé global (qualité de vie), du niveau de limitation des activités (handicap), de la fréquence des
exacerbations et de leur sévérité.
La mesure des volumes pulmonaires montre souvent une distension thoracique, conséquence de l'obstruction bronchique et mécanisme principal
de la dyspnée.

Conseils aux patients
Le 1er traitement d'une BPCO, dont la cause est presque uniquement le tabagisme, est l'arrêt du tabac. En l'absence d'un sevrage complet, les
chances d'une stabilisation de la maladie (voire parfois d'une amélioration) sont nulles.
Le drainage correct des bronches est indispensable. En cas d'hypersécrétion bronchique, il passe par l'apprentissage, par un kinésithérapeute, de
techniques favorisant l'expectoration.
Le maintien d'une activité physique adaptée est primordial. Chez les patients présentant une dyspnée d'exercice avec handicap malgré le traitement
bronchodilatateur bien conduit, une réhabilitation respiratoire est recommandée.
Toute exacerbation ne justifie pas la prescription d'un antibiotique. Une exacerbation peut être confondue avec une autre complication (insuffisance
cardiaque, embolie pulmonaire, pneumonie, pneumothorax, etc.). En cas de doute, des investigations complémentaires doivent être discutées (ECG,
imagerie, biomarqueurs).
Les patients atteints de dyspnée et, a fortiori, d'insuffisance respiratoire, doivent être informés du risque de dépression respiratoire qu'entraîne la
prise de certains médicaments, antitussifs, opiacés, certains psychotropes. Grade A
Traitements
Médicaments cités dans les références
Bêta-2 agonistes
Les bronchodilatateurs bêta-2 agonistes exercent une action stimulante sur les récepteurs bêta-2 du muscle lisse bronchique, assurant ainsi
une bronchodilatation. Des effets traduisant leur passage systémique peuvent être observés : tremblements des extrémités, crampes, tachycardie,
céphalées.
bronchodilatateurs bêta-2 agonistes d'action brève inhalés
Les bronchodilatateurs bêta-2 agonistes d'action brève inhalés assurent une bronchodilatation rapide, significative et persistant pendant 4 à
6 heures.
salbutamol
AIROMIR AUTOHALER 100 µg susp p inhal
SALBUTAMOL TEVA 100 µg/dose susp p inhal en flacon pressurisé
VENTILASTIN NOVOLIZER 100 µg/dose pdre p inhal
VENTOLINE 100 µg susp p inhal
terbutaline
BRICANYL TURBUHALER 500 µg/dose pdre p inhal
bêta-2 agonistes d'action brève utilisés en nébulisation
Les bêta-2 agonistes d'action brève utilisés en nébulisation n'ont habituellement pas leur place dans le traitement des BPCO stables. Une
obstruction bronchique sévère peut toutefois être améliorée chez certains patients par de fortes doses de bronchodilatateurs en nébulisation.
salbutamol
SALBUTAMOL 2,5 mg sol p inhal par nébulis en unidose
SALBUTAMOL 5 mg sol p inhal par nébulis en unidose
SALBUTAMOL MYLAN 2,5 mg/2,5 ml sol p inhal p nébulis en récipient unidose
SALBUTAMOL MYLAN 5 mg/2,5 ml sol p inhal p nébulis en récipient unidose
VENTOLINE 2,5 mg/2,5 ml sol p inhal p nébulis en récipient unidose
VENTOLINE 5 mg/2,5 ml sol p inhal p nébulis en récipient unidose
terbutaline
BRICANYL 5 mg/2 ml sol p inhal p nébulis en récipient unidose
TERBUTALINE 5 mg/2 ml sol p inhal par nébulis en unidose
bêta-2 agonistes d'action prolongée
Les bêta-2 agonistes d'action prolongée sont administrés sous forme inhalée et sous forme orale. Ils améliorent les symptômes lorsque ceux-
ci persistent en dépit de l'utilisation pluriquotidienne d'un bronchodilatateur de courte durée d'action. Leur administration ne devrait être
poursuivie qu'en cas de bénéfice sur ces symptômes. L'olodatérol ne réduisant pas les exacerbations, toutes sévérités confondues, est
considéré par la HAS comme ayant un service médical rendu (SMR) modéré (avis de la commission de la transparence, HAS, mars 2015). Par
voie inhalée, les bêta-2 agonistes d'action prolongée s'administrent en 1 prise par jour (indacatérol, olodatérol) ou en 2 prises par jour
(formotérol et salmétérol). Par voie orale, ils s'administrent en 1 prise par jour (bambutérol) ou en 2 prises par jour (terbutaline). Compte tenu
d'une tolérance moins bonne que lorsqu'ils sont administrés par voie inhalée, les bêta-2 agonistes d'action prolongée administrés per os sont
réservés aux personnes qui ne peuvent utiliser les formes inhalées.
bambutérol
OXEOL 10 mg cp séc
OXEOL 20 mg cp séc
formotérol
ASMELOR NOVOLIZER 12 µg/dose pdre p inhal
ATIMOS 12 µg/dose sol p inhal en fl press
FORADIL 12 µg pdre p inhal en gél
FORMOAIR 12 µg/dose sol p inhal en flacon pressurisé
indacatérol
ONBREZ BREEZHALER 150 µg pdre p inhal en gélules
ONBREZ BREEZHALER 300 µg pdre p inhal en gélules

olodatérol
STRIVERDI RESPIMAT 2,5 µg/dose sol p inhal
salmétérol
SEREVENT 25 µg susp p inhal bucc en flacon pressurisé
SEREVENT DISKUS 50 µg/dose pdre p inhal
terbutaline à libération prolongée
BRICANYL LP 5 mg cp LP
Bronchodilatateurs anticholinergiques inhalés
Les bronchodilatateurs anticholinergiques inhalés entraînent une relaxation du muscle lisse bronchique par blocage des récepteurs
muscariniques.
L'effet de l'ipratropium apparaît en quelques minutes et est de courte durée d'action (4 à 6 heures). Les effets du tiotropium et du glycopyrronium
sont de plus longue durée, ce qui permet 1 prise unique quotidienne. Leur administration ne devrait être poursuivie qu'en cas de bénéfice sur les
symptômes.
Les effets indésirables sont locaux (sécheresse buccale, irritation pharyngée et, rarement, bronchospasme paradoxal) et systémiques
(céphalées, tachycardie, etc.).
glycopyrronium bromure
SEEBRI BREEZHALER 44 µg pdre p inhal en gélule
ipratropium bromure
ATROVENT 0,5 mg/1 ml sol p inhal p nébulis en récipient unidose adulte
ATROVENT 0,5 mg/2 ml sol p inhal p nébulis en récipient unidose adulte
ATROVENT 20 µg/dose sol p inhal en flacon pressurisé
IPRATROPIUM BROMURE 0,50 mg/2 ml sol p inhal par nébuliseur
tiotropium bromure
SPIRIVA 18 µg pdre p inhal en gél
SPIRIVA RESPIMAT 2,5 µg/dose sol p inhal
Associations de bronchodilatateurs bêta-2 agonistes et anticholinergiques inhalés
Les associations de bronchodilatateurs bêta-2 agonistes et anticholinergiques inhalés améliorent l'observance du traitement en réduisant
le nombre de médicaments différents à prendre.
Ils ont les mêmes avantages et inconvénients que ceux de leurs composants (voir ci-dessus). Certaines associations sont à courte durée d'action
(fénotérol + ipratropium), d'autres à longue durée d'action (glycopyrronium + indacatérol).
fénotérol + ipratropium bromure
BRONCHODUAL 50 µg/20 µg/dose sol p inhal
glycopyrronium bromure + indacatérol
ULTIBRO BREEZHALER 85 µg/43 µg pdre p inhal en gélules
Corticoïdes inhalés
Les corticoïdes inhalés, notamment béclométasone, budésonide et fluticasone, sont parfois utilisés comme traitement de fond du phénomène
inflammatoire sous-jacent dans les BPCO de stade III et chez les patients présentant des exacerbations répétées malgré une prise en charge
optimale. Ils ne disposent pas d'une AMM spécifique dans la BPCO.
Les effets indésirables possibles sont : candidose oropharyngée, dysphonie, raucité de la voix qui peuvent être prévenues par rinçage de la
bouche après inhalation. Au-dessus de 1 000 μg par jour de béclométasone chez l'adulte, le risque d'effets systémiques est minime mais ne peut
être exclu.
En l'absence d'indication d'AMM dans la pathologie concernée, les médicaments correspondants ne sont pas listés.
Associations de corticoïdes inhalés et de bêta-2 agonistes inhalés d'action prolongée
Les associations de corticoïdes inhalés et de bêta-2 agonistes inhalés d'action prolongée améliorent l'observance du traitement en
réduisant le nombre de prises quotidiennes. Leur administration ne devrait être poursuivie qu'en cas de bénéfice sur les symptômes. Les seuils de
prescription sont variables suivant les AMM : VEMS < 50 % de la valeur théorique pour budésonide + formotérol et béclométasone + formotérol ;
VEMS (pré-bronchodilatateur) < 60 % de la valeur théorique pour fluticasone + salmétérol ; VEMS (post-bronchodilatateur) < 70 % de la valeur
théorique pour fluticasone + vilantérol. Ils ont les mêmes avantages et inconvénients que ceux de leurs composants (voir ci-dessus). Il est à noter
que la fluticasone, corticoïde inhalé, est présentée sous deux formes : furoate et propionate. Les posologies unitaires recommandées en sont
différentes.
béclométasone + formotérol
FORMODUAL 100/6 µg/dose sol p inhal en fl press
INNOVAIR 100/6 µg/dose sol p inhal
INNOVAIR NEXTHALER 100 µg/6 µg/dose pdre p inhal
budésonide + formotérol
DUORESP SPIROMAX 160 µg/4,5 µg pdre p inhal
DUORESP SPIROMAX 320 µg/9 µg pdre p inhal
SYMBICORT TURBUHALER 200/6 µg/dose pdre p inhal
SYMBICORT TURBUHALER 400/12 µg/dose pdre p inhal
fluticasone + vilantérol trifénatate
RELVAR ELLIPTA 92 µg/22 µg pdre p inhal en récipient unidose
fluticasone propionate + salmétérol
SERETIDE DISKUS 500 µg/50 µg/dose pdre p inhal en récipient unidose
 6
6
 7
7
 8
8
 9
9
1
/
9
100%