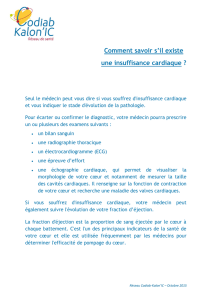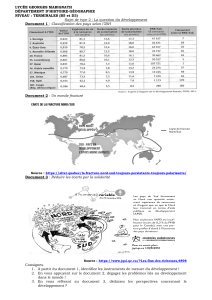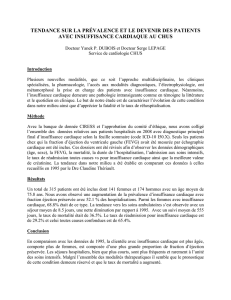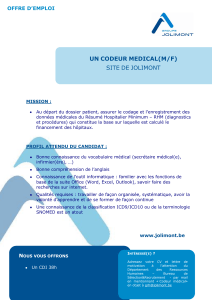Introduction
En Belgique, l’insuffisance cardiaque (IC) touche plus ou moins 240.000 Belges et environ 4
nouveaux cas sont détectés chaque jour (soit environ 15.000 par an) (V, 2021). Cette pathologie
affecte principalement les personnes de 65 ans et plus, dont 20% sont en souffrance, ce qui
représente 4 % de la population adulte (V, 2021). L’insuffisance cardiaque se définit par une
incapacité du cœur à éjecter suffisamment de sang oxygéné et des nutriments pour répondre
aux besoins des organes et tissus (Aldhahir, 2022). Les principales causes incluent les maladies
coronariennes, l’hypertension artérielle et les facteurs liés au mode de vie comme la sédentarité,
une alimentation déséquilibrée, une consommation d’alcool, de tabac et l’obésité (Tian et al.,
2023).
L’insuffisance cardiaque est la première cause d’un syndrome associé à un taux élevé de
morbidité, mortalité et de réadmissions fréquentes à l’hôpital (Tian et al., 2023). Les principaux
types d'insuffisance cardiaque sont :
- L'insuffisance cardiaque à fraction d'éjection réduite (IC-FER) qui entraîne une
diminution de la fonction de pompe du cœur, avec une fraction d'éjection ventriculaire
gauche ≤ 40 % (Tian et al., 2023).
- L'insuffisance cardiaque à fraction d'éjection préservée (IC-FEP) qui se caractérise par
une fraction d'éjection ventriculaire gauche ≥ 50 % avec une altération de la relaxation
ventriculaire et une traction diastolique accumulée (Tian et al., 2023).
- L’insuffisance cardiaque avec fraction d'éjection modérément réduite qui se situe entre
les deux autres types (Tian et al., 2023).
Les symptômes de l’IC sont souvent liés à une surcharge volémique qui se manifestent par des
œdèmes aux membres inférieurs et/ou de l’abdomen et de la dyspnée (Tian et al., 2023).
Il y a donc un impact significatif sur le plan physique, psychologique et social ce qui diminue
la qualité de vie des patients (Heo et al., 2008).
Face à ce constat, une prise en charge personnalisée dans une unité spécialisée avec une équipe
multidisciplinaire est nécessaire pour diminuer le taux d’hospitalisation, de mortalité, de
complications liées à la pathologie et ainsi améliorer la qualité de vie de ces patients (Sall et al.,
2023).Cette prise en charge s'inscrit dans le paradigme de la totalité, qui définit l'être humain
comme une entité composée d’une dimension biologique, psychologique et sociale. Ces
dimensions interagissent dans un environnement dynamique pouvant être ajustées pour
préserver la qualité de vie (Leplège & Debout, 2007).

La théorie de Roy vise à promouvoir l'adaptation des individus à travers quatre modes
d'adaptation qui contribuent à améliorer la qualité de vie. Ces modes sont :
1. Le mode « physiologique » : concerne les aspects physiques tels que l'activité, le repos,
l'alimentation et la protection.
2. Le mode « concept de soi » : aborde la dimension psychologique en se concentrant sur
la perception de soi et l'identité personnelle.
3. Le mode « fonction selon les rôles » : se focalise sur le rôle professionnel de l'individu
et son intégration dans la société.
4. Le mode « interdépendance » : traite des interactions sociales et des comportements
en relation avec les autres.
Cette théorie explore les adaptations nécessaires à la qualité de vie en analysant les stimuli qui
peuvent être internes ou externes, qui sont focaux (face immédiatement), contextuels (liés à la
situation présente) ou résiduels (influences des croyances, attitudes et expériences passées sur
la situation actuelle). Le but est de promouvoir l’adaptation de ses quatre modes afin de
contribuer à la santé et à la qualité de vie des patients (Pepin et al., 2024). La qualité de vie est
définie par l’Organisation Mondiale de la Santé (OMS) comme une perception personnelle
influencée par la culture, les valeurs et les attentes individuelles. Elle inclut la santé physique
et mentale, l'autonomie, les relations sociales ainsi que l'environnement. Ce concept varie
largement en fonction des objectifs, des préoccupations et des croyances de la personne (OMS,
1994). Selon l'OMS, plusieurs facteurs influencent l'autogestion de l'insuffisance cardiaque,
comme l'éducation thérapeutique, le statut socio-économique et la relation patient-soignant
(Sall et al., 2023). Ces indicateurs seront évalués dans le questionnaire McGill sur la qualité de
vie révisé, ce questionnaire aborde les indicateur physique, psychologique, existentielle et
sociale.
La prise en charge multidisciplinaire inclut l’éducation thérapeutique (ETP) visant à développer
des compétences nécessaires pour la gestion de la maladie, notamment en matière d'autogestion,
de changement de mode de vie, d'autosurveillance et d'adhésion au traitement. Elle fournit aux
patients des connaissances, des compétences pratiques et un soutien émotionnel essentiel pour
gérer au mieux une vie avec une maladie chronique et garder une meilleure autonomie (HAS,
2013). L’ETP doit être adapté à chaque patient en fonction de son vécu, de ses expériences
professionnelles. L’ETP permet l’amélioration de la santé du patient de manière biologique et
clinique (HAS, 2013). Elle lui permet de réaliser des autosoins afin d’améliorer sa qualité de

vie. Une étude systématique montre que l’ETP peut de réduction de 25,2% des hospitalisations
et la mortalité de de 13,33% (Son et al., 2020). Malgré des effets bénéfiques souvent rapportés
des initiatives d'éducation à l'autogestion menées par des infirmières, les preuves de leur
efficacité restent limitées. En effet, les études qui évaluent l’impact l’ETP sur la qualité de vie
des patients se font généralement sur une période de 1 à 2 ans, ce qui peut rendre difficile
l’appréciation de l’impact immédiat de ces interventions. https://www.mdpi.com/1660-
4601/17/18/6559
A l’hôpital de Jolimont, les patients diagnostiqués avec une IC et suivis clinique de
l’insuffisance cardiaque bénéficient d’un parcours de soin structuré. Ce parcours commence par
une approche centrée sur le patient, intégrant une équipe multidisciplinaire comprenant une
infirmière spécialisé IC, une pharmacienne, un cardiologue, une assistance sociale, une
diététicienne, un psychologue, un centre de revalidation. Les patients bénéficient d'un suivi
cardiologique régulier tous les 3 à 6 mois et une infirmière spécialisée est accessible par
téléphone de 8h à 16h pour gérer les urgences. Son rôle est de mener des consultations sur
plusieurs jours et semaines afin d’assurer un suivi adéquat. (Annexes 1)
À la suite de mon stage et de la revue de plusieurs articles scientifiques sur l'insuffisance
cardiaque et l'éducation thérapeutique, j'ai identifié un objectif de recherche : comparer la
qualité de vie des patients atteints d'insuffisance cardiaque qui sont suivis en clinique
spécialisée par rapport à ceux qui ne bénéficient pas de ce suivi.
Dans cette étude, je prévois de réaliser une étude rétrospective afin de comparer les données de
patients ayant bénéficié d'un suivi spécialisé à ceux n'ayant pas accès à ce type de soins. Il est
important de noter que cette étude ne vise pas à évaluer l'impact de l'intervention sur le court
terme, mais plutôt à explorer les différences en matière de qualité de vie entre les deux groupes.
Cela m’amène à formuler la question de recherche suivant :
« Quel est l’impact d'un suivi avec un trajet de soin bien défini en clinique de
l'insuffisance cardiaque par rapport à un suivi uniquement chez un cardiologue ? »
Dans le cadre de cette recherche, les hypothèses sont que les patients bénéficiant d'un suivi avec
un trajet de soin bien défini en clinique de l'insuffisance cardiaque afficheront une qualité de
vie supérieure à celle des patients ayant un suivi limité à un cardiologue. Ce suivi structuré,
caractérisé par une approche multidisciplinaire, devrait contribuer à la réduction des
hospitalisations, en raison d'un suivi plus régulier et d'interventions éducatives adaptées aux
besoins des patients. De plus, cette approche favorise une meilleure adhésion au traitement, ce

qui permettrait aux patients de gérer plus efficacement leurs symptômes au quotidien. Par
ailleurs, il est anticipé que le soutien psychosocial proposé dans un cadre clinique spécialisé
améliore le bien-être mental et émotionnel des patients. En somme, l'intégration d'une équipe
multidisciplinaire pourrait s'avérer déterminante pour optimiser la qualité des soins dispensés
aux patients atteints d'insuffisance cardiaque.

Méthode
1. Objet et Population cible
L'objectif de cette recherche est d'évaluer la qualité de vie des patients souffrant d'insuffisance
cardiaque, en comparant ceux qui bénéficient d'un suivi en clinique spécialisée à ceux qui ne
sont pas suivis en clinique. Cette évaluation repose sur plusieurs dimensions, notamment
physique, psychologique et sociale. Ces domaines sont analysés à l'aide d'un cadre théorique
fondé sur la théorie de Roy. L'étude est menée au sein d'un hôpital multisites comprenant les
établissements de Lobbes, Jolimont et Nivelles. Il s'agit d'une étude monocentrique, étant donné
que ces trois hôpitaux ont été fusionnés.
La population cible de cette étude comprend des patients présentant une insuffisance cardiaque
chronique, diagnostiquée depuis plus de six mois, avec une fraction d'éjection réduite (IC-FER)
ou préservée (IC-FEP). Ces patients sont âgés de 50 à 80 ans et sont suivis au sein de la clinique
de l'insuffisance cardiaque de Jolimont. Le groupe témoins ne bénéficient pas d'un suivi dans
cette clinique, mais sont pris en charge par les cardiologues des établissements de Lobbes ou
Nivelles. Les participants ne doivent pas se trouver dans une phase aiguë de leur maladie. De
plus, certains critères d'exclusion sont appliqués, notamment la présence de pathologies
concomitantes telles qu'un cancer avancé, une insuffisance rénale terminale, des troubles
cognitifs, de la démence ou une institutionnalisation.
2. Type d’étude, mesure et récolte des données
Il s'agissait d'une étude rétrospective observationnelle, adoptant une méthode quantitative et
une approche comparative entre deux groupes. Cette étude a été menée de manière
multicentrique sur les sites de Jolimont, Nivelles et Lobbes. La période d'investigation s'est
étendue sur deux mois, de la mi-février à la fin mars.
La collecte des données a été effectuée à l'aide d'un questionnaire approuvé par le comité
d'éthique, puis distribué aux médecins après cette approbation. Avant le questionnaire,
plusieurs sections sont présentes, notamment :
- Un texte d'introduction et une confirmation du consentement à la participation (Annexe
1).
- Des données générales et socio-démographiques, incluant le sexe, l'âge, le niveau de
littératie, ainsi que la participation à un programme de kinésithérapie ou de
réhabilitation cardiaque, afin de minimiser les biais de confusion.
 6
6
 7
7
 8
8
 9
9
 10
10
 11
11
 12
12
 13
13
1
/
13
100%