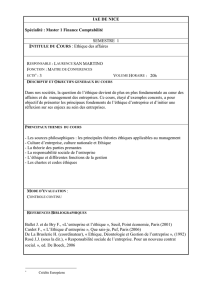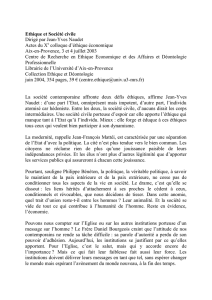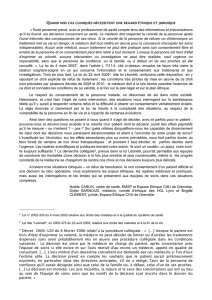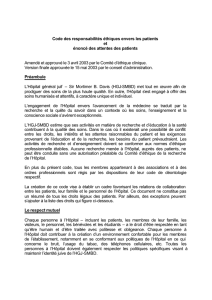1
ETHIQUE DE LA RECHERCHE
INTRODUCTION
La quête du savoir sur les humains et sur l’univers qui les entoure est une activité
fondamentalement humaine. La recherche s’inscrit naturellement dans cette volonté de
comprendre et d’améliorer le monde dans lequel nous vivons. La recherche a une vaste portée. Sur
le plan matériel, elle vise aussi bien à comprendre les origines de l’univers qu’à explorer la nature
fondamentale de la matière. Sur le plan analytique, elle englobe les mathématiques, la logique et
la métaphysique. La recherche avec des êtres humains comprend aussi bien les efforts visant à
donner un sens à l’histoire, à la compréhension du fonctionnement du corps humain et de la société
que l’explication des interactions sociales et des effets de la nature sur l’humain la liste n’a de
limite que celle de notre imagination. La liberté académique comprend la liberté de recherche, le
droit de diffuser les résultats de la recherche, la liberté de remettre en question les idées reçues, la
liberté d’exprimer ses opinions sur l’établissement auquel le chercheur est associé, son
administration ou son milieu et ses conditions de travail, et la protection contre la censure
institutionnelle. La liberté académique s’accompagne de responsabilités incluant celle de veiller à
ce que la recherche avec des êtres humains satisfasse à des critères scientifiques et éthiques
rigoureux qui respectent et protègent les participants. Ainsi l’engagement des chercheurs en vue
d’élargir les connaissances comporte aussi le devoir de faire de la recherche de façon honnête et
réfléchie, de produire des analyses rigoureuses, de veiller à la diffusion des résultats de la recherche
et de respecter les normes professionnelles.
Toute recherche doit respecter des principes éthiques. Un soin tout particulier doit être apporté
lorsque le travail de recherche fait participer des personnes et peut les affecter. Étant donné
l’importance primordiale de la recherche et de la participation d’êtres humains à la recherche,
comme société il nous faut prendre tous les moyens possibles pour que la recherche soit menée
de façon éthique afin de préserver la confiance du public.

2
ETHIQUE DE LA RECHERCHE
I. CLARIFICATION DES CONCEPTS
1) La recherche
Ripoche & Lambrich, 2007 définissent la recherche comme étant un Ensemble d’actions qui a
pour but d’améliorer et d’augmenter l’état des connaissances dans un domaine scientifique.
Ensuite, Shirley, 1975 dit que la recherche est un chemin qu’on ouvre dans le partiellement
connu, le mal connu ou l’inconnu, pour en savoir plus, à plus ou moins long terme, pour se
donner de meilleurs moyens d’action. Nous pouvons dire que la recherche un ensemble d’action
organisée systématique, critique qui prend naissance par un questionnement scientifique
concernant un problème sous investigation dans un objectif de trouver des réponses et de trouver
des solutions ou bien de développer des nouvelles théories et connaissances à partir de l’analyse
d’un objet de recherche [1]
2) L’éthique
L'éthique est une branche de la philosophie qui s'intéresse aux principes moraux qui guident les
comportements humains et les décisions. Elle cherche à déterminer ce qui est bien ou mal, juste
ou injuste, en se basant sur des valeurs, des normes et des raisonnements. L'éthique explore les
questions relatives à la responsabilité individuelle et collective, au respect des autres, à la justice,
à la liberté, à l'intégrité et à la dignité humaine. [2]
3) L’éthique de la recherche
L’éthique de la recherche est premièrement un champ de réflexion qui s’interroge sur les
relations entre les chercheurs et les participants à la recherche et sur la conciliation des impératifs
méthodologiques et scientifiques avec la dignité humaine et elle est ensuite un champ d’action
qui s’impose comme système de régulation et d’encadrement de l’activité de recherche en
définissant des standards déontologiques en soumettant à l’évaluation d’un comité d’éthique de
la recherche toute recherche conduite auprès d’êtres humains. Son importance réside dans la
préservation des droits des personnes impliquées dans les recherches et dans l'assurance que les
recherches sont menées de manière honnête, transparente et responsable. [3]
II. ORIGINE DE L’ETHIQUE DE LA RECHERCHE [4] ;[5]
L’éthique de la recherche a beaucoup progressé à coup de scandales. Des différentes interactions
entre les gouvernements et les organismes en place qui ont commencé à placer des cadres
normatifs, des lignes directives et des textes le plus souvent en réponse à des scandales. Donc s’il
y’a eu besoin d’encadrer la recherche scientifique, c’est qu’il y’a eu des abus et ce dès
l’introduction de la méthode expérimentale et le recours des sujets humains comme objet de
recherche. Or lorsque que nous regardons les sujets de recherche de l’époque c’est comme s’il
y’avait une transposition a la recherche des rapports de classes et de la hiérarchie sociale de
l’époque. Et aussi quand on regarde ces recherches il y’a aucune mention de ce que devenait ces
participants ou de leur bien être à savoir s’ils ont été respecté ou si la recherche leur a été
bénéfique. Nous allons présenter quelques scandales qui ont fait suivre les principes éthiques en
recherche.

3
ETHIQUE DE LA RECHERCHE
1. Les scandales de la recherche médicale
- Albert Neisser (1855-1916), découvreur de l’agent causal de la gonorrhée : en 1898, il a
publié une recherche conduite auprès des patientes qui consistai à leur injecter du sérum
de patients syphilitiques et son but était de faire un test de vaccination contre la syphilis.
Le problème avec sa recherche était que ses participants étaient des patientes prostituées
et n’étaient pas informe de la recherche. Finalement la vaccination n’a pas fonctionné et
certaines ont contracté la syphilis. Il y’a une publication de ce scandale dans les journaux
et de nombreux débat public. Le chercheur a été traine en justice et la cours a fondé sa
décision sur l’absence de consentement et Neisser a été contraint de payer une amende.
C’est à partir de cet instant qu’il y a eu reconnaissance légale du consentement. En 1900,
le ministère des affaires religieuse, éducationnelles et médicales émet une directive aux
hôpitaux et clinique : <<Aucune activité autre que celles visant le diagnostic, la
guérison ou l’immunisation ne peut être conduite auprès d’une personne sans son
consentement clair et après lui en avoir expliqué les possibles conséquences
négatives>>
- Nuremberg U.S.A V.Brandt et al (1946-1947): il s’agit d’une série de 12 procès qui a
été mis sur pied par le tribunal militaire américain à la suite de la seconde guerre
mondiale et qui jugeait 23 médecins et fonctionnaires nazis pour des exactions commis
dans des camps de concentration et plus précisément pour des recherches scientifiques
menés par ces médecins. Les succès de la médecine scientifique expérimentale à la fin du
XIXe siècle avaient favorisé dans le monde occidental un contexte d’optimisme scientiste
et de foi en la médecine. En 1945, la découverte des expériences médicales réalisées par
les médecins nazis sur les prisonniers des camps de concentration bouleverse cet
optimisme. Ces procès ont abouti au code Nuremberg qui identifie le consentement
éclairé comme préalable absolu à la conduite de recherche mettant en jeu des sujets
humains avec ces 10 points [4] :
1. Le consentement volontaire du sujet humain est absolument essentiel. Cela veut dire que la
personne intéressée doit jouir de capacité légale totale pour consentir : qu'elle doit être laissée
libre de décider, sans intervention de quelque élément de force de fraude, de contrainte, de
supercherie, de duperie ou d'autres formes de contraintes ou de coercition. Il faut aussi qu'elle
soit suffisamment renseignée, et connaisse toute la portée de l'expérience pratiquée sur elle, afin
d'être capable de mesurer l'effet de sa décision. Avant que le sujet expérimental accepte, il faut
donc le renseigner exactement sur la nature, la durée, et le but de l'expérience, ainsi que sur les
méthodes et moyens employés, les dangers et les risques encourus ; et les conséquences pour sa
santé ou sa personne, qui peuvent résulter de sa participation à cette expérience.
L'obligation et la responsabilité d'apprécier les conditions dans lesquelles le sujet donne son
consentement incombent à la personne qui prend l'initiative et la direction de ces expériences ou
qui y travaille. Cette obligation et cette responsabilité s'attachent à cette personne, qui ne peut les
transmettre à nulle autre sans être poursuivie.

4
ETHIQUE DE LA RECHERCHE
2.L'expérience doit avoir des résultats pratiques pour le bien de la société impossibles à obtenir
par d'autres moyens : elle ne doit pas être pratiquée au hasard et sans nécessité.
3. Les fondements de l'expérience doivent résider dans les résultats d'expériences antérieures
faites sur des animaux, et dans la connaissance de la genèse de la maladie ou des questions
de l'étude, de façon à justifier par les résultats attendus l'exécution de l'expérience.
4. L'expérience doit être pratiquée de façon à éviter toute souffrance et out dommage physique et
mental, non nécessaires.
5. L'expérience ne doit pas être tentée lorsqu'il y a une raison a priori de croire qu'elle entraînera
la mort ou l'invalidité du sujet, à l'exception des cas où les médecins qui font les recherches
servent eux-mêmes de sujets à l'expérience.
6. Les risques encourus ne devront jamais excéder l'importance humanitaire du problème que
doit résoudre l'expérience envisagée.
7. On doit faire en sorte d'écarter du sujet expérimental toute éventualité, si mince soit-elle,
susceptible de provoquer des blessures, l'invalidité ou la mort.
8. Les expériences ne doivent être pratiquées que par des personnes qualifiées. La plus grande
aptitude et une extrême attention sont exigées tout au long de l'expérience, de tous ceux qui la
dirigent ou y participent.
9. Le sujet humain doit être libre, pendant l'expérience, de faire interrompre l'expérience, s'il
estime avoir atteint le seuil de résistance, mentale ou physique, au-delà duquel il ne peut aller.
10. Le scientifique chargé de l'expérience doit être prêt à l'interrompre à tout moment, s'il a une
raison de croire que sa continuation pourrait entraîner des blessures, l'invalidité ou la mort pour
le sujet expérimental.
(Extrait du jugement du TMA, Nuremberg, 1947 (trad. française in F. Bayle, Croix gammée
contre
caducée. Les expériences humaines en Allemagne pendant la Deuxième Guerre Mondiale,
Neustadt, Commission scientifique des crimes de guerre, 1950.)
- En 1966, un professeur d’anesthésiologie de Harvard, Henry K. Beecher[4], dénonce
les pratiques de vingt-deux recherches publiées dans des grandes revues scientifiques
(Beecher 1966). Il décrit ces expériences comme des recherches ou il y’avait aucun
consentement, pas de bénéfices pour les participants et avec des conséquences négatives
sur eux
- Tuskegee et Willowbrook[4]: En 1932, le Service de santé publique des États-Unis5 lance
une recherche ambitieuse sur la syphilis dans le Sud, à Macon County en Alabama. La syphilis est
une maladie sexuellement transmissible à l’origine de paralysies, de démence et de crises
cardiaques. Dans l’Alabama rural de la Grande Dépression, la plupart des Noirs sont des

5
ETHIQUE DE LA RECHERCHE
métayers pauvres et analphabètes, qui ne connaissent de la syphilis que sa désignation
vernaculaire, badblood, le mauvais sang. Au début des années 1930, les usages médicaux de la
pénicilline n’ont pas été découverts ; les traitements disponibles pour la syphilis sont coûteux,
douloureux et aléatoires. Plus de six cents métayers noirs sont réunis par les médecins du
Tuskegee Institute pour étudier le développement et la progression de la syphilis. Environ deux
cents Noirs qui ne sont pas atteints de syphilis servent de groupe témoin ; les quatre cents
autres, malades, sont l’objet véritable de l’étude : puisque les traitements disponibles sont
si mauvais, quels sont les effets de la syphilis chez des malades non traités? La durée
initialement prévue de l’étude est de six à douze mois. En fait, elle va se poursuivre
pendant quarante ans, jusqu’au début des années 1970. Le premier élément problématique
de l’étude de Tuskegee est que les Noirs pauvres syphilitiques n’ont jamais été informés
qu’ils étaient atteints de cette maladie. Ils ont toujours cru qu’ils avaient le bad blood ; les
« traitements » qu’ils recevaient étaient des placebos. Non seulement les sujets n’étaient
pas traités, mais ils étaient tellement ignorants du protocole de recherche qu’ils croyaient
bénéficier d’un traitement de faveur, puisqu’ils recevaient des repas chauds et des «
examens médicaux » gratuits, ainsi qu’une concession gratuite pour leur enterrement (en
échange du droit de pratiquer une autopsie sur les cadavres). Le deuxième élément
problématique est qu’en 1942 des chercheurs d’Oxford découvrent les usages
thérapeutiques de la pénicilline, laquelle est immédiatement utilisée, notamment pour les
blessés de la Seconde Guerre mondiale.
En 1947, la pénicilline devient le traitement standard pour la syphilis. Mais les médecins
de Tuskegee n’informent pas leurs patients de cette découverte et conservent le même
protocole de recherche jusqu’à la révélation du scandale dans la presse en 1972. En
somme, les médecins (blancs) de Tuskegee voulaient savoir ce qu’il advenait des malades
(noirs) de la syphilis quand celle-ci n’était pas traitée, compte tenu de l’absence de
traitements satisfaisants; ils ont trompé leurs patients sur les finalités des examens, qui
impliquaient notamment une ponction lombaire extrêmement douloureuse, ne les ont
même pas informés de leur maladie réelle ainsi que des conditions de sa transmission,
puis ont délibérément tenu ces patients à l’écart du traitement par antibiotiques quand
celui-ci est devenu disponible. Pendant vingt-cinq ans, ils ont laissé leurs patients mourir
d’une maladie dont ils connaissaient le remède. Sur les quatre cents participants, vingt-
huit décèdent directement de la syphilis, cent de complications liées à la maladie,
quarante épouses ont été infectées, et dix-neuf enfants sont nés avec la syphilis
congénitale.
Le directeur du Service de santé publique à Tuskegee entre 1943 et 1948 déclare en
1976: «le statut de ces hommes ne requérait pas un débat éthique. C’étaient des sujets,
pas des patients ; du matériel clinique, pas des malades » (Jones 1981 : 179). Dans la
culture américaine, Tuskegee est devenu synonyme de « science raciste et meurtrière ».
Le scandale est d’autant plus vif qu’il existe une longue histoire de l’utilisation des
esclaves noirs pour des expériences médicales aux XVIIIe et XIXe siècles (Savitt 1982).
Le fond de l’étude de Tuskegee était de mieux connaître l’évolution d’une maladie en
l’absence de traitement. Les médecins de l’hôpital public de Staten Island à New York se
sont posé la même question par rapport à l’hépatite. Entre 1963 et 1966, ils ont
 6
6
 7
7
 8
8
 9
9
 10
10
 11
11
 12
12
 13
13
 14
14
 15
15
 16
16
 17
17
1
/
17
100%