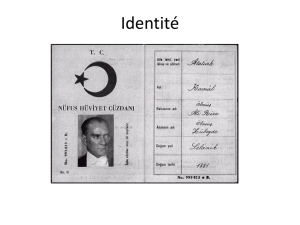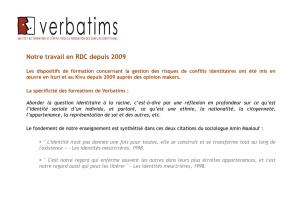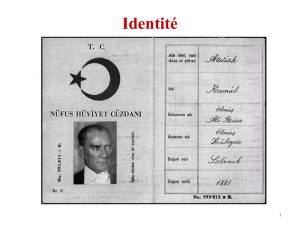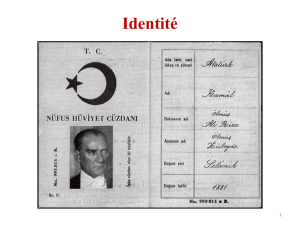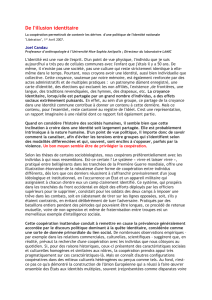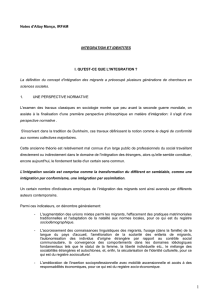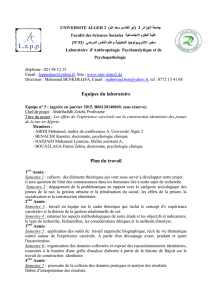Question identitaire et politique au Burkina Faso - Cours Master 2
Telechargé par
pierreabakole1

1
La question identitaire dans l’évolution politique du BF
Master2- Semestre3 - An.ac. 2021-2022
Option : pouvoirs politiques et représentations sociales
Dr Koudbi Kaboré
Introduction générale
La question identitaire est plus que jamais d'actualité dans les sociétés contemporaines.
L’identité est un concept à forte charge idéologique, et soumis régulièrement à
l’instrumentalisation des pouvoirs et des forces politiques. L’histoire contemporaine du
Burkina Faso montre que l’identité n’a pas échappé à l’instrumentalisation politique. Avant de
développer cet aspect, il convient de savoir ce que c’est que l’identité et la manière dont les
identités se construisent.
I. Identité, identités : généralités
Exploitation de document :
Texte1. Bertrand Badie & l’identité (entretien) Le Monde, 23 décembre 2009
I.1. L’identité
Les groupes humains, pour garder leur particularisme, définissent des périmètres (frontières)
pour se distinguer et se protéger des autres. Ils se donnent pour ainsi dire une identité
(collective). L'identité est ce qui nous définit, nous distingue de l'autre. L’identité est un
concept ambigu, et même conflictogène. Fernand Braudel reconnaissait ne pas être à l’aise
avec le terme lorsqu’il affirmait : « Le mot m’a séduit, mais n’a cessé, des années durant, de
me tourmenter. […] Manifeste est son ambiguïté : il est une série d’interrogations ; vous
répondez à l’une, l’autre se présente aussitôt, et il n’y a pas de fin »
1
. Cette remarque, sans
doute applicable à la recherche, nous situe sur le fait que travailler sur l’identité rend sensible
la position du chercheur ainsi que le reconnait également Pierre Tap : « définir et analyser
l'identité, c'est prendre position par rapport à celle-ci, c'est s'engager dans des débats
idéologiques concernant l'histoire et le devenir des hommes, des groupes et des institutions »
2
.
Le travail savant sur l’identité enveloppe donc ipso facto une dimension critique, puisque les
recherches sur les processus historiques de formation des identités déconstruisent aussi bien
l’essentialisme que les constructions mémorielles politiquement motivées. Les chercheurs sur
l’identité et les identités doivent faire l’effort de sortir de leurs propres catégories.
1
Braudel F., L’identité de la France, op. cit., t. 1 : Espace et histoire, Paris, Flammarion, 1990, p. 18.
2
Tap P., Identité collective et changements sociaux, Toulouse, Privat, 1980, p. 11.

2
I.2. Des identités
L’identité est plurielle ; il y a des identités nationales, culturelles, ethniques, religieuses,
sociales, politiques, etc. ici, nous allons insister sur les trois aspects qui aident à mieux
comprendre la question identitaire en contexte burkinabè.
L’identité nationale définit ce qu'est une communauté nationale et ce qui lui est extérieur
3
.
L'identité nationale contribue à neutraliser les appartenances et particularismes pour produire
le peuple comme communauté. La nation réalise une concrétion du politique et du culturel.
Elle est, selon la formule de Gellner, le mariage, heureux ou malheureux, d’un État et d’une
culture. Parmi les facteurs qui nourrissent les identités nationales figurent les langues,
l’histoire (commune) les institutions, et plus particulièrement les religions. Envisagées du
point de vue de l’histoire des représentations, les identités nationales perdent leur objectivité
et deviennent sujettes à controverses. Sous l’aspect politique, une nation est un mode et un
projet d’organisation du vivre ensemble sur un territoire. De ce point de vue, une nation peut
se penser sur le modèle d’une association : elle n’est pas seulement un imaginaire national
reçu et transmis, elle est aussi une société d’individus associés dans un système de
coopération et de distribution de biens sociaux (droits et devoirs fondamentaux, avantages
tirés de la coopération sociale)
4
. L’identité nationale est donc une (re-)construction
(permanente), car elle renvoie à des principes fondamentaux qui ne cessent d'évoluer et de se
transformer à la faveur du contexte et de ses changements.
L'identité culturelle serait l'expression même de la singularité des "groupes", peuples ou
sociétés ; elle serait ce qui interdit de les confondre dans une uniformité de pensée et de
pratique, ou d'effacer purement et simplement les "frontières" qui les séparent et qui
traduisent la corrélation au moins tendancielle entre faits de langue, faits de religion, faits de
parenté, faits esthétiques au sens large (car il y a des styles de vie comme il y a des styles
musicaux ou littéraires), et faits politiques
5
.
L’identité ethnique est la conscience d’appartenir à un groupe qui se singularise par des
pratiques culturelles spécifiques et qui, considérant que cette différence est niée, voit dans les
luttes à tous les niveaux une possibilité de déboucher, à terme, sur une société autre où ces
différences seraient reconnues
6
. Comme toutes les identités, elle est une production sociale,
c’est-à-dire qu’elle ne repose pas sur des données objectives. Selon Fredrik Barth, les groupes
construisent leur identité ethnique en opposition à d’autres groupes ethniques, en manipulant
des signes et des symboles d’appartenance arbitraires et socialement signifiants pour tracer la
frontière entre les membres désignés du groupe et les autres
7
(texte à étudier).
3
Bertrand Badie : « le discours identitaire est expression d'incertitude », in Le Monde, 23 décembre 2009.
4
Pierre Lauret, op.cit., p.22.
5
Balibar Etienne. Identité culturelle, identité nationale. In: Quaderni, n°22, Hiver 1994. Exclusion-Intégration :
la communication interculturelle. p. 54.
6
Fabre Daniel, Les minorités nationales en pays industrialisés, in L’Anthropologie en France. Situation actuelle
et à venir, (sous dir. G Condominas et Dreyfus-Gamelon), Paris, Ed. du CNRS, 1979, p.293.
7
Barth Fredrik, “Les groupes ethniques et leurs frontières”, in : POUTIGNAT, Philippe ; STREIFF-FÉNART,
Jocelyne (sous la direction de), Théories de l’ethnicité, Paris : Presses Universitaires de France, 1995, pp. 203-
249.

3
II. La question identitaire
A quoi fait-on référence quand on parle de la question identitaire ? A la sauvegarde de
valeurs, d’identités particulières ou de l’unité nationale ? A l’instrumentalisation de
l’identité ? Qu’on prenne l’une ou l’autre de ces questions, on se rend vite compte que
l’émergence d’une question identitaire rappelle qu’une société (nationale) est dans
l’incertitude ; qu’il y a une crise de cohésion sociale ou que l’unité nationale est menacée par
des affirmations et des revendications identitaires. La question identitaire met en évidence
l’instrumentalisation dont les identités font l’objet
8
.
Les référents identitaires sont souvent captés et instrumentalisés par des individus, appelés des
"entrepreneurs identitaires" pour des intérêts politiques, économiques et religieux.
Les entrepreneurs identitaires ont recourt à l’identité tout simplement parce qu’elle mobilise.
Et la mobilisation identitaire est particulièrement forte lorsque la société se trouve dans une
situation de trouble. Dans les situations de crise, lorsque les individus perdent leurs repères, se
sentent menacés, sont confrontés à l'incertitude, l’identité (ethnique, religieuse ou
régionaliste) devient non seulement mobilisatrice, mais aussi des possibilités pour gérer la
crise. L’identité sert de refuge.
Une crise et un défaut de fonctionnement des institutions, destinés à assurer la coexistence
entre les individus, peuvent banalement faire exploser une "demande" identitaire et, par voie
de conséquence, une offre identitaire dans le même temps. C’est pour cela que Bertrand Badié
affirme que le passage d'une société au registre identitaire est l’expression d’un malaise et
d'incertitude.
Parler de question identitaire, c’est parler d’une période où les populations qui se sentent de
plus en plus lésées recours à l’identité pour fonder des revendications ou construire des
légitimités contribuant ainsi à la dégradation de la cohésion sociale ou de l’unité nationale.
III. La question identitaire dans l’évolution politique du Burkina Faso
Le Burkina Faso contemporain a, jusqu’à une période récente, été caractérisé par une stabilité
politique et sociale, malgré la fréquence des soubresauts politiques, par exemple les
changements anticonstitutionnels de gouvernement et les révoltes et tensions sociopolitiques
qui ont rythmé le régime semi-autoritaire de Blaise Compaoré (1987-2014) ; malgré aussi les
tensions socio-économiques de longue date, par exemple entre éleveurs et agriculteurs.
L’insurrection populaire des 30 et 31 octobre 2014 a pourtant mis en évidence une fracture
sociale qui s’est accentuée avec l’augmentation des attaques terroristes et des conflits
ethnoculturels à partir de 2018.
Le terrorisme et les conflits ethnoculturels constituent la nouvelle donne de la situation sociale
et politique du Burkina Faso post-insurrection
9
. Si leur impact sur la cohésion sociale et
8
Bertrand Badie : « le discours identitaire est expression d'incertitude », in Le Monde, 23 décembre 2009.
9
Kaboré Koudbi, 2020, « Histoire et cohésion sociale au Burkina Faso. Regards croisés des discours et des
pratiques de la période précoloniale à nos jours », in Bantenga Willy Moussa et al. (dirs.), Mélanges, p. 261-
283.

4
l’unité nationale est fort, les revendications identitaires ne sont pourtant pas nouvelles au
Burkina Faso. De façon variable, l’ethnie, la religion et la région n’ont pas échappé à
l’instrumentalisation des régimes et des forces politiques au Burkina Faso.
III.1. Le jeu identitaire sous l’administration française, 1896-1958
III.1.1. Le poids de l’identité et de l’histoire dans la formation territoriale de la colonie de
Haute-Volta
On considère que la conquête des anciens pays du Burkina s’achève en 1916 après la défaite
des Touaregs et des populations du Bani-Volta qui se sont soulevées contre l’autorité
coloniale en 1914. L’ensemble des populations soumises furent rassemblées dans ce qui est
devenu en 1919 la Colonie de la Haute-Volta. L’organisation administrative de la colonie
s’appuya sur les anciennes constructions identitaires, suivant un processus de simplification et
de manipulation qui a souvent brisé des logiques de solidarités préétablies
10
.
Le pouvoir français réorganisa les 4 pôles hégémoniques (l’ouest, le centre, l’est et le nord) en
cercles administratifs. Les premiers cercles furent érigés sur la base de critères culturels
(religieux), ethniques, mais aussi de données politiques. L’Ouest comprenait les cercles du
lobi (Lobi, Dagara, Birifor) ; de Bobo-Dioulasso (les populations Bobo-dioula de l’ancien
royaume du Gwiriko) ; de Dédougou (populations de culture manding). Les cercles de
Ouagadougou et de Ouahigouya regroupaient les mossi de l’air d’influence du Moogo ; le
cercle de Fada N’Gourma rassemblait les populations qui étaient sous l’influence politique du
Gulmu et enfin le cercle de Dori regroupait la majeure partie des populations de l’espace
sahélien. Dans ce découpage, des minorités ethnolinguistiques et culturelles comme les
gourounsi, les Bissa, les Gouin, les Turka, les Kurumba, les Sonraï, pour ne citer que ces
groupes, sont noyées dans la masse des formations sociales dominantes (Mossi, Dioula,
Bwaba, Gourmantche et Peuls).
La nouvelle colonie regroupait plusieurs groupes ethniques (plus de 60) dont chacun tenait à
sa spécificité. Dans sa logique de domination, l’administration française mena une politique
de division du pays dans une sorte d’opposition entre deux grands ensembles politiques : l’Est
et l’Ouest
11
. L’Est est la partie du territoire anciennement dominée par les ensembles étatiques
et militaires, avec Ouagadougou comme pôle d’influence. L’Ouest, avec pour centre Bobo-
Dioulasso, regroupe les communautés villageoises et lignagères de toute la zone humide.
Au cours de l’évolution de la colonie, les élites traditionnelles, religieuses et politiques ont
utilisé le fait ethnique, religieux et régionaliste pour promouvoir leurs intérêts et leurs
ambitions.
III.1.2. Ethnicisme et régionalisme dans le tournant de 1932-1947
Exploitation du texte2 : Naaba Saaga II et la naissance de la vie politique partisane
10
Hien Pierre Claver, 2009, « L’enjeu ethnique dans le jeu politique au Burkina Faso : Du temps des royaumes
et chefferies à celui de l’Etat nation en construction », in CAHIERS DU CERLESHS, tome XXIV, n°34, p.200.
11
Palm Jean-Marc Domba, 2019, 1919-2019. Centenaire de la création du territoire de Haute-Volta : quel legs à
la jeunesse ? Ouagadougou, PUO, p.35.

5
Pour des considérations économiques, la France a disloqué la Haute-Volta et a réparti sa
population entre le Soudan français, la Côte d’Ivoire, et le Niger. Les réactions à la
dislocation de la colonie ont été variables. Opposants et partisans du démembrement
mobilisèrent le fait identitaire pour faire valoir leurs positions.
➢ Du côté des mécontents, on a les chefs traditionnels mossi, avec en leur tête les
souverains de Ouagdougou, naaba Koom et successeur naaba Saaga II. Ayant
considéré que la dislocation de la colonie entrainait celle de la « grande famille
mossie », ces deux souverains se lancèrent dans une vaste campagne de mobilisation
pour le rétablissement de la Haute-Volta dans ses limites antérieures. Naaba Saaga II
en particulier conjugua à la fois action syndicale (l’Union pour la Défense des intérêts
de la HV, UDIVH, 1945), politique (Union voltaïque, 1946) et offensive diplomatique
pour faire aboutir sa cause ;
➢ Réticences au rétablissement de la colonie par des élites (politiques, traditionnelles et
religieuses) de l’Ouest, l’Est et du Nord. L’opposition de l’élite politique de l’Ouest
s’inscrit dans la rivalité politique entre Ouagadougou et Bobo-Dioulasso. Dans le
cercle de Dori, les administrateurs coloniaux, les chefs de canton, et les leaders
politiques se mobilisèrent aussi pour le maintien de ce cercle dans la colonie du Niger
répondant ainsi à la volonté du gouverneur du Niger, Jean Toby et Boubou Hama le
leader du RDA nigérien. Ces derniers ont défendu le maintien du cercle de Dori dans
la colonie du Niger au nom des affinités ethniques, culturelles, religieuses, et
économiques de ses populations avec celles du Niger :
Au point de vue historique, la population peule des cantons du Liptako et du
Yaaga relevaient avant la pénétration coloniale « du royaume de Sokoto par
l’intermédiaire de Say ». Elle était orientée vers l’Est et n’avait eu « aucun
lien avec les populations du sud ». Au plan géographique, la quasi-totalité du
territoire du cercle de Dori appartient à la zone sahélienne entraînant un
genre de vie et des activités économiques différents de ceux du « groupe
voltaïque ». S’agissait de l’aspect ethnique, la population du cercle est
composée de Peuls, Songhaï, et de Touareg, entretenant des relations étroites
avec les populations analogues du Niger et du Soudan oriental ; elle n’a aucun
lien culturel ou coutumier avec les populations moose. Sur le plan religieux,
les habitants de Dori sont en quasi-totalité musulmane comme les autres
populations du Niger
12
.
Dans son combat pour réduire l’influence du communisme en AOF, alors représenté par le
RDA, la France a finalement reconstitué en 1947 la Haute-Volta. Mais comme le souligne
Pierre Claver Hien, l’opposition entre l’Est « mossi » et l’Ouest « non mossi » allait miner le
débat politique dans la Haute-Volta reconstituée
13
.
III.1.3. Les velléités séparatistes de l’Ouest en 1954
Dans l’évolution des colonies françaises d’Afrique noire, l’année 1945-1946 marque un
tournant décisif. En effet, à la faveur de la conférence de Brazzaville, les populations des
colonies sont appelées à élire des représentants dans les institutions de la métropole. S’ouvrit
12
Cf. Diallo, Hamidou, 2009, Histoire du Sahel au Burkina Faso : Agriculteurs, Pasteurs et Islam (1740-1960),
Thèse d’Etat en Histoire, pp.442 & ss.
13
Hien Pierre Claver, 2009, op.cit., p.202.
 6
6
 7
7
 8
8
 9
9
 10
10
 11
11
1
/
11
100%