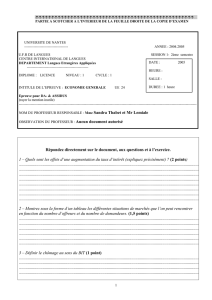Keynes et la Nouvelle Économie Keynésienne : Analyse Économique
Telechargé par
Jean-Baptiste .I

1
MARS 2017
4 €
316
ISSN 0296-4449
Les postérités de Keynes
1. La nouvelle économie keynésienne
OLIVIER ALLAIN
mensuel d’informations économiques et sociales
Téléchargez librement les graphiques, schémas et tableaux
des numéros à partir de la page Écoash sur reseau-canope.fr
politiques stabilisatrices (budgétaires
et monétaires) permettent de relancer
l’activité et de lutter contre le chômage.
Mais l’efcacité de ces politiques est
d’abord remise en cause par le courant
monétariste à la n des années 1960.
Surtout, dans les années 1970, Robert
Lucas et la nouvelle économie classique
(NEC) imposent un changement radical
de paradigme avec l’hypothèse des anti-
cipations rationnelles. Ce changement
se traduit par le rejet de l’économie
keynésienne. La nouvelle économie key-
nésienne (NEK) se développe alors, sous
l’impulsion d’économistes qui cherchent
à retrouver certains résultats keynésiens,
tout en respectant le cadre théorique
xé par Lucas.
L’INFLUENCE DE KEYNES,
MAIS AUSSI CELLE DE LUCAS
Le principal objectif de John Maynard
Keynes dans sa Théorie générale de l’em-
ploi, de l’intérêt et de la monnaie est de
montrer que le chômage involontaire
est dû à une insufsance de la demande
agrégée et non aux rigidités supposées
du marché du travail. Ce message s’ac-
compagne du rejet de la théorie quan-
titative de la monnaie et d’une analyse
du taux d’intérêt comme prix de la liqui-
dité plutôt que des fonds prêtables. Dès
La nouvelle économie keynésienne réhabilite certaines
conclusions keynésiennes à partir de la même approche
que la nouvelle économie classique (macroéconomie
à fondements microéconomiques), mais en prenant
en compte des imperfections de marché. Le chômage
involontaire découle ici de la rigidité du salaire réel (salaire
d’efcience, échanges de dons…). La viscosité des prix (coûts
de catalogue…) et les défauts de coordination (équilibres
multiples) conduisent à rejeter la neutralité de la monnaie
et redonnent une efcacité à la politique monétaire de
régulation conjoncturelle (règle de Taylor). En revanche,
le recours à la politique budgétaire ne semble justié que
dans des situations particulières (trappe à liquidité…).
L’économie keynésienne, avec la
publication de la Théorie géné-
rale, peut être vue comme une réponse
à la Grande Dépression. Son inuence
s’est ensuite développée jusque dans les
années1960 dans le cadre du «modèle
IS-LM» et de la synthèse néoclassique.
Selon cette approche, la situation éco-
nomique dépend de la demande agré-
gée. Lorsque celle-ci est déprimée, les

2
lors, une politique monétaire expansive
peut entraîner la baisse du taux d’inté-
rêt, la hausse de l’investissement, celle
de la demande agrégée et de l’emploi, et
donc une diminution du chômage. Et si
Keynes évoque peu les politiques budgé-
taires (pour des raisons essentiellement
factuelles, les budgets des États étant
très modestes en temps de paix à cette
époque), ses successeurs ne tarderont
pas à les prendre pleinement en compte.
Mais la Théorie générale est une
œuvre difcile dont la cohérence n’est
pas toujours manifeste. Elle a donc sus-
cité des interprétations contradictoires.
Celle qui l’a emporté repose sur la repré-
sentation simpliée qu’en donne John
Hicks dans le «modèle IS-LM». Or cette
simplication s’accompagne de l’idée que
les résultats de Keynes ne sont valides
qu’à court terme, et sous l’hypothèse de
rigidité des prix. À long terme, les prix et
les salaires étant exibles, la présence de
chômage involontaire entraîne une pres-
sion déationniste qui accroît le pouvoir
d’achat des encaisses monétaires (M/p
augmente où M désigne le montant des
encaisses détenues par les agents et p
le niveau des prix). Cet effet d’encaisses
réelles (ou «effet Pigou-Patinkin») nour-
rit la dépense de consommation, d’où une
hausse de la demande agrégée, méca-
nisme qui se poursuit jusqu’à retrouver
le plein-emploi. On aboutit à la synthèse
néoclassique : à long terme, l’activité
dépend de l’offre agrégée ; le message
keynésien ne subsiste plus qu’à court
terme, du fait des rigidités nominales.
Cette approche a été fortement cri-
tiquée par plusieurs élèves de Keynes
(Kaldor, Robinson, Harrod, etc.), pour les-
quels les résultats de la Théorie générale
ne se limitent pas au court terme et ne
reposent aucunement sur la rigidité des
prix mais sur les propriétés de la demande
agrégée dont certaines composantes
sont endogènes tandis que d’autres sont
autonomes. C’est la voie qui sera explo-
rée par l’économie postkeynésienne, un
courant qui sera rapidement marginalisé
(Écoash n°317, à paraître).
Mais revenons au courant dominant.
À partir de la n des années 1960, la
pertinence des politiques conjoncturelles
prônées par la synthèse néoclassique est
fortement critiquée. D’un côté, les effets
d’éviction, la théorie du revenu perma-
nent et le théorème d’équivalence ricar-
dienne constituent une remise en cause
des politiques budgétaires à laquelle
la plupart des économistes niront par
adhérer. De l’autre, Milton Friedman
restaure l’hypothèse de neutralité de
la monnaie à long terme : les relances
monétaires provoquent uniquement une
hausse de l’ination. Elles ne peuvent
favoriser l’activité qu’à court terme,
parce que les ménages souffrent d’illu-
sion monétaire car leurs anticipations
sont adaptatives (elles dépendent de
l’ination passée). C’est l’interprétation
monétariste de la courbe de Phillips.
Une remise en cause encore plus
profonde viendra de Robert Lucas et de
la nouvelle économie classique dans les
années 1970. Lucas reproche à Keynes
de vouloir élaborer une théorie du désé-
quilibre. Selon lui, le déséquilibre est
le règne de l’arbitraire sur lequel il est
impossible de bâtir une théorie. Il prône
le retour à la discipline d’équilibre basée
sur des fondements microéconomiques
découlant du comportement optimisa-
teur des agents en situation de concur-
rence parfaite. Cela le conduit à rejeter
l’hypothèse d’anticipations adaptatives
en faveur des anticipations rationnelles.
Dans ce nouveau cadre, une politique
monétaire anticipée n’a aucun impact
sur l’activité économique: la hausse de
M se répercute immédiatement dans la
hausse de p; les encaisses réelles M/p
sont inchangées ; la demande agrégée
n’est pas affectée. Seules les politiques
non anticipées (les surprises) peuvent
avoir un impact à court terme.
C’est dans ce contexte qu’émerge
la nouvelle économie keynésienne, qui
reconnaît la nécessité des microfonde-
ments de la macroéconomie, mais refuse
le cadre de la concurrence parfaite
adopté par Lucas. L’unité de ce courant
tient à sa volonté d’adopter des hypo-
thèses plus réalistes –comme la visco-
sité des prix– qui ne devront cependant
plus être postulées mais justiées théo-
riquement. Cette unité méthodologique
a néanmoins très vite donné naissance
à une multitude de modèles à laquelle
il est difcile de trouver une homogé-
néité, que ce soit en termes d’hypothèses
(atomicité des marchés ou pas, informa-
tion parfaite, imparfaite ou asymétrique,
équilibre partiel ou général, etc.) ou de
résultats (présence de chômage involon-
taire ou pas, non-neutralité de la mon-
naie ou pas, etc.).
Dans ce maquis, il faut accepter
d’avancer par touches successives en
perdant de vue la cohérence d’ensemble,
ce que nous faisons dans la suite sans
chercher l’exhaustivité. Les travaux de
la NEK sont présentés dans différents
ouvrages généralistes ([4], [7], [9] et
[11]). Plusieurs articles fondateurs cités
dans ce document sont reproduits par
Mankiw et Romer (1991) [6].
RIGIDITÉS RÉELLES
SUR LE MARCHÉ DU TRAVAIL
ET CHÔMAGE INVOLONTAIRE
En partant de fondements micro éco -
nomiques, les travaux de la NEC
conduisent à rejeter la notion de chô-
mage involontaire : les marchés étant
toujours à l’équilibre, le chômage ne peut
être que volontaire. En réaction, certains
nouveaux keynésiens insistent sur la pré-
sence d’un chômage involontaire décou-
lant de la rigidité du salaire réel. Leur
apport est alors de fonder micro-éco-
nomiquement ces rigidités, en montrant
qu’elles résultent d’un processus ration-
nel d’optimisation de la part des agents.
C’est le cas des modèles de salaire
d’efcience. Ceux-ci supposent généra-
lement une asymétrie d’information en
faveur des salariés qui bénécient d’une
information cachée sur leurs caracté-
ristiques productives (anti-sélection) ou
sur leur comportement (risque moral). Le
modèle le plus connu est celui du tire-
au-anc (document1): pour inciter les
travailleurs à fournir l’effort requis (pro-
blème de risque moral), les entreprises
xent un salaire réel supérieur à celui
qui apure le marché du travail. Il en va
de même dans le modèle d’échanges
de dons proposé par Akerlof (1982) :
les entreprises font un don aux travail-
leurs (en les rémunérant mieux qu’au
salaire d’équilibre), auquel les travail-
leurs répondent par un autre don (en
fournissant un effort supérieur à l’effort
normal)[1]. Enn, lorsque les individus
diffèrent par leurs caractéristiques (pro-
blème d’anti-sélection), les employeurs
ont intérêt à proposer des salaires élevés
s’ils veulent attirer les bons candidats.

33
Puisque ces modèles aboutissent
à la xation d’un salaire réel supérieur
au salaire d’équilibre, ils génèrent du
chômage involontaire. Mais ce chômage
n’a pas les mêmes propriétés que dans
la Théorie générale. Pour Keynes, le
chômage constitue une situation sous-
optimale qui découle de l’insufsance de
la demande agrégée. Ici, en revanche, le
chômage est la solution optimale appor-
tée au problème d’asymétrie d’informa-
tion (c’est un mal pour un bien) et ne
s’explique plus par l’insufsance de la
demande agrégée.
Dans les modèles de négociations,
l’équilibre du marché du travail met
aux prises les entreprises qui cherchent
à maximiser leur prot et les syndicats
qui cherchent à maximiser l’utilité de
leurs adhérents (qui n’adhèrent que s’ils
en tirent un salaire supérieur au salaire
d’équilibre). La conguration utilisée est
généralement celle du droit à gérer [8]:
les syndicats négocient le salaire réel
avec les entreprises qui décident ensuite
le volume d’emploi de façon à maximiser
leur prot. L’équilibre se situe donc sur
la courbe de demande de travail. Cette
courbe étant décroissante, l’emploi est
d’autant plus élevé (chômage faible) que
les syndicats négocient un salaire faible.
Cette situation a davantage de chances
de se produire lorsque les syndicats sont
affaiblis et la négociation très décen-
tralisée (pays anglo-saxons), mais aussi
lorsque les syndicats sont puissants et
la négociation centralisée : la fonction
d’utilité du syndicat se rapproche alors
de celle de l’ensemble de la population
(pays nordiques, Japon…). Dans les cas
intermédiaires, les syndicats auraient
en revanche tendance à négocier des
salaires élevés, au détriment du niveau
d’emploi (France, Espagne…).
Les modèles insiders-outsiders intè-
grent en outre les coûts de rotation de la
main-d’œuvre et l’absence de volonté des
insiders de coopérer avec les outsiders
(Blanchard, Summers, 1986 [in6]; [5]).
Ces modèles, qui éclairent le dualisme
du marché du travail, pourraient égale-
ment expliquer la persistance du chô-
mage (on parle aussi d’hystérèse) obser-
vée dans certains pays européens depuis
les années1980: les insiders tentent de
maintenir leur salaire en cas de conjonc-
ture défavorable, ce qui conduit à une
hausse du chômage ; inversement, ils
négocient des hausses de salaire en cas
de choc positif, ce qui empêche la réduc-
tion du chômage. Dans les modèles de
Friedman ou de Lucas, le chômage revient
spontanément à son taux naturel. Ce n’est
pas le cas dans les modèles d’hystérèse
où le chômage dépend de sa trajectoire
passée et où le chômage conjoncturel (lié
à des chocs aléatoires) se transforme en
chômage structurel. En pratique, le chô-
mage de longue durée augmente, le taux
d’activité diminue et le capital humain
des chômeurs se détériore.
LA VISCOSITÉ DES PRIX
ET SES EFFETS SUR
L’ACTIVITÉ ÉCONOMIQUE
On a vu que, selon Lucas, un choc moné-
taire anticipé par les agents n’inuence
pas l’activité économique. Ce résultat
n’est pas modié en concurrence impar-
faite sur le marché des biens, lorsque
chaque entreprise est «price-maker»: la
hausse anticipée de M se répercute sur
les prix p si bien que M/p reste inchangé.
Mais, pour les nouveaux keynésiens,
les changements de prix entraînent des
coûts de catalogue (changer les étiquettes,
réimprimer les menus, renégocier des
contrats, etc.) qui dissuadent les entre-
prises d’ajuster leur prix en permanence
(Akerlof, Yellen, 1985 ; Mankiw, 1985
[in6]). Les prix ne sont pas véritablement
rigides, ils sont visqueux (ils s’ajustent
lentement). La monnaie n’est alors plus
neutre: une hausse de M se traduit par
une hausse provisoire des encaisses
réelles (M/p), et donc de la demande de
biens ainsi que du niveau d’emploi.
Les coûts de catalogue ne constituent
toutefois qu’une part minime des coûts
de production. On peut alors douter de
l’ampleur de leur impact sur l’activité
économique. Les nouveaux keynésiens
répondent à cette critique en soulignant
une propriété centrale de la concurrence
imparfaite: certes, arrive un moment où
toutes les entreprises auraient intérêt à
accepter les coûts de catalogue et à aug-
menter leurs prix; mais les premières qui
s’engagent dans cette voie laissent des
parts de marché à leurs concurrentes ;
chacune attend donc de voir ce que font
les autres avant de bouger. Cette exter-
nalité retarde l’ajustement bien au-delà
de ce que représentent les seuls coûts
de catalogue, d’où un effet amplié sur
l’activité économique.
À ce stade, l’hypothèse d’anticipa-
tions rationnelles n’a pas été sérieuse-
ment prise en compte par la NEK. Or,
c’est indispensable pour adresser une
critique de fond à l’approche de Lucas
qui, rappelons-le, prédit que les chocs de
demande anticipés par les agents n’ont
pas d’impact sur l’activité économique.
La riposte consiste à montrer que le
résultat de Lucas n’est pas lié aux anti-
cipations rationnelles mais à son hypo-
thèse de concurrence parfaite.
Cette question a été abordée par le
biais des modèles à contrats échelon-
nés, concernant la xation des salaires
nominaux (Fisher, 1977 ; Taylor, 1979
[in6]) ou celle des prix des produits[3].
Supposons ainsi que seule une fraction
des entreprises puisse réviser leurs prix
à chaque période, par exemple 20%. Si
elles anticipent une hausse de l’ination,
On suppose que les salariés ont la possibilité de moduler leur effort. En l’absence de
contrôle, parce qu’ils maximisent leur utilité et que l’effort génère de la désutilité, ils
fournissent un effort limité. Contrôler tous les salariés pour les amener à un effort plus
important serait trop coûteux pour l’entreprise. Elle a alors intérêt à procéder à un
contrôle aléatoire et à licencier les tire-au-anc. Cette procédure est cependant inutile
lorsque le marché du travail est au plein-emploi et que le salaire est le même partout:
le salarié licencié retrouve une place rémunérée de la même façon ailleurs. Pour maxi-
miser son prot, l’entreprise doit donc augmenter ses salaires en versant une prime qui
compense la désutilité liée au surcroît d’effort. Si toutes les entreprises procèdent ainsi,
le salaire réel de l’économie augmente et un chômage involontaire apparaît. Ici, l’inci-
tation à l’effort s’explique donc par la crainte de perdre son emploi. Aucun salarié ne
tire plus au anc tant que les entreprises maintiennent des contrôles sporadiques et un
salaire au niveau du salaire d’efcience. Enn, la hausse des allocations chômage incite
les entreprises à augmenter le salaire d’efcience pour maintenir le niveau d’effort.
Source: auteur.
DOCUMENT1. LE MODÈLE DU TIRE-AU-FLANC (Shapiro, Stiglitz, 1984 [in6])

4
elles l’intègrent immédiatement pour
ne pas être pénalisées par la suite. Ce
comportement satisfait donc l’hypothèse
des anticipations rationnelles. Mais le
prix des 80 % autres entreprises reste
inchangé. C’est donc nalement la vis-
cosité des prix qui l’emporte, impliquant
la non-neutralité de la monnaie (M/p
augmente).
LA FAIBLESSE DE L’ACTIVITÉ,
CONSÉQUENCE DES ÉCHECS
DE COORDINATION
Certains nouveaux keynésiens conser vent
l’hypothèse (d'atomicité des marchés),
tout en mettant en évidence des défauts
de coordination qui affectent le niveau
de production. C’est le cas de Diamond
(1982 [in 6]), qui présente un modèle
dans lequel les coûts de transaction
(notamment la recherche de clients) sont
élevés lorsque l’économie est atone, et
inversement. Cette approche remet aussi
au cœur de l’analyse la question chère à
Keynes des croyances et de l’incertitude.
Ainsi, lorsque la majorité des entrepre-
neurs anticipent un niveau d’activité élevé
dans l’économie, ils en déduisent que les
coûts de transaction seront faibles, ce qui
les incite à produire beaucoup. L’écono-
mie se stabilise alors sur un « équilibre
haut», avec un niveau d’emploi élevé. À
l’opposé, s’ils sont pessimistes quant au
niveau global d’activité, ils pensent que
les coûts de transaction seront élevés, ce
qui les incite à produire peu. L’économie
se stabilise sur un «équilibre bas», avec
un faible niveau d’emploi.
Ce type de modèle est caractérisé par
l’existence de multiples équilibres (deux
ou plus) ainsi que par des anticipations
auto-réalisatrices. Ce sont les croyances
qui déterminent l’équilibre atteint par
le système. Peu importe qu’elles soient
rationnellement fondées ou pas ; on
peut même imaginer qu’elles reposent
sur l’apparition ou la disparition de
taches solaires (d’où le développement
de modèles combinant croyances, taches
solaires et équilibres multiples dans la
littérature économique). Bien sûr, en
présence d’un «équilibre bas», les poli-
tiques de relance peuvent nourrir l’opti-
misme des entrepreneurs, ce qui permet
de revenir à l’«équilibre haut».
D’UNE POLITIQUE MONÉTAIRE
DISCRÉTIONNAIRE
À UNE POLITIQUE DE RÈGLE
Un des résultats centraux de la NEK est
donc que la politique monétaire retrouve
de l’efcacité en présence de viscosité
des prix ou d’échecs de coordination.
Sur le plan théorique, cela se traduit
par l’élaboration de la courbe de Phillips
des nouveaux keynésiens (document2):
les entreprises qui le peuvent (20 %
dans l’exemple ci-dessus concernant le
modèle de Calvo) augmentent leur prix
lorsqu’elles anticipent un rythme de la
création monétaire plus soutenu. Mais
les autres, dont le prix est xe, réagissent
en produisant davantage. L’emploi aug-
mente et le chômage diminue. L’analyse
de la relation ination-chômage se rap-
proche donc de celle des monétaristes, à
ceci près que les anticipations d’ination
ne dépendent plus du passé mais du futur.
Dans le cadre de la synthèse néoclassique, la courbe de Phillips (CP0) permet de déter-
miner le taux d’ination (π) en fonction du taux de chômage (u). Partant du point A,
si l’État réussit à baisser le chômage par une politique de relance (uB), le pouvoir de
négociation des salariés s’améliore. Ils obtiennent des hausses de salaire qui se réper-
cutent sur l’ination (πB).
Pour les monétaristes, le taux de chômage s’établit à long terme à son niveau struc-
turel (ou naturel, un). Une relance monétaire entraîne une hausse de l’ination dont
les salariés ne prennent pas immédiatement conscience (les anticipations adaptatives
dépendent du passé). Ils ne s’aperçoivent pas de la baisse du salaire réel et acceptent
de travailler davantage: l’économie passe de A à B. À long terme, ils prennent cepen-
dant conscience que leur pouvoir d’achat a diminué. Ils obtiennent l’indexation de
leur salaire sur l’ination et l’économie passe au point C: l’ination reste le seul effet
de la politique monétaire, d’où une courbe de Phillips de long terme verticale (CPLT).
Si la Banque centrale persiste dans ce type de politiques, on passe à D (le long d’une
nouvelle courbe, CP1), puis à F. Si elle cherche au contraire à ramener l’ination à πA en
une seule période, on passe de C à G avec un coût social très important: le chômage
s’élève à uG avant de revenir progressivement à un (point A). D’où la préconisation des
monétaristes d’un ralentissement graduel permettant de passer de C à A en limitant
le coût en termes de chômage.
Pour la NEC, les anticipations des agents sont tournées vers le futur (anticipations
rationnelles). De ce fait, les chocs monétaires anticipés sont immédiatement absorbés
par l’ination. L’équilibre se déplace donc le long de CPLT. Seuls les chocs non anticipés,
les surprises monétaires, peuvent avoir un effet temporaire sur le taux de chômage.
La NEK reprend l’hypothèse d’anticipations rationnelles. Mais, en la combinant avec
les rigidités de prix, elle retrouve la forme décroissante des courbes de Phillips des
monétaristes, même lorsque la politique est parfaitement anticipée. Il est à nouveau
possible de passer de A à B à court terme, puis à C lorsque toutes les entreprises ont
pu modier leurs prix en prenant en compte le nouveau taux d’ination πA. L’ination
peut aussi s’accélérer (points D et F). La principale innovation par rapport aux moné-
taristes est que, puisque l’ination dépend du futur et non plus du passé, son inertie
est moindre. Cette propriété a des conséquences intéressantes lorsqu’il s’agit de mener
une politique de désination (pour passer de C à A): la diminution de π est plus rapide
et le coût en termes de chômage plus limité que dans le cas monétariste. Le risque
d’hystérèse résultant d’une élévation du chômage est donc également réduit.
Source: auteur.
DOCUMENT2. LA COURBE DE PHILLIPS
u
un
A
A
BC
DF
CP 0
CP LT
B
CP 1
G
u
G
u
B

5
Le recours à la politique monétaire
discrétionnaire pour stabiliser l’écono-
mie se heurte néanmoins à la critique
émanant de la NEC concernant l’inco-
hérence temporelle des politiques éco-
nomiques: lorsqu’elle réagit à des chocs
conjoncturels ponctuels par des poli-
tiques stabilisatrices, la Banque centrale
contredit inévitablement ce qu’elle a
promis antérieurement (par exemple, en
menant une expansion monétaire après
avoir annoncé la stabilité). Ses annonces
ne sont alors plus crédibles et les poli-
tiques discrétionnaires perdent leur
efcacité. Les nouveaux classiques pré-
conisent alors d’accorder l’indépendance
aux Banques centrales et de leur don-
ner pour seul mandat de viser une cible
d’ination. Ils prônent aussi le remplace-
ment des politiques discrétionnaires par
des politiques de règles.
Les nouveaux keynésiens ont inté-
gré ces recommandations dans leurs
modèles les plus récents (document 3),
sans pour autant perdre de vue le rôle de
la politique monétaire sur l’activité éco-
nomique. Selon la règle de Taylor [10],
la Banque centrale xe ainsi son taux
d’intervention en fonction de sa cible
d’ination et de l’activité économique
(qui détermine le niveau de l’emploi à
court terme). La Banque augmente son
taux lorsqu’elle constate une hausse, soit
du taux d’ination relativement à son
taux cible, soit du niveau de production.
Inversement, un choc défavorable sur
l’activité l’amène à réduire son taux d’in-
tervention, le résultat attendu étant que
les ménages réagissent en augmentant
leur consommation courante, éventuel-
lement en recourant au crédit (rappelons
que dans les modèles de la synthèse néo-
classique, la baisse du taux d’intérêt agit
plutôt sur la dépense d’investissement).
Pour John B.Taylor, cette règle joue
un rôle prescriptif. Une fois ses para-
mètres déterminés, la Banque centrale
doit s’y conformer. Taylor s’est alors
montré très critique vis-à-vis de la poli-
tique de la FED, qui serait responsable
des mauvaises performances de l’éco-
nomie américaine en ayant xé un taux
trop faible au milieu des années 2000
(favorisant ainsi la bulle immobilière),
puis après la crise de 2008. Cette posi-
tion fait l’objet de controverses au sein
même de la NEK.
LES POLITIQUES BUDGÉTAIRES:
LES DÉBATS SUR LA VALEUR
DES MULTIPLICATEURS
Pour les keynésiens du courant de la
synthèse des années 1960, l’interven-
tion de l’État par la hausse des dépenses
publiques ou par la baisse des impôts
génère des effets multiplicateurs per-
mettant de relancer la production et
l’emploi. Cette approche a fortement été
BULLETIN D’ABONNEMENT
Oui, je m’abonne à Écoash (10 nos/an) au prix de 32 € • Bulletin à retourner accompagné de votre règlement à Réseau Canopé - Agence comptable-abonnements
Téléport 1 - 1, av. du Futuroscope CS 80158 - 86961 Futuroscope Cedex - Relations abonnés : 03 44 62 43 98 • Télécopie : 03 44 58 44 12 • Email : [email protected]
ÉCOFLASH PRIX QUANTITÉ TOTAL
FRANCE ÉTRANGER
1 an 32 € 39 €
2 ans 58 € 75 €
Nom, prénom (écrire en majuscules)
Établissement Signature et cachet de l’organisme payeur
Prix valables jusqu’au 31 mars 2017
N° rue, voie, boite postale
Localité Code postal
VENTE À L’UNITÉ 4 €
• En ligne : reseau-canope.fr
• Dans les Ateliers Canopé (adresses sur reseau-canope.fr/nous-trouver)
• À la librairie Canopé | 13, rue du Four | 75006 Paris (M° Mabillon) | N° vert : 0800 008 212
RÈGLEMENT À LA COMMANDE
• Par chèque bancaire à l’ordre de
l’Agent comptable de Réseau Canopé,
• Par mandat administratif à l’ordre
de l’Agent comptable de Réseau Canopé,
DRFI Poitou-Charentes
Code établissement 10071,
code guichet 86000
n° de compte 00 001 003 010, clé 68
Nom de l’organisme payeur :
....................................................................
...................................................................
N° de CCP.......…………………………………………...........
Merci de nous indiquer le n° RNE de
votre établissement................................................
Depuis Hicks et le modèle IS-LM, les théories macroéconomiques reposent essen-
tiellement sur l’élaboration de modèles paramétriques parcimonieux (avec le mini-
mum d’hypothèses possible), permettant de mettre en évidence tel ou tel mécanisme
économique.
Une autre méthode tend cependant à se développer depuis la n des années 1980,
avec la diffusion des modèles dynamiques d’équilibre général stochastiques (MDEGS,
équivalent français des DSGE: Dynamic Stochastic General Equilibrium). Ces modèles
trouvent leur origine dans la théorie des cycles à l’équilibre proposée par Lucas dans
les années 1970. Les cycles ne s’expliquent plus par un écart à une tendance d’équi-
libre mais par un déplacement de l’équilibre lui-même: ils résultent de chocs aléa-
toires auxquels les agents répondent de façon optimale, dans un contexte de concur-
rence parfaite, sur la base de leurs anticipations rationnelles. Pour le dire autrement,
Lucas analyse la dynamique de l’équilibre général au cours du temps, suite à des chocs
stochastiques. Cette approche sera approfondie par le courant des cycles réels dans les
années1980, pour être formalisée dans des MDEGS: il s’agit de modèles calibrés (une
valeur numérique est attribuée à chaque paramètre) permettant de simuler la dyna-
mique de l’équilibre au cours du temps, suite à un choc aléatoire exogène.
Il faut attendre la n des années 1990 pour que des hypothèses spéciques à la NEK
soient introduites dans les MDEGS: la concurrence imparfaite, la viscosité des prix et la
règle de Taylor. Comme ces MDEGS nouveaux keynésiens intègrent des éléments cen-
traux de la NEC (anticipations rationnelles, fondements microéconomiques), ils consti-
tuent une forme de consensus qui donne naissance à la nouvelle synthèse néoclassique.
Source: auteur.
DOCUMENT3. LES MODÈLES DYNAMIQUES D’ÉQUILIBRE GÉNÉRAL
STOCHASTIQUE (MDEGS)
 6
6
1
/
6
100%