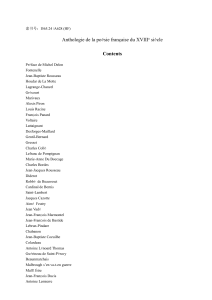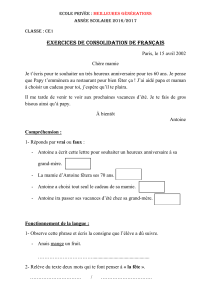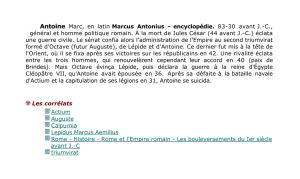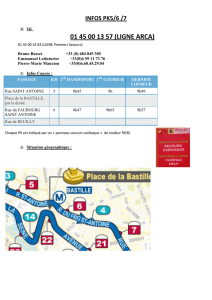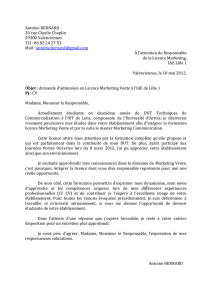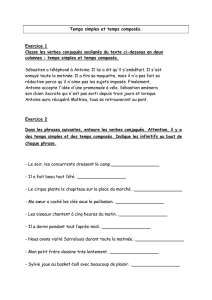Antoine d'Agata: Photographie, Douleur et Engagement Politique
Telechargé par
caro.ulloa88

Antoine d’Agata
Diana ULLOA
L-3 arts du spectacle
TD Réflexions historiques et esthétiques Photographie
Roger-Yves Roche
1 avril 2022

Antoine d’Agata
J’aime cet instant dans lequel je regarde une photographie inusuelle, qui m’oblige à
m’enfoncer dans les détails, aller chercher plus loin et essayer de comprendre ce qui attire
mon attention. Par exemple dans les photos de Antoine d’Agata, je vois des corps qui se
transforment en fantômes, je vois aussi la brutalité de sa prise, une provocation par l’image
qui me confronte à un sentiment obscur, sincère et violent.
C’est ce qui m’attire, la vie elle-même dans son plaisir et sa cruauté vue comme art, le flouté
évanescent de la vie enregistrée dans une surface immobile, les corps et ses formes
multipliés comme symbole de vérité intérieur.
La nature d’Antoine d’Agata est une réunion de choses vécues et affirmées, la confrontation
entre sa propre vie et son art, ce sont des images qui montrent sa volonté de s’abandonner
à l’excès et de toucher les limites. Il brule la chandelle par les deux bouts ; « Le sexe contre
la mort, la drogue comme possibilité d’oublier la mort »
Son acte photographique se présente d’abord comme une façon d’expérimenter son art et
puis c’est une façon de faire entendre son geste politique. Le travail artistique d’Antoine
d’Agata repose sur l’intime, vivre et faire de l’art sont le même geste. Il fait de la photographie

un moyen d’expression qui nait de son inconformité vers un monde étouffant, une tentative
subversive sans aucune complaisance à l’égard du spectateur, dans l’idée de déconstruire
une esthétisation qui arrive forcément avec la photographie.
Antoine d’Agata avec ses photos et ses textes parle de la douleur, la peur, la panique, la
solitude, le sexe, la mort et la vie. Ses photos sont souvent des corps déformés de femmes,
des corps qui ressemblent à des fantômes, parfois ce sont deux corps qui se mélangent en
un seul. Il transforme la réalité avec l’aide du temps, des textures mélangées ou des couleurs
diffuses qui fabriquent des formes humaines et qui se perdent dans le flux.
On peut comparer les photos d’Agatha avec les figures qui réapparaissent
obsessionnellement dans les portraits de Francis Bacon : des visages et des corps
consumés par quelque chose qui vient de l’intérieur. Les images de Antoine d’Agata montrent
la chair déformée et évaporée. Ses images renvoient à une fiction, ou peut-être à une réalité,
la mort et le sexe s’entremêlent dans des images qui tentent de transmettre un sentiment
dans son état le plus pur, presque animal.
Comme le disait le philosophe Gilles Deleuze « Devenir animal, c’est partir loin hors de soi,
sortir de chez soi, se « déterritorialiser », éprouver les extases d’un être-là qui s’ouvre à
l’altérité. » car nous sommes habités par une démesure, qui nous excède, nous dépasse.
L’image est alors un outil, qui enregistre leur existence. L’appareil photo comme un prétexte
libérateur qui enregistre des corps dans leur violence, dans leur jouissance, dans leur
solitude. Ses photos sont à la fois une représentation de sa propre existence et aussi un outil
d’engagement politique. Ses photos et ses journaux intimes servent à exprimer une position
engagée contre le fait d’exister dans un monde cruel avec des lois incompressibles.

La photographie lui permet de protester contre la manipulation médiatique d’un monde
capitaliste qui nous étouffe.
Je crois que les photos d'Antoine d'Agata ont pour finalité l'idée d'affronter soi-même,
d'affronter sa propre douleur, la violence extérieure, de dépasser les limites et de ne pas fuir.
Ils sont une recherche personnelle où l'excès fait partie de l'art lui-même. Ses obsessions
sont photographiées encore et encore, les photos s'accumulent ainsi comme des situations
de violence qui se répètent.
Une infinité de visages et de corps de femmes condamnées à une solitude irrémédiable. Les
réalités sombres du monde : la douleur des marginaux, l’esclavage humain, la prostitution,
la femme comme objet, se fondent en images d’une intensité monstrueuse qui révèlent
l’intime.
Comment se montrer devant le monde ? Antoine d’Agata devient auteur et protagoniste de
ses propres photos, elles sont un dédoublement de son être, d’une certaine façon
l’esthétisation de quelque chose d’inacceptable pour le monde « normal », ce sont des
photos pornographiques et exhibitionnistes pour certains, mais au-delà de ça, c’est une
destruction de la frontière entre ce qui doit être montré et ce qui doit être protégé. Ainsi, il vit
de manière marginale, dans sa brutalité et il accepte le vice comme principe de vie.
1
/
4
100%