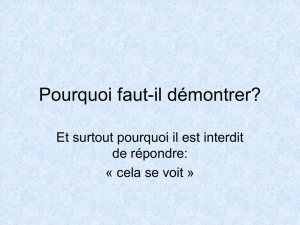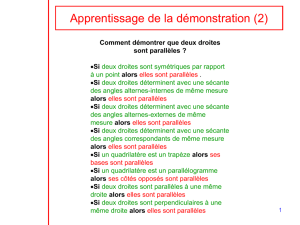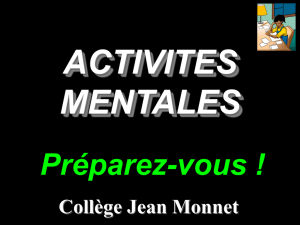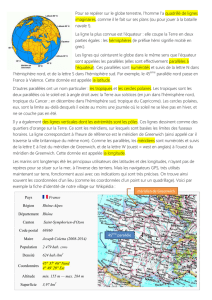Organisation de l’aviation civile internationale
Approuvé par le Secrétaire général
et publié sous son autorité
Manuel sur les opérations
simultanées sur pistes
aux instruments parallèles
ou quasi parallèles (SOIR)
Première édition — 2004
Doc 9643
AN/941

II
AMENDEMENTS
La parution des amendements est annoncée dans le Journal de l’OACI ainsi que dans
le Supplément mensuel au Catalogue des publications et des aides audiovisuelles de
l’OACI, que les détenteurs de la présente publication sont priés de vouloir bien
consulter. Le tableau ci-dessous est destiné à rappeler les divers amendements.
INSCRIPTION DES AMENDEMENTS ET DES RECTIFICATIFS
AMENDEMENTS RECTIFICATIFS
No Date Inséré par N
o Date Inséré par

III
AVANT-PROPOS
À la demande de la Commission de navigation aérienne, le
Secrétariat de l’OACI a produit un rapport sur les opérations
simultanées utilisant des pistes aux instruments parallèles
ou quasi parallèles, rapport qui contenait des propositions
concernant les distances minimales entre les pistes aux
instruments. En 1980, la Commission a étudié le rapport, qui
reconnaissait qu’il était difficile de déterminer des valeurs
acceptables pour ces distances et convenait de la nécessité
d’un complément d’étude par l’OACI. Les États et certaines
organisations internationales ont été invités à fournir des
renseignements sur les pratiques courantes et les questions
connexes relatives aux distances minimales entre les pistes
parallèles utilisées pour des opérations simultanées en régime
de vol aux instruments (IFR).
Quatre États ont indiqué avoir une expérience opérationnelle
des opérations simultanées sur pistes aux instruments parallèles
et avoir effectué des études sur le sujet. Les conditions appli-
cables à ces opérations étaient importantes, et un appui a été
exprimé en faveur de l’élaboration de spécifications et de
l’exécution de travaux s’y rapportant.
À la lumière des points de vue exprimés par les États et
les organisations internationales sur les distances minimales
entre les pistes aux instruments utilisées pour des opérations
simultanées, la Commission a pris acte de la complexité de la
question et noté que celle-ci touchait à de nombreuses
disciplines de la navigation aérienne. Elle a jugé qu’en raison de
cette complexité, des éléments indicatifs étaient nécessaires. En
janvier 1981, la Commission a décidé de procéder à l’étude et
autorisé la mise sur pied d’un groupe d’étude de la navigation
aérienne, le Groupe d’étude des opérations simultanées sur
pistes aux instruments parallèles ou quasi parallèles (SOIRSG),
destiné à aider le Secrétariat dans ses travaux.
Par la suite, à la demande de la Commission, le Secrétariat
de l’OACI, avec le concours du SOIRSG, a rédigé le présent
manuel.
Les renseignements figurant dans ce manuel tiennent
compte de l’expérience de plusieurs États et visent à faciliter
l’application des dispositions OACI applicables, qui figurent
dans l’Annexe 14 — Aérodromes, Volume I — Conception et
exploitation technique des aérodromes, Chapitres 1er et 3, ainsi
que dans les Procédures pour les services de navigation
aérienne — Gestion du trafic aérien (PANS-ATM, Doc 4444),
Chapitre 6, et les Procédures pour les services de navigation
aérienne — Exploitation technique des aéronefs (PANS-OPS,
Doc 8168), Volume I, Ire Partie, Chapitre 1er, et Volume II,
IIe Partie, Chapitre 6.
Après la mise à jour des dispositions de l’OACI rela-
tives à l’exploitation SOIR, qui sont devenues applicables le
9 novembre 1995, le SOIRSG a poursuivi ses travaux, en
participant à l’évaluation de nouvelles technologies, comme le
système mondial de navigation par satellite (GNSS), en vue de
la prise en charge d’opérations IFR simultanées sur des pistes
parallèles rapprochées, afin de mettre à jour les dispositions et
éléments indicatifs applicables, selon les besoins.
Le présent manuel est un document évolutif. Des amen-
dements périodiques ou de nouvelles éditions seront publiés en
fonction de l’expérience acquise ainsi que des observations
et suggestions provenant de ses utilisateurs. Les lecteurs sont
donc invités à envoyer leurs observations, points de vue et
suggestions à l’adresse suivante :
Le Secrétaire général
999, rue University
Montréal (Québec) H3C 5H7
Canada
 6
6
 7
7
 8
8
 9
9
 10
10
 11
11
 12
12
 13
13
 14
14
 15
15
 16
16
 17
17
 18
18
 19
19
 20
20
 21
21
 22
22
 23
23
 24
24
 25
25
 26
26
 27
27
 28
28
 29
29
 30
30
 31
31
 32
32
 33
33
 34
34
 35
35
 36
36
 37
37
 38
38
 39
39
 40
40
1
/
40
100%