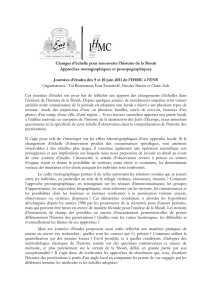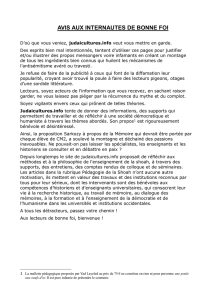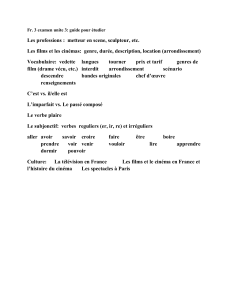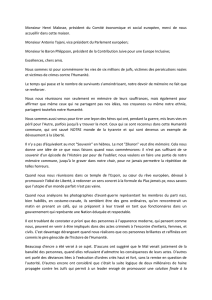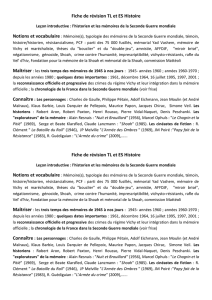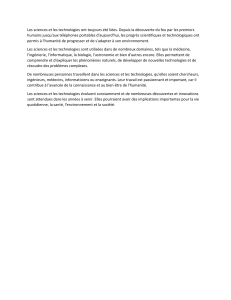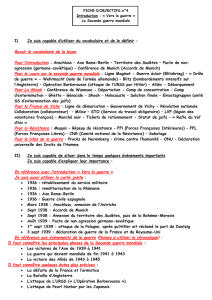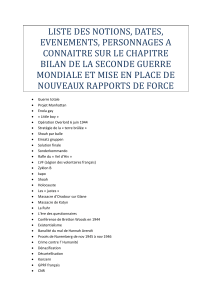Mémoi
moire
Mémoire
ire
moire
Remem
emember
Memoi
Rem
La mise en scène cinématographique de la Shoah et des crimes contre
l’humanité en général pose aux réalisateurs une question clé, celle du réalisme
de la représentation, question à la fois éthique et esthétique. Entre les docu-
mentaires et les fictions, entre les reconstitutions historiques, comme La Liste
de Schindler de Steven Spielberg, qui s’attachent à mettre en scène la réalité
dans tous ses détails, et les films plus symboliques comme celui de Roberto
Benigni, La Vie est belle, tous les degrés sont représentés. Certains films donnent
lieu à des polémiques, dont il s’agit de comprendre les enjeux. Le cinéma est-il le
meilleur moyen d’informer les jeunes générations de ce qui s’est passé? N’est-ce
pas plutôt le rôle d’autres documents – CD-Rom, vidéo, archives ? Quelle
différence y a-t-il entre ces supports et le cinéma en tant qu’art ? Est-il possible
d’instruire et d’émouvoir sans rien montrer ? L’émotion elle-même, souvent
très vive, n’est-elle pas ambivalente? Telles sont les questions posées par ce
livre, pour montrer que le cinéma, art majeur de notre époque, ne peut se
contenter de mettre en scène l’horreur concentrationnaire, mais doit éduquer,
chez un public de plus en plus jeune, une sensibilité émoussée par l’abus que
font les médias des images de la violence.
ISBN 978-92-871-5492-7
9789287 154927
00000
Le Conseil de l’Europe regroupe aujourd’hui 47 Etats membres, soit la quasi-totalité
des pays du continent européen. Son objectif est de créer un espace démocratique et
juridique commun, organisé autour de la Convention européenne des Droits de l’Homme
et d’autres textes de référence sur la protection de l’individu. Créé en 1949, au lende-
main de la seconde guerre mondiale, le Conseil de l’Europe est le symbole historique de
la réconciliation.
http://book.coe.int
Editions du Conseil de l’Europe
www.coe.int
12 e/18 $US
Council of Europe Publishing
Editions du Conseil de l’Europe
La Shoah à l’écran
Crime contre l’humanité
et représentation
Tome I
Anne-Marie BARON
La Shoah à l’écran Crime contre l’humanité et représentation
Éditions du Conseil de l’Europe
Council of Europe Publishing
Editions du Conseil de l’Europe
Council of Europe Publishing
Editions du Conseil de l’Europe
Council of Europe Publishing
Editions du Conseil de l’Europe

La Shoah à l’écran
Crimes contre l’humanité
et représentation
Editions du Conseil de l’Europe

Les opinions exprimées dans cet ouvrage sont de la responsabilité des auteurs et
ne reflètent pas nécessairement la ligne officielle du Conseil de l’Europe.
Tous droits réservés. Aucun extrait de cette publication ne peut être traduit, repro-
duit, enregistré ou transmis, sous quelque forme et par quelque moyen que ce soit
– électronique (CD-Rom, Internet, etc.), mécanique, photocopie, enregistrement
ou toute autre manière – sans l’autorisation préalable écrite de la Division des
Editions, Direction de la communication et de la recherche.
Conception : Atelier de création graphique du Conseil de l’Europe
Editions du Conseil de l’Europe
F-67075 Strasbourg Cedex
ISBN 92-871-5492-9
©Conseil de l’Europe, septembre 2004
Imprimé dans les ateliers du Conseil de l’Europe

Table des matières
Prémisses .............................................................................................................................. 7
I. Génocide et crime contre l’humanité .............................................................. 7
II. Le problème terminologique .............................................................................. 9
III. La question de la représentation ....................................................................... 10
IV. Cinéma et histoire ................................................................................................... 12
V. Documentaire et fiction ........................................................................................ 14
VI. Litote et emphase (understatement et overstatement) .............................. 16
VII. Réalisme et anti-réalisme .................................................................................... 17
VIII. Codes filmiques et codes profilmiques .......................................................... 19
IX. La question du comique ....................................................................................... 20
PREMIÈRE PARTIE: REGARDS DOCUMENTAIRES
A. Une école ........................................................................................................................ 25
I. Pionniers : ................................................................................................................... 25
Nuit et Brouillard (Alain Resnais), 1955 ...................................................... 25
Le Chagrin et la Pitié (Marcel Ophüls), 1970 ............................................ 28
De Nuremberg à Nuremberg (Frédéric Rossif), 1994 ............................. 31
II. Documentaires sans documents : ...................................................................... 34
Shoah (Claude Lanzmann), 1985 ..................................................................... 34
Drancy avenir (Arnaud des Pallières), 1997 ............................................... 37
III. Acteurs et témoins du drame : ........................................................................... 40
Falkenau, vision de l’impossible (Emil Weiss), 1988 ............................. 40
Un spécialiste, portrait d’un criminel moderne
(Eyal Sivan et Ronny Brauman), 1999 .......................................................... 42
Sobibor (Claude Lanzmann), 2002 .................................................................. 45
B. Autres regards ............................................................................................................. 47
So many miracles (Tant de miracles, Katherine Smalley),
Canada, 1986 ............................................................................................................ 47
Terezin diary (Journal de Terezin, Dan Weissman),
Grande-Bretagne, 1990 ........................................................................................ 49
Shtetl, a journey home (Marian Marzynski), Etats-Unis, 1996 ............ 51
Jenseits des Krieges (A l’est de la guerre, Ruth Beckermann),
Autriche, 1996 ......................................................................................................... 53
Shalosh ahayot (Trois sœurs, Tsipi Reibenbach), Israël, 1997 ............ 55
DEUXIÈME PARTIE: FICTIONS AMÉRICAINES
I. Modèles du réalisme : ............................................................................................ 59
Holocaust (Holocauste, Marvin Chomsky), 1978 ..................................... 59
Shindler’s list (La Liste de Schindler, Steven Spielberg), 1994 .......... 62
3

II. Reconstitution historique moderne : ................................................................ 65
Uprising, (1943, l’ultime révolte, Jon Avnet), 2001 ................................ 65
III. «La réalité pure»: ................................................................................................... 68
The Pianist (Le Pianiste, Roman Polanski), 2002 ..................................... 68
IV. Lendemains de guerre : ......................................................................................... 71
Sophie’s choice (Le Choix de Sophie, Alan Pakula), 1982 .................... 71
Taking sides (Istvan Szabo), 2001 ................................................................... 73
TROISIÈME PARTIE: FICTIONS EUROPÉENNES
I. Propagande nazie : .................................................................................................. 77
Jud Süss (Le Juif Süss, Veit Harlan), Allemagne, 1940 .......................... 77
II. Reconstitutions historiques : ............................................................................... 79
Wannseekonferenz (La Conférence de Wannsee, Heinz Schirk),
Autriche, 1984 ......................................................................................................... 79
Korczak (Andrzej Wajda), Pologne, 1990 .................................................... 82
III. Histoire et fiction : .................................................................................................. 84
Pasazerka (La Passagère, Andrzej Munk), Pologne, 1963 ................... 84
Monsieur Klein (Joseph Losey), France/Italie, 1976 ................................ 86
Au revoir les enfants (Louis Malle), France, 1987 .................................... 89
La Tregua (La Trêve, Francesco Rosi, d’après Primo Levi),
Italie, 1997 ................................................................................................................. 91
Invincible (Werner Herzog), Allemagne, 2001 .......................................... 93
Amen (Costa-Gavras), France, 2002 ............................................................... 95
IV. Anti-réalisme : .......................................................................................................... 98
Voyages (Emmanuel Finkiel), France, 1999 ................................................ 98
La Guerre à Paris (Yolande Zauberman), France, 2001 ........................ 101
La Dernière Lettre (Frederick Wiseman), France, 2002 ........................ 103
La Petite Prairie aux bouleaux (Marceline Loridan-Ivens),
France, 2003 ............................................................................................................. 106
QUATRIÈME PARTIE: COMÉDIES
The Great dictator (Le Dictateur, Charles Chaplin), Etats-Unis, 1940 ... 111
To be or not to be (Ernst Lubitsch), Etats-Unis, 1942 .............................. 114
La vita è bella (La vie est belle, Roberto Benigni), Italie, 1997 .......... 116
Demain on déménage (Chantal Akerman), Belgique, 2004 .................. 120
CINQUIÈME PARTIE: CRIMES CONTRE L’HUMANITÉ: UNE LONGUE SUITE…
The Killing fields (La Déchirure, Roland Joffé),
Grande-Bretagne, 1984 ........................................................................................ 125
Zegen (Le Seigneur des bordels, Shohei Imamura), Japon, 1987 ....... 128
4
La Shoah à l’écran – Crimes contre l’humanité et représentation
 6
6
 7
7
 8
8
 9
9
 10
10
 11
11
 12
12
 13
13
 14
14
 15
15
 16
16
 17
17
 18
18
 19
19
 20
20
 21
21
 22
22
 23
23
 24
24
 25
25
 26
26
 27
27
 28
28
 29
29
 30
30
 31
31
 32
32
 33
33
 34
34
 35
35
 36
36
 37
37
 38
38
 39
39
 40
40
 41
41
 42
42
 43
43
 44
44
 45
45
 46
46
 47
47
 48
48
 49
49
 50
50
 51
51
 52
52
 53
53
 54
54
 55
55
 56
56
 57
57
 58
58
 59
59
 60
60
 61
61
 62
62
 63
63
 64
64
 65
65
 66
66
 67
67
 68
68
 69
69
 70
70
 71
71
 72
72
 73
73
 74
74
 75
75
 76
76
 77
77
 78
78
 79
79
 80
80
 81
81
 82
82
 83
83
 84
84
 85
85
 86
86
 87
87
 88
88
 89
89
 90
90
 91
91
 92
92
 93
93
 94
94
 95
95
 96
96
 97
97
 98
98
 99
99
 100
100
 101
101
 102
102
 103
103
 104
104
 105
105
 106
106
 107
107
 108
108
 109
109
 110
110
 111
111
 112
112
 113
113
 114
114
 115
115
 116
116
 117
117
 118
118
 119
119
 120
120
 121
121
 122
122
 123
123
 124
124
 125
125
 126
126
 127
127
 128
128
 129
129
 130
130
 131
131
 132
132
 133
133
 134
134
 135
135
 136
136
 137
137
 138
138
 139
139
 140
140
 141
141
 142
142
 143
143
 144
144
 145
145
 146
146
 147
147
 148
148
1
/
148
100%