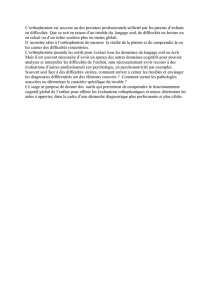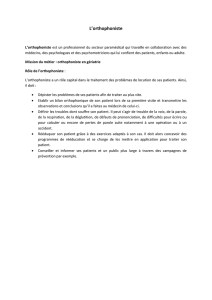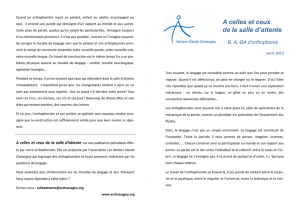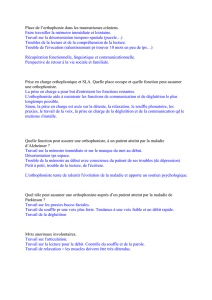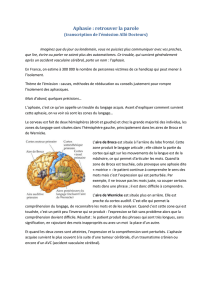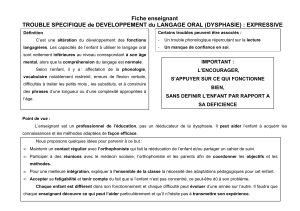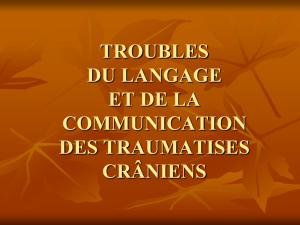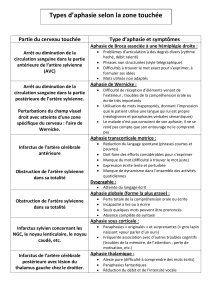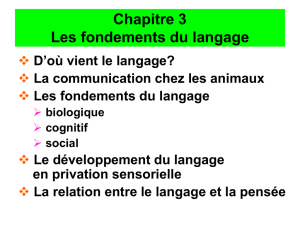Orthophoniste : BEN GOUIDER.S
1
LES APHASIES
1. XIXe siècle : Naissance de l’aphasiologie
En 1836 Max Dax, médecin à Sommières, fut le premier à localiser ce qu’il
appela
« L’oubli des signes de la pensée » dans la moitié gauche de l’encéphale.
C’est Paul Broca, chirurgien à l’hôpital Bicêtre, qui effectua une véritable percée
médiatique en 1861 avec l’étude de son patient M. Leborgne.Ce patient, atteint
depuis vingt ans d’une hémiplégie droite et d’une aphasie réduite à l’émission
d’une stéréotypie : « tan-tan ». Broca réalisa l’autopsie et pu ainsi conclure que le
siège du « langage articulé » se situait dans la troisième circonvolution frontale
gauche. Pour la première fois, un lien causal était suggéré entre une lésion
circonscrite du cerveau et l’abolition d’une fonction supérieure de l’esprit telle
que le langage. Broca baptise du nom d’aphémie. Ce symptôme assez singulier
où la faculté générale du langage persiste inaltérée, où l’appareil auditif est intact,
où tous les muscles, sans excepter ceux de la voix et ceux de l’articulation,
obéissent à la volonté, et où pourtant une lésion cérébrale abolit le langage
articulé. En 1864, Armand Trousseau, déclara le terme d’aphémie impropre et
introduisit le concept d’aphasie.
L’étude scientifique du langage débute donc avec une approche anatomo-
clinique, qui affirme le lien entre la sémiologie du désordre langagier et une lésion
corticale objectivée à l’examen anatomo-pathologique. De l’observation princeps
de Broca naît la théorie localisationniste : toute fonction cognitive s’élabore au
sein d’aires cérébrales bien délimitées.
Carl Wernicke en 1874, neurologue allemand, s’inscrit dans cette démarche
localisationniste et rapporte le cas d’un patient présentant une lésion du tiers
postérieur de la circonvolution temporale supérieure gauche. Contrairement aux
lésions frontales, les lésions temporo-pariétales ne provoquent pas un trouble de

Orthophoniste : BEN GOUIDER.S
2
l’expression verbale, mais un trouble massif de la compréhension. Opposée à
l’aphasie « motrice » de Broca, l’aphasie « sensorielle » de Wernicke se
caractérise par un langage fluide mais déformé par un manque de contrôle auditif
et par le fait que le patient ne comprend aucune production orale, ni la sienne ni
celle de ses interlocuteurs. Wernicke individualise ainsi un deuxième centre du
langage plus postérieur. Ce centre des « images sensorielles des mots » est situé
dans la première circonvolution temporale gauche. Deux centres distincts du
langage sont ainsi identifiés : un centre de la réception et un centre de l’émission.
Wernicke, Lichtheim et Dejerine en 1906 développeront leur réflexion vers une
théorie associationniste des centres d’images. Autour de chaque aire de
projection sensorielle et motrice existent des régions d’association. Une zone
antérieure située dans la région de l’aire de Broca est considérée comme le centre
des images articulatoires, et une zone postérieure englobe le centre des images
auditives et le centre des images visuelles des mots. Ces centres d’images des
mots (articulatoires, visuelles, auditives), sont reliés entre eux par des faisceaux
de fibres blanches sous-corticales.
Les débats seront vifs pendant cette période entre les partisans de différentes
théories sur les mécanismes cognitifs. Jackson en 1878, bien que contemporain
des premiers associationnistes, va développer une conception du langage et de
l’aphasie qui s’éloigne de la notion de centres et de connexions. Il relève le
contraste entre l’atteinte du langage propositionnel et le respect du langage
émotionnel et automatique. Pour lui, le langage doit être considéré comme
instrument de la pensée.
Bien plus tard, Goldstein en 1948, qui sera à la source de la conception
neuropragmatique du langage, remettra l’accent sur le déficit de la pensée
catégorielle et l’atteinte du langage intérieur. Le patient aphasique n’est pas un
homme dont seul le langage est modifié mais un homme modifié dans son
ensemble. Progressivement, l’activité langagière devient indissociable du

Orthophoniste : BEN GOUIDER.S
3
fonctionnement d’autres capacités cognitives et on s’interroge sur le rôle éventuel
de structures situées dans l’hémisphère non dominant. La théorie associationniste
insiste sur l’importance des « liens » intra-hémisphériques unissant les zones
cérébrales abritant les centres des images.
L’exploration du rôle des connexions interhémisphériques la fera naturellement
évoluer vers le courant connexionniste au XXe siècle de l’observation clinique et
lésionnelle de Broca aux essais de modélisation, tous les éléments qui animent
notre réflexion actuelle sur les mécanismes cognitifs sont présents.
2. Sémiologie et glossaire aphasiques
L’aphasie désigne l’ensemble des troubles de la communication par le langage
secondaires à des lésions cérébrales acquises entraînant une rupture du code
linguistique. Elle se manifeste par une altération à des degrés divers de
l’expression et/ ou de la compréhension dans les modalités orale et/ou écrite, et
survient suite à une lésion de l’hémisphère dominant pour le langage, en général
l’hémisphère gauche. Selon les aires lésées, et le type d’aphasie, les déficits
peuvent concerner différents niveaux de langage : lexical, sémantique,
phonologique, morphosyntaxique, pragmatique.
L’aphasie doit être différenciée :
- des troubles de la communication par la parole qui, s’ils peuvent être
présents dans certains tableaux aphasiques, relèvent spécifiquement
de troubles de la réalisation motrice du langage et non pas de troubles
linguistiques proprement dits ;
- des troubles dits supralinguistiques du discours, qui renvoient aux
déficits du langage et du discours, secondaires à l’altération d’autres
fonctions cognitives. Les troubles de la communication peuvent donc
se situer à trois niveaux différents (linguistique, supralinguistique et
de la parole) ;

Orthophoniste : BEN GOUIDER.S
4
- des troubles développementaux de la communication dans le cadre
de pathologies diverses comme une anomalie du développement
cérébral, une souffrance périnatale, des troubles sensoriels.
Elle se différencie des troubles acquis du langage et de la parole relevant d’une
pathologie psychiatrique. En ce sens, elle n’est pas un trouble de la mémoire ou
de la pensée tel qu’on peut les trouver dans les états confusionnels.
Le terme d’aphasie a été repris par Armand Trousseau, qui lui a donné son sens
contemporain en remplacement des étiquettes alalie ou aphémie. Elle regroupe
les termes sémiologiques les plus usuels en quatre registres distincts selon les
déficits : qu’ils désignent :
• les défauts de production des mots ou anomie
• les déformations ou déviations linguistiques
• les troubles de la fluence
• les troubles de la syntaxe
ANOMIE
Noyau du tableau symptomatologique de l’aphasie, l’anomie renvoie à la
difficulté à trouver les mots – trop communément appelée « manque du mot ». Ce
déficit peut être de sévérité variable et aller d’une difficulté à produire les mots
dans le cours du discours conversationnel jusqu’à l’incapacité à dénommer des
stimuli supposés connus à l’oral et/ou à l’écrit. Les manifestations cliniques du
manque du mot peuvent être de plusieurs types et renseignent sur la nature du
déficit :
- absence de réponse ou non-réponse, pauses et interruptions dans le décours
du discours et production de phrases inachevées
- déviations linguistiques, essentiellement de type substitution de mot

Orthophoniste : BEN GOUIDER.S
5
- recours aux conduites palliatives permettant de « compenser » le défaut
d’accès au lexique : périphrases, circonlocutions et recours aux gestes et
aux mimiques
- réduction ou absence d’informativité (selon le degré de sévérité de
l’atteinte) entraînant ainsi une réduction quantitative et qualitative de la
fluence.
Le manque du mot est souvent présent dans les affections neurologiques même
non aphasiques (intoxication médicamenteuse, pathologies
neurodégénératives…), mais également chez les sujets normaux en cas d’états
de fatigue par exemple ! L’anomie peut traduire des déficits divers et ainsi
correspondre soit à un déficit lexical (perte de la représentation de la forme des
mots), soit à un déficit sémantique.
DEFORMATIONS OU DEVIATIONS LINGUISTIQUES
- Déviations orales ou paraphasies
Déviations phonétiques :
Elles correspondent à la modification d’un mot ou syntagme par
déformation phonétique d’un ou plusieurs de ses phonèmes. Il s’agit
d’une atteinte de la réalisation articulatoire, avec pour conséquences
des troubles articulatoires ou arthriques. Selon le degré de sévérité,
le patient peut produire des phonèmes n’appartenant plus au registre
de la langue du fait de phénomènes d’assourdissement, nasalisation,
occlusions, pseudo-diphtongaisons, élisions de groupes
consonantiques complexes, etc. Les déviations phonétiques ne sont
pas des paraphasies. Elles sont difficilement transcriptibles : le
recours à l’alphabet international est nécessaire.
Paraphasies phonémiques ou littérales :
 6
6
 7
7
 8
8
 9
9
 10
10
 11
11
 12
12
 13
13
1
/
13
100%