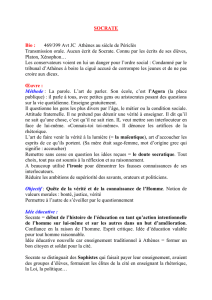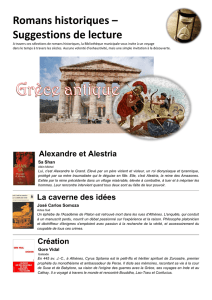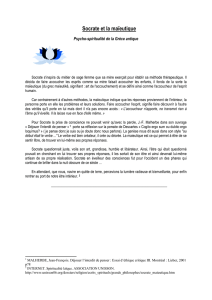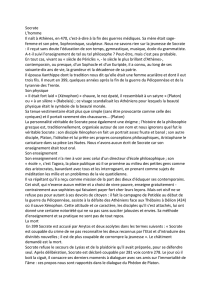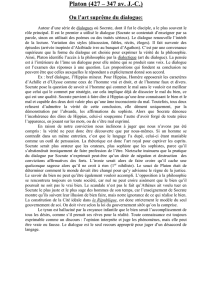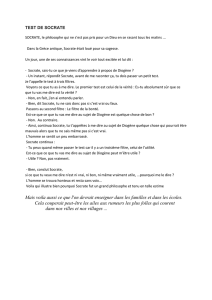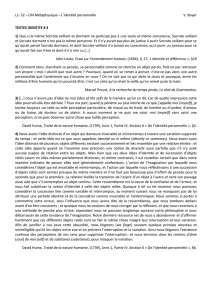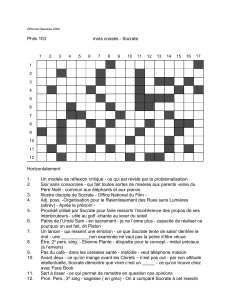INTRODUCTION
I.
PREMIERE LECTURE CURSIVE
Divisions
1)
du texte
Le procès athénien (agôn) : quelques données juridiques
2)
Les acteurs du procès
3)
SOCRATE ET PLATON
II.
STRUCTURE ET ENJEUX DU TEXTE
III.
LES ACCUSATIONS MODERNES (24B
-
A) ET LA
28
REFUTATION DE MELETOS
La corruption de la jeunesse (24b
1)
-
25
)
c
2)
La corruption de la Cité (25c
-
)
26
a
3)
L’introduction de nouveaux dieux dans la Cité (26b
-
28
a
)
IV.
POURQUOI CONDAMNER SOCRATE ?
V.
LES ACCUSATIONS ANCIENNES
VI.
L'ORACLE SUR SOCRATE ET COMMENT SOCRATE
L'ANALYSE
VII.
LA VIE DE SOCRATE ENTENDUE COMME MISSIO
N DIVINE
VIII.
VALEUR DE CETTE NARRATION DANS LE CADRE GENERAL
DE LA DEFENSE
CONCLUSION

inTRODUCTION
On peut dire sans exagération que l'Apologie de Socrate constitue l'œuvre inaugurale de la
philosophie occidentale. A lire ce texte, les philosophes ou les apprentis philosophes remonte
à la source originelle de leur discipline, le compte-rendu du procès intenté par Mélétos et deux
autres citoyens d'Athènes, contre Socrate en 399 avant J.-C. Cette affaire judiciaire constitue
pour nous l'un des deux événements fondateurs de la civilisation occidentale (l'autre étant la
crucifixion de Jésus - une lecture des Evangiles sera bientôt proposée sur le blog) : aussi,
devant ce texte, nous, les philosophes, ressentons à bien des égards une émotion de respect et
de sacré similaire à celle qu'un touriste peut ressentir devant l'entrée du temple d'Abou Simbel
(ci-contre). Pourtant, ce procès pouvait paraître, de prime abord, anecdotique : un vieil
excentrique, peut-être un peu pervers, est
I. PREMIERE LECTURE CURSIVE
A l'exception de quelques mots énoncés par Mélétos lors du contre-interrogatoire (24d-27d) et
du brouhaha dans le prétoire mentionné épisodiquement (par exemple 30c), Socrate parle
seul. Ce très long monologue constitue, le lecteur en est averti dès la première phrase, une
défense judiciaire dans un procès. Que dit l'accusé pour se défendre ?
1) Divisions du texte
Deux phrases permettent de découper le texte en trois parties d'inégale longueur. Pendant tout
le début du texte, Socrate nie être coupable des accusations portées contre lui. En 35e,
cependant, il fait tout à coup mention d'un "jugement" que les Athéniens viennent de rendre ;
à partir de ce moment, il tient sa condamnation pour acquise et plaide, cette fois, non plus
pour prouver son innocence, mais pour une peine alternative à la sentence de mort réclamée
par les accusateurs. En 38c, enfin, nouveau changement de thème : "Pour n'avoir pas eu la
patience d'attendre un peu [...] vous avez fait mourir Socrate." L'accusé porte un ultime regard
sur le procès qui vient de s'achever et en tire les leçons.
On comprend que, dans un premier affrontement, l'accusation et la défense visent à
déterminer la culpabilité ou l'innocence du prévenu (comme aujourd'hui en France,
l'accusation parle d'abord, puis la défense) ; les juges se prononcent une première fois à ce
stade ; l'accusé reconnu coupable, un second affrontement cherche à déterminer la peine
applicable : à la sentence réclamée par l'accusation, le prévenu répond par une sentence
alternative. Une nouvelle fois, les juges se prononcent. A tous points de vue juridiques, la
procédure pénale proprement dite s'interrompt à la fin de la page 38b, après ce second vote

des juges : les derniers mots de Socrate se présentent comme une péroraison extrajudiciaire.
Cette procédure athénienne diffère sensiblement de la procédure pénale applicable aujourd'hui
en France ; aussi mérite-t-elle quelques précisions.
2) Le procès athénien (agôn) : quelques données juridiques
"Il n'aurait fallu que trois voix de plus pour que je fusse absous" déclare Socrate au moment
où il apprend que les juges l'ont reconnu coupable (36a). Cette traduction paraît extrêmement
contestable d'autant qu'elle porte sur un moment capital du procès : les traductions plus
récentes (notamment celle de Luc Brisson, chez Garnier-Flammarion) évoquent plutôt trente
voix que trois.
Trente voix, et Socrate parle d'une "faible majorité" : combien de juges siègent donc dans
cette affaire ? Les recherches historiques permettent de retenir le chiffre de cinq cents
magistrats (Socrate aurait donc été condamné par deux cent quatre-vingt voix contre deux
cent vingt). Qui sont ces juges ? De simples citoyens volontaires, âgés d'au moins trente ans.
Leur rémunération s'établit, nous apprend Aristophane dans les Cavaliers, à trois oboles par
journée d'audience, soit le salaire d'une demi-journée de travail d'un ouvrier. Cette faible
somme ne pouvait convenir qu'à des citoyens âgés, pour qui elle correspondait à une pension
de retraite, ou à des jeunes gens désœuvrés ou inaptes au travail. Le coût pour l'administration
athénienne n'en est pas moins considérable : ce procès revient à payer une journée de travail à
deux cents cinquante ouvriers.
On n'aurait pas déployé pas un tel appareil, ni engagé de telles dépenses, pour une affaire
secondaire. Très grave, le procès de Socrate intéresse toute la Cité : c'est une affaire d'Etat.
Les juges, d'ailleurs, s'engagent sous serment formel à "voter conformément aux lois et aux
décrets du peuple athénien" explique Démosthène dans son Contre Timocratie (Socrate fait
allusion à ce serment en 35c). Cette gravité manifeste n'empêche cependant pas une procédure
menée tambour battant : l'ensemble des débats devait être bouclé dans la journée (Socrate
regrette d'ailleurs cette précipitation à de nombreuses reprises, par exemple en 19a, 24a et
37b).
Chaque partie doit, du fait de cette brièveté, s'empresser de réfuter les allégations de
l'adversaire. Le litige ne peut se résoudre qu’à l’avantage du plaideur capable de produire des
preuves rapidement convaincantes - surtout des vraisemblances et des témoins. Pourtant, il
convient de le remarquer tout de suite, Socrate recourt bien plus au raisonnement qu'aux
simples vraisemblances et surtout, il n’appelle aucun témoin à la barre : il se contente de
mentionner des gens qui pourraient déposer en sa faveur (notamment 32e et 34a). Curieux

accusé que ce Socrate : il paraît ignorer les ressorts de la procédure, alors qu'il joue sa tête ! Il
commence même sa première plaidoirie (17c) en annonçant qu'il n'emploiera pas les "artifices
du langage" mais au contraire qu'il utilisera "les termes qui se présenteront [à lui] les
premiers" - "des choses dites à l'improviste" traduit Luc Brisson. Dans une affaire d'Etat, une
telle légèreté scandalise.
3) Les acteurs du procès
L'acte d'accusation est soutenu conjointement par trois citoyens, Lycon, Mélétos et Anytos.
Des trois, Lycon est le moins connu (et son identification historique prête à controverses).
Mélétos, qui a déposé officiellement la plainte, semble avoir été un poète (du moins Socrate
l'indique-t-il 24a). La majorité des commentateurs désignent Anytos comme l'instigateur du
procès. Démocrate notoire, il avait apporté son soutien à Thrasybule lors de la révolte contre
la Tyrannie des Trente en 403 (voir cours n°4, Socrate et la Cité). En 399, Anytos était
probablement considéré comme un héros national ; en tous cas, il devait s'agir d'un
personnage influent.
Quant à Socrate, à soixante-dix ans, il n’a jamais comparu devant un Tribunal (17d), bien que
les procès n'aient pas été rares à Athènes. Il s'agit donc d'un citoyen discret, d'un ancien
combattant (28d-e) qui ne se mêle pas des affaires publiques (31c). Quel métier exerce-t-il ?
Aucun. A quoi passe-t-il donc ses journées ? Il les consacre à "persuader" tout le monde
"qu'avant le soin du corps et des richesses, avant tout autre soin, est celui de l'âme et de son
perfectionnement." (30a-b). Aussi s'emploie-t-il à examiner avec d'autres citoyens des notions
morales : une de ces discussions est ainsi rapportée par Platon dans un dialogue, le Lâchés,
lequel voit Socrate aux prises avec le célèbre général athénien Lâchés. Lors de cette
discussion, les protagonistes tentent de définir le courage. Lâchés, pourtant bien placé pour
savoir ce que désigne ce mot, propose plusieurs définitions successives qui, toutes, sont
détruites par les questions de Socrate et les distinctions conceptuelles qu'elles entraînent. Le
dialogue s'achève sur un échec : les interlocuteurs se quittent sans avoir réussi à apporter une
définition satisfaisante.
Les arguments du vieillard frappent l’entourage ; mais, bien conscient de la charge subversive
de ses débats (prouver à un général qu'il ignore ce que signifie le mot "courage" paraît assez
inconvenant), Socrate, prudent, n’a jamais rien écrit. On ne le connaît que par l’intermédiaire
d'une comédie d’Aristophane (Les Nuées), et par les travaux de deux de ses élèves :
Xénophon (dans les Mémorables) et surtout Platon. Dans la mesure où ce fidèle disciple tient
la plume, on peut interroger l'impartialité du rapport d'audience présenté dans l'Apologie de
Socrate.

II. SOCRATE ET PLATON
Platon ne cache pas son admiration pour Socrate (qui le détermina à la philosophie plutôt qu’à
la dramaturgie) : Socrate est d'ailleurs le personnage central des dialogues de Platon, ses
œuvres principales dont l'Apologie fait partie ; pourtant, Socrate nie être un maître (23c et
33a). L'enjeu de ce point, essentiel, sera examiné dans le cours n°2 (L'accusation contre
Socrate et sa défense). À cela deux raisons : d'une part il ne fait jamais payer son
enseignement (19d-e, 33a-b) et d'autre part, il ne dispose d’aucun savoir positif, d’aucune
doctrine, qu’il serait susceptible d’enseigner (19d, et surtout 20b). Il insiste : "Moi qui ne sais
rien, je ne vais pas m'imaginer que je sais quelque chose." (21d) - phrase qui a souvent été
reformulée par les commentateurs : "Tout ce que je sais, c'est que je ne sais rien." Puisque
Socrate n'est le maître de personne, il paraît injuste de qualifier Platon "d'élève" de
Socrate ; mais s'il ne propose aucune doctrine positive (à la différence d'Anaxagore ou de
Gorgias, par exemple), il n'en jouit pas moins d'une énorme influence sur la jeunesse (même
si, précise-t-il, ces jeunes gens le suivent librement : 23c). Nombre de jeunes gens surmontent
la répulsion que leur inspire la laideur de Socrate (Alcibiade, dans le Banquet, compare les
traits de Socrate à ceux d'un satyre), et sont séduits par sa manière impertinente d'interroger
des citoyens respectables. Tel fut le cas d'Alcibiade, mais aussi de Charmide (voir le
Charmide) et d'Agathon (voir Le Banquet). Dans l'Apologie elle-même, trois jeunes gens
(Critobule, Apollodore et... Platon lui-même) se portent au secours de Socrate pour se porter
garantie d'une amende (38b).
Le compte-rendu d'un tel "fan" peut-il être considéré comme fidèle ? Le fait que Platon se
mentionne lui-même seulement trois fois dans l'ensemble des dialogues socratiques (38b,
donc, mais aussi 34a - également dans l'Apologie et enfin dans le Phédon 59b) contribue à un
effet de réel : il semble bien avoir été présent au procès de Socrate. Par ailleurs, la
composition de l'Apologie (probablement entre 390 et 385 av. J.-C.) semble avoir eu lieu
entre dix et quinze ans après le procès, soit à une époque où plusieurs citoyens athéniens
ayant eux-mêmes assisté au procès vivaient encore. On peut donc considérer le texte de
Platon comme relativement fiable - même si certaines questions alimentent des controverses :
par exemple, l'enseignement sur la mort qui clôt le dialogue doit peut-être plus à la plume de
Platon qu'aux paroles de Socrate.
III. STRUCTURE ET ENJEUX DU TEXTE
 6
6
 7
7
 8
8
 9
9
 10
10
 11
11
 12
12
 13
13
 14
14
 15
15
 16
16
 17
17
1
/
17
100%