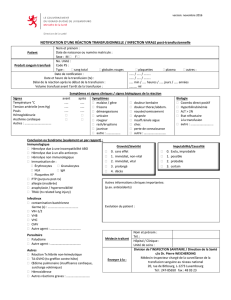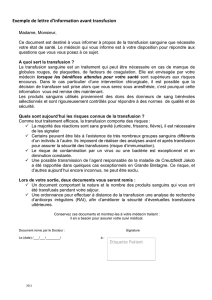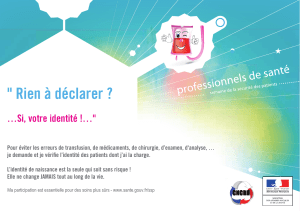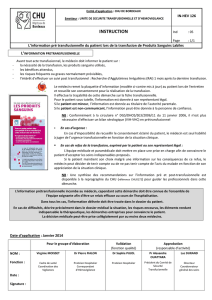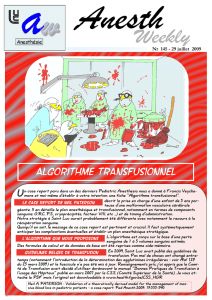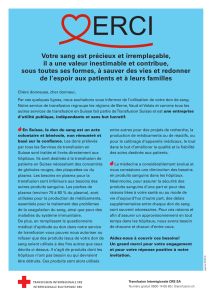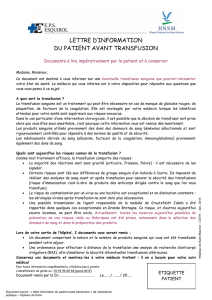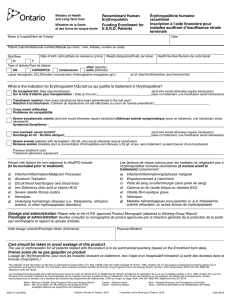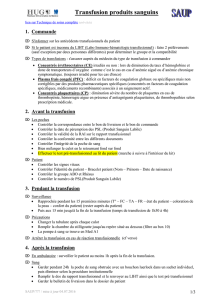Transfusion érythrocytaire en urgence

TRANSFUSION ÉRYTHROCYTAIRE EN URGENCE
Bruno Riou
Service d’Accueil des Urgences, CHU Pitié-Salpêtrière, Assistance Publique-
Hôpitaux de Paris, Université Pierre et Marie Curie, 81 Boulevard de l’Hôpital,
75651 Paris cedex 13. [email protected]
INTRODUCTION
La transfusion érythrocytaire est une pratique relativement peu fréquente
dans la prise en charge de l’ensemble des urgences. Toutefois, elle devient
fréquente si l’on considère les urgences lourdes, en particulier celles qui sont
liées à la traumatologie ou à des pathologies ciblées comme les hémorragies
digestives. Il convient de faire en préambule deux remarques importantes.
Premièrement, la majorité des transfusions effectuées « en urgence » ne se
distingue pas vraiment de la transfusion courante et l’ensemble des recom-
mandations de ce texte s’applique sans que le contexte de l’urgence n’apporte
de spécificité majeure. Le texte présenté ici se limite donc aux situations où
le contexte de l’urgence est susceptible de modifier de manière substantielle
les recommandations. Deuxièmement, la littérature sur ce domaine est assez
pauvre et en général d’un niveau de preuve médiocre.
1. DESCRIPTION DES SITUATIONS CLINIQUES CONCERNÉES
1.1. EPIDÉMIOLOGIE
La transfusion en urgence concerne surtout les traumatisés graves, les
hémorragies digestives, les hémorragies obstétricales, et les ruptures d’ané-
vrysme aortique. Les autres causes notamment médicales sont plus rares.
Toutefois, il faut souligner la pauvreté des données épidémiologiques disponibles,
notamment en traumatologie. L’incidence de la transfusion sanguine chez les
traumatisés varie entre 5 et 15 % suivant les critères de sélection de gravité
des études. Ainsi, dans un centre d’accueil de traumatisés graves recevant
uniquement des patients via le SAMU, cette incidence est de 45 %, mais seu-
lement 25 % ont bénéficié d’une transfusion importante (> 6 unités). Très peu
d’études ont tenté de définir des facteurs prédictifs du recours à la transfusion
en traumatologie, aucune en ce qui concerne la transfusion massive. Or il s’agit

MAPAR 2005
342
d’éléments importants pour l’orientation préhospitalière des traumatisés graves
et il s’agira d’éléments cruciaux pour le recours à des thérapeutiques limitant le
saignement, par exemple le facteur VII activé [1]. Les rares études disponibles
sur ce sujet se sont limitées à des données très simples (prehospital index) du
fait de l’absence de médicalisation préhospitalière dans les pays où elles ont
été conduites.
La transfusion sanguine est un facteur indépendant du pronostic en traumato-
logie, que ce soit chez l’adulte [2] ou chez l’enfant [3]. La transfusion sanguine est
un facteur prédictif du développement de syndrome de défaillance multiviscérale
(SDMV) en traumatologie [4]. On doit regretter l’absence d’étude bien conduite
sur le plan méthodologique pour préciser la relation entre le saignement (et donc
la transfusion) et le développement d’une réaction inflammatoire (SIRS), d’un
syndrome de détresse respiratoire aiguë (SDRA), et d’un SDMV.
Le pronostic des chocs hémorragiques, en particulier en traumatologie, s’est
amélioré ces dernières années [5]. Parmi les facteurs allégués pour cette amé-
lioration, il convient de citer l’amélioration des techniques de réchauffement,
des techniques d’hémostase notamment chirurgicale (« damage control ») et
de radiologie interventionnelle, l’amélioration du traitement des coagulopathies,
et l’amélioration des procédures de délivrance du sang. Ainsi Cinat et al. [5], ont
observé une diminution de mortalité (16 vs 45 %) chez les traumatisés néces-
sitant plus de 50 unités de sang entre les périodes de 1988 à 1992 et de 1993
à 1997. La plupart des équipes considèrent que la quantité de sang transfusé
n’est pas en soi un critère valable d’arrêt de la réanimation, notamment en trau-
matologie [6]. De nombreux arguments cliniques laissent penser que la rapidité
de correction du choc hémorragique et par conséquent de la transfusion influe
favorablement sur le pronostic [7].
En obstétrique, l’hémorragie du post-partum est la première cause de
mortalité maternelle en France, responsable d’un tiers des décès [8]. L’incidence
de la transfusion en péripartum est faible, estimée à 1 à 2,5 % des accouche-
ments par voie basse et 3 à 5 % des accouchements par césariennes. Surtout,
il s’agit d’une hémorragie imprévisible puisque survenant dans 84 % des cas
chez des femmes sans facteur de risque particulier (placenta prævia, hématome
rétroplacentaire, multiparité) [9].
1.2. DÉFINITION DU DEGRÉ D’URGENCE
Afin de hiérarchiser les situations d’urgences, plusieurs textes de recomman-
dations font la distinction entre les urgences vitales immédiates, les urgences
vitales, et les urgences relatives [9, 10]. Cette distinction permet au médecin,
confronté à la situation d’urgence et prescripteur de la transfusion sanguine, de
parler un langage commun avec le médecin du site transfusionnel. Ces distinc-
tions sont également associées à des délais de délivrance des produits sanguins
dont certains font l’objet d’impératifs de nature réglementaire.
2. PROBLÈMES SPÉCIFIQUES DE L’URGENCE
2.1. SÉCURITÉ
Du fait de l’urgence de la transfusion sanguine dans certaines situations
cliniques, il y a un risque que des verrous de sécurité soient volontairement
supprimés par les acteurs de la transfusion. Il s’agit surtout de la vérification
du groupage du receveur au lit du patient, de l’envoi de deux groupes sanguins

Transfusion 343
prélevés sur le receveur par deux intervenants à deux moments différents, et
enfin de la vérification de chaque concentré érythrocytaire. Il est important de
rappeler à l’ensemble des acteurs de la transfusion que l’urgence augmente le
risque d’erreur transfusionnelle du fait même de ces comportements et que
rien ne les justifie. En revanche certaines recommandations peuvent diminuer
la tentation de se comporter ainsi :
• La mise en place rapide d’un cathéter artériel, de préférence par voie fémo-
rale en cas d’instabilité hémodynamique permet de faciliter les prélèvements
sanguins et donc de limiter la pratique illicite du prélèvement simultané
des deux tubes pour groupage sanguin par le même intervenant au même
moment [11].
• La pratique d’un prélèvement sanguin dés le début d’un remplissage vasculaire
rapide, et donc avant une dilution majeure, facilite la détermination du groupe
du patient, notamment lors du test ultime de compatibilité.
Enfin, il convient de rappeler qu’il est toujours possible de transfuser un patient
sans groupage transfusionnel, en obtenant du site transfusionnel des concentrés
érythrocytaires de groupe O. C’est d’ailleurs ce que font quotidiennement les
centres d’accueil des polytraumatisés à partir de leur dépôt de sang. Cette trans-
fusion se fait alors sous l’entière responsabilité du médecin qui transfuse et ne
dispense pas, bien entendu, d’un test de compatibilité ultime au lit du patient.
2.2. MÉTHODE DE MESURE DE L’ ANÉMIE
La nécessité d’une décision rapide de transfusion fait que celle-ci doit être
souvent prise à partir d’une mesure d’hémoglobine faite sur site par des appa-
reils de biologie délocalisée (Hémocue®) dont la précision de mesure, bien que
satisfaisante, est inférieure à celle du laboratoire (biais 0,6 g.dl-1 ou 5,4 %) [12].
Il convient donc de faire un choix entre rapidité (2 min vs au moins 30 min) et
précision. Le prélèvement artériel est plus fiable que le prélèvement capillaire
pour l’Hémocue®. L’utilisation de microhématocrites n’est pas recommandée en
raison d’une exposition plus importante du personnel au sang et de la possibilité
d’erreurs de grande amplitude par fuite du microcapillaire.
2.3. SEUIL TRANSFUSIONNEL
Les seuils transfusionnels (entre 7 et 10 g.dl-1 d’hémoglobinémie selon la
situation clinique) généralement proposés s’appliquent également aux situations
d’urgence [10]. Toutefois, deux facteurs liés à l’urgence sont susceptibles de
modifier profondément ces seuils transfusionnels. La nécessité d’anticiper et
l’hémostase. Enfin, la nécessité de raisonner en termes de circulation régionale
(cérébrale) est particulière aux traumatisés crâniens sévères.
Dans une situation de transfusion rapide avec poursuite du saignement, la
notion de seuil transfusionnel perd de sa force du fait du caractère dynamique
de la situation et des délais inévitables entre la valeur du taux d’hémoglobine
instantané, l’obtention de l’information sur ce taux, la décision de transfuser,
et la réalisation de la transfusion. Le médecin doit anticiper et donc accepter la
possibilité de dépasser le seuil transfusionnel s’il ne veut pas se retrouver dans
une situation d’anémie et/ou d’hypovolémie menaçante.
Les érythrocytes jouent un rôle important dans l’hémostase. Ils facilitent
l’agrégation plaquettaire et ils augmentent la probabilité d’interaction des
plaquettes avec la surface vasculaire. Sur des modèles expérimentaux in vitro,
la diminution de l’hématocrite s’accompagne d’une diminution de la surface

MAPAR 2005
344
vasculaire couverte par du thrombus [13]. Ceci a été récemment confirmé chez
l’animal in vivo [14]. Chez l’homme, on ne dispose que de preuves indirectes.
Par ailleurs, une corrélation entre les troubles de l’hémostase et l’aggravation
des lésions hémorragiques intra-cérébrales d’origine traumatique a été mise en
évidence [15]. Il paraît donc licite de considérer que la valeur de l’hématocrite/
hémoglobine (seuil transfusionnel) souhaitée en traumatologie doit prendre
en compte, non seulement les critères habituels liés au transport d’oxygène,
mais également son rôle dans l’hémostase. Toutefois, il faut souligner que ce
raisonnement ne s’applique pas à l’ensemble des situations de traumatologie,
mais à celles où l’hémostase constitue une préoccupation majeure et où le
saignement n’est pas accessible à une sanction chirurgicale et/ou de radiologie
interventionnelle. Il s’agit en pratique des traumatismes crânio-cérébraux sé-
vères, des hématomes rétro péritonéaux (saignement d’origine veineuse, non
embolisable), et des traumatismes hépatiques graves. Dans ces situations, un
seuil transfusionnel élevé est probablement à recommander. Néanmoins, il faut
souligner qu’aucun travail n’a cherché à déterminer le seuil optimal dans ces
situations avec comme objectif d’optimiser l’hémostase. La plupart des équipes
appliquent dans ces situations cliniques un seuil de l’ordre de 9 à 10 g.dl-1 de
manière empirique.
L’anémie sévère fait partie des causes d’agressions cérébrales secondaires
d’origine systémique (ACSOS) des traumatismes crâniens sévères. En effet,
l’anémie sévère contribue à l’hypoxie tissulaire dont on sait qu’elle potentialise
la défaillance énergétique cérébrale post-traumatique et précipite l’apparition
de l’œdème intra-cellulaire. L’anémie diminue le transport d’oxygène ce qui
induit une augmentation du débit sanguin cérébral similaire à celle observée
lors d’une diminution hypoxique du transport d’oxygène. Cependant, lors de
l’anémie, l’augmentation du débit sanguin cérébral n’est pas seulement due à
la vasodilatation par autorégulation mais aussi à une diminution des résistances
visqueuses. Ces deux facteurs adaptatifs ont des influences opposées sur le
volume sanguin cérébral et donc la pression intracrânienne (PIC). La vasodilata-
tion augmente le volume sanguin cérébral et la PIC, notamment lorsqu’il existe
une hypertension intracrânienne [16]. La diminution des résistances visqueuses
de son côté provoque une vasoconstriction des gros troncs et diminue la PIC
notamment en cas d’hypertension intracrânienne. La correction de l’anémie fait
donc partie de la réanimation des patients ayant un traumatisme crânien sévère.
Le seuil transfusionnel classique (7 à 8 g.dl-1) nécessite d’être relevé chez certains
patients ayant un traumatisme crânien sévère. Toutefois, l’anémie est rarement
responsable isolément d’une souffrance cérébrale. En pratique, il convient de
réserver l’augmentation du seuil transfusionnel aux patients dont la PIC reste
élevée et la saturation veineuse jugulaire en oxygène (SjO2) basse, malgré un
traitement conventionnel approprié. La plupart des équipes recommandent un
seuil de 9 voire 10 g.dl-1 dans ces conditions, mais il convient de reconnaître
qu’aucun travail n’a démontré la pertinence clinique en terme pronostique de
ces recommandations. Ce point n’a d’ailleurs pas été abordé dans les récentes
recommandations pour la pratique clinique [17]. Enfin, là encore, l’anticipation
peut amener le clinicien à transfuser précocement un traumatisé crânien sévère
sur des critères incomplets.
Il n’est pas impossible que des études randomisées bien conduites condui-
sent à une politique plus restrictive de transfusion sanguine chez les traumatisés

Transfusion 345
crâniens comme cela a été démontré dans d’autres circonstances cliniques. Cette
hypothèse mérite d’être testée. En ce qui concerne les hémorragies digestives,
il faut également souligner l’absence de données permettant de recommander
un éventuel seuil transfusionnel.
2.4. CHOIX DU GROUPE TRANSFUSÉ (ANNEXE 1)
La plupart des recommandations suivantes sont de nature réglementaire.
Dans le cadre des urgences vitales immédiates et des urgences vitales, la distri-
bution doit être effectuée sans délai, éventuellement sans groupe sanguin et sans
recherche d’agglutinines irrégulières (RAI) : sang O RH :-1, KEL :-1, voire sang
O RH :1 (si possible RH :-3,-4), KEL :-1 et dépourvu d’hémolysine. En présence
de données valides d’immuno-hématologie, il est recommandé de distribuer du
sang KEL :-1 dans tous les cas, RH :-1 si le phénotype du patient est RH :-1, et
RH :1,-3,-4 si le phénotype du patient est RH :1 [10]. La distribution de sang doit
être réalisée avec des produits dont la qualification est la plus proche possible
du phénotype érythrocytaire du patient tout en tenant compte en priorité :
• Des patients de sexe féminin en âge de procréer.
• De la présence d’allo-anticorps anti-érythrocytaires.
• De la possibilité de transfusion ultérieure et de l’espérance de vie raisonna-
ble [10].
Dans le cadre des urgences relatives, l’ensemble des examens immuno-
hématologiques peut être réalisé, avec toutefois, la possibilité de requalifier le
degré d’urgence à tout moment en fonction de la situation clinique [10].
Lorsque les procédures prévues sont respectées, la transfusion de sang de
groupe O en l’absence de données immuno-hématologiques est sûre, notam-
ment en traumatologie [18].
2.4. DÉPÔTS DE SANG
Il est demandé aux établissements de santé et aux sites transfusionnels
de s’organiser pour définir les modalités à mettre en place pour répondre au
mieux à l’urgence transfusionnelle [19]. Ceci suppose d’avoir défini le maillage
régional entre services d’urgence et sites transfusionnels pour pouvoir dispo-
ser de concentrés érythrocytaires dans un délai inférieur ou égal à 30 min [10],
notamment pour les urgences obstétricales [9, 20]. Trois solutions sont possibles
pour satisfaire cet objectif :
• Présence d’un site transfusionnel de l’Etablissement Français du Sang (EFS)
à proximité.
• Organisation d’un dépôt de sang ayant une autorisation d’attribution dans
l’établissement de santé.
• Organisation d’un dépôt d’urgence vitale autorisé dans l’établissement de
santé [10]. Toutefois, le nombre de dépôts d’urgence vitale doit être réduit à
son strict minimum et le stock doit être volontairement réduit. Son but est en
effet d’assurer la survie pendant le temps d’acheminement des autres pro-
duits sanguins. Il est conseillé qu’il ne soit constitué que de deux concentrés
érythrocytaires 0 RH :-1,-2,-3 KEL :-1 et de deux concentrés O RH :1,2,-3,-4,5
KEL :-1 [10]. Certains établissements de santé ont créé des dépôts d’urgence
vitale alors qu’il existe un site transfusionnel de l’EFS en leur sein. Il s’agit de
situations exceptionnelles correspondant à l’accueil fréquent d’urgence vitale
immédiate (centre d’accueil des polytraumatisés) associés à des situations
d’éloignement du site transfusionnel. Pour toutes les maternités, il est recom-
 6
6
 7
7
 8
8
 9
9
 10
10
1
/
10
100%