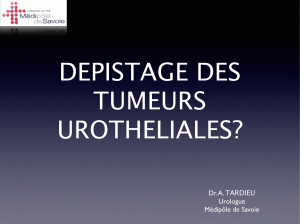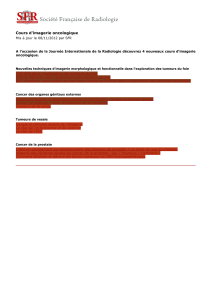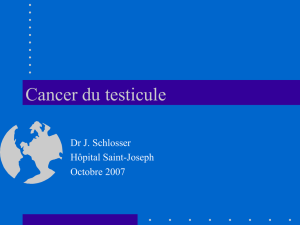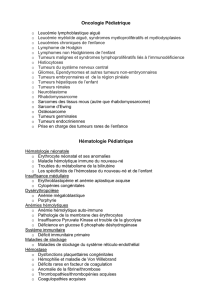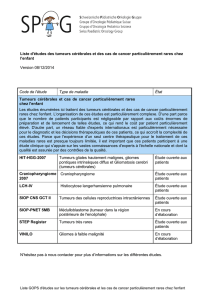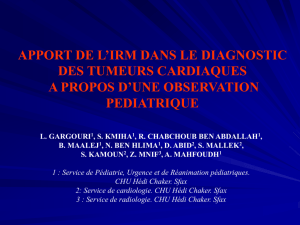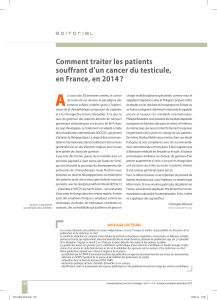Tumeurs cranio-encéphaliques de la ligne médiane : Revue IRM
Telechargé par
garmanehamid

J Radiol 2006;87:764-78
© Éditions Françaises de Radiologie, Paris, 2006
formation médicale continue
Le point sur…
Tumeurs cranio-encéphaliques de la ligne médiane
C Delmaire (1), JY Gauvrit (1), El Hajj (1), G Soto Ares (1), M Ayachi (1), N Reyns (2), F Dubois (2) et JP Pruvo (1)
es tumeurs de la ligne médiane sont rares. La grande di-
versité des tumeurs rencontrées rend le diagnostic diffi-
cile. De même, leur localisation profonde et médiane
rend le traitement compliqué. Bien que les données de l’ima-
gerie soient peu spécifiques, elles permettent d’évoquer cer-
tains diagnostics, de préciser les rapports anatomiques, de
participer à la caractérisation tissulaire de certaines lésions,
même si celle-ci repose toujours sur l’examen anatomopatho-
logique, de guider les biopsies chirurgicales en condition sté-
réotaxique et de réaliser la surveillance post-thérapeutique.
Même si ces lésions sont rares, il est important de connaître les
caractéristiques IRM des tumeurs trigono-septales, de la faux
du cerveau, du troisième ventricule, de la région épiphysaire,
ainsi que celles des tumeurs incisurales postérieures. Les
autres tumeurs de la ligne médiane de l’encéphale comme les
tumeurs de la région sellaire et les tumeurs de la fosse posté-
rieure ne seront pas développées.
Place de l’imagerie
L’IRM est l’examen de choix pour l’exploration et le suivi post-
thérapeutique de ces lésions. Elle permet, grâce à sa résolution
spatiale, son contraste et la possibilité d’effectuer des coupes dans
les différents plans de l’espace, de localiser avec précision le pro-
cessus expansif et d’apporter des arguments parfois suffisants
pour caractériser la lésion sur le plan tissulaire.
L’examen doit comporter au minimum une série de coupes dans
le plan sagittal pondérées en T1 sans injection, puis après injec-
tion de chélates de Gadolinium dans les trois plans de l’espace ;
l’imagerie pondérée en T2 et FLAIR est d’une aide précieuse
dans la caractérisation tissulaire et dans la distinction entre la tu-
meur et l’œdème. L’imagerie de flux artériel et veineux permet
d’éviter l’artériographie cérébrale et d’étudier de façon non inva-
sive les artères de la face médiale des hémisphères et le système
veineux profond (veines thalamo-striées, veines cérébrales inter-
nes, veines basales, grande veine de Galien et sinus sagittal infé-
rieur). Des études récentes ont montré l’intérêt de l’imagerie de
diffusion pour différencier certaines lésions kystiques (1-2).
L’étude du liquide cérébrospinal (LCS) est possible grâce à l’IRM
de flux par contraste de phase synchronisée sur les battements
cardiaques. La mesure des flux du LCS apporte un complément
diagnostique sur le dysfonctionnement de la dynamique intra-
crânienne engendré par ces tumeurs médianes.
L’IRM permet d’évaluer les répercussions locorégionales de ces
tumeurs, et en particulier, l’apparition d’une hydrocéphalie. Elle
étudie son importance et son évolutivité, en recherchant des si-
gnes de résorption transépendymaire du LCS et des anomalies de
sa dynamique. Le caractère actif de l’hydrocéphalie conduira à
une dérivation ventriculaire. Les séquences sagittales ou corona-
les T2 apportent des renseignements souvent suffisants sur la
circulation du LCS dans les foramens interventriculaires et
l’aqueduc de Sylvius. En effet, un artefact de flux en hyposignal
sur les séquences en pondération T2 élimine une obstruction à
l’écoulement du LCS. L’IRM présente un très grand intérêt dans
le repérage des biopsies en condition stéréotaxique et aide à pré-
ciser la voie d’abord chirurgicale (sous-frontale, inter-thalamo-
trigonale, intraventriculaire, sous-tentorielle).
Enfin, cet examen permettra le suivi post-thérapeutique en
détectant des récidives et en évaluant le bénéfice, ainsi que les
complications des traitements. Le scanner cérébral reste indiqué
en cas de contre-indications à l’IRM.
Abstract Résumé
Midline tumors of the central nervous system.
J Radiol 2006;87:764-78
The anatomy of the supratentoriel midline structures of the brain is
complex: corpus callosum, third ventricle, trigone, choroid plexus, pineal
gland, falx cerebri. Different types of tumors can arise from these struc-
tures including tumors of the trigone and septum, tumors of the falx,
third ventricular tumors and pinal region tumors. These tumors share
similar features: minimal clinical symptoms despite their occasional large
size, mild non-specific intracranial hypertension syndrome, value of MRI
for depiction of tumor location, stereotactic biopsy, relative difficulty of
surgical management.
La grande variété des structures médianes de l’encéphale à l’étage sus-
tentoriel, tel le trigone, le corps calleux, le troisième ventricule, la toile
choroïdienne, la faux du cerveau et l’épiphyse, en fait une région
anatomique particulière. Ces structures peuvent être à l’origine de
tumeurs diverses comme les tumeurs trigono-septales, les tumeurs
moyennes de la faux du cerveau, les tumeurs du troisième ventricule,
les tumeurs de la région épiphysaire et les tumeurs incisurales posté-
rieures. Ces lésions présentent des points communs : la discrétion des
signes cliniques en discordance avec le volume parfois important des
lésions, ou un syndrome d’hypertension intracrânienne inaugural,
mais peu spécifique ; l’intérêt de l’imagerie par résonance magné-
tique (IRM) permettant une analyse topographique particulièrement
informative ; une indication des biopsies en conditions stéréo-
taxiques ; une difficulté relative des traitements chirurgicaux.
Key words: Brain neoplasms, diagnosis. Corpus callosum. Pineal body,
neoplasms. Brain ventricles. Meninges, neoplasms. MRI.
Mots-clés : Encéphale, tumeur. IRM. Épiphyse. Corps calleux.
Méninge. Ventricule.
L
(1) Service de Neuroradiologie et (2) Service de Neurochirurgie, Hôpital Roger Salengro,
boulevard du Professeur Laine, 59800 Lille.
Correspondance : C Delmaire
© 2017 Elsevier Masson SAS. Tous droits réservés. - Document téléchargé le 11/11/2017 Il est interdit et illégal de diffuser ce document.

J Radiol 2006;87
C Delmaire et al. Tumeurs de la ligne médiane
765
Tumeurs trigono-septo-calleuses (3)
1. Données anatomiques
Les tumeurs trigono-septo-calleuses se développent initiale-
ment à partir des piliers antérieurs du trigone, et plus rarement,
à partir du corps calleux lui-même ou du septum lucidum. Ces
tumeurs se propagent latéralement, envahissant la substance
blanche des lobes frontaux, le noyau caudé, voire le noyau len-
ticulaire. C’est pourquoi le diagnostic est souvent posé au stade
de tumeur fronto-calleuse.
2. Données cliniques
Le diagnostic précoce des tumeurs trigono-septo-calleuses est
difficile. Le syndrome de la ligne médiane antérieure qui associe
des troubles de la mémoire, des troubles du comportement avec
inertie et ralentissement idéo-moteur et des troubles de la mar-
che par ataxie ou apraxie, reste difficile à identifier et peu spécifi-
que. C’est souvent au stade d’hypertension intracrânienne que le
diagnostic est évoqué.
3. Données anatomo-pathologiques
Les tumeurs gliales sont les plus fréquentes : astrocytome in-
filtrant, glioblastome, rarement oligodendrogliome ou épen-
dymome, et dans le cas particulier de la maladie de Bourneville,
l’astrocytome à cellules géantes en regard du foramen inter-
ventriculaire. Les métastases, le lymphome et le lipome du
corps calleux sont plus rares.
4. Imagerie
4.1. Tumeurs gliales
4.1.1. Astrocytome anaplasique infiltrant (AAI)
Macroscopiquement, c’est une tumeur infiltrante diffuse, mal
limitée, hétérogène avec des zones kystiques. Des phénomènes
hémorragiques, conséquences de l’hypervascularisation, peuvent
être observés sans zone de nécrose.
L’IRM retrouve une lésion qui apparaît mal limitée, avec un signal
hétérogène iso-hypointense sur les séquences pondérées en T1 et
iso-hyperintense sur les séquences pondérées T2. Les phénomènes
hémorragiques rendent le signal encore plus difficile à interpréter.
Elle s’accompagne d’un œdème périlésionnel en hypersignal T2 et
FLAIR, exerçant un effet de masse modéré sur les structures adja-
centes. Cet œdème péri-tumoral peut être le siège d’une infiltra-
tion péri-tumorale, qui ne peut être distinguée en imagerie de
l’œdème en lui-même. La prise de contraste est souvent irrégulière
et périphérique (fig. 1). L’infiltration se fait le long des faisceaux de
la substance blanche adjacente avec franchissement de la ligne
médiane. Les calcifications sont rares. La tumeur peut également
infiltrer l’épendyme et les leptoméninges le long du LCS. L’exten-
sion vers les ventricules se traduit par une prise de contraste souli-
gnant de façon variable les parois ventriculaires.
4.1.2. Glioblastome Multiforme (GM)
Macroscopiquement, c’est une tumeur hypervasculaire nécro-
tico-hémorragique à paroi épaisse et irrégulière.
En tomodensitométrie, la tumeur apparaît hétérogène avec un
centre hypodense. Les calcifications sont rares et des foyers hé-
morragiques d’âge différent comme dans l’astrocytome anaplasique
sont retrouvés. Un important œdème périphérique hypodense
est fréquent. La prise de contraste est intense, hétérogène, met-
tant en évidence une paroi épaisse et irrégulière.
L’IRM, par les séquences T1 sans et avec injection, met en évi-
dence une masse mal limitée de signal hétérogène, se rehaussant
intensément, mais de façon hétérogène avec des zones nécrotiques
ou kystiques à paroi épaisse et irrégulière. On retrouve également
des remaniements hémorragiques d’âge différent et des structures
vasculaires intra-tumorales en vide de signal T1 ou T2. L’exten-
sion vers le corps calleux est typique. L’œdème périphérique est
important, en hypersignal T2 et FLAIR, masquant les limites de
la tumeur (fig. 2).
4.1.3. Astrocytome à cellules géantes (ACG)
Macroscopiquement, c’est une lésion lobulée, calcifiée, kysti-
que. Le scanner, comme l’IRM, montre une masse focale siégeant
à proximité du foramen interventriculaire avec une dilatation
ventriculaire en amont. Des nodules sous épendymaires calci-
fiés sont fréquemment retrouvés, souvent assez volumineux
pour être vus en IRM. L’ACG est hétérogène, de signal mixte
sur les 2 séquences : hypo à iso T1, iso à hyper T2, avec prise de
contraste intense hétérogène. Il s’associe aux autres stigmates
radiologiques de la sclérose tubéreuse de Bourneville dont ils
sont la principale complication : lésions nodulaires calcifiées
sous épendymaires, hétérotopies, tubers corticaux… La pré-
sence d’une prise de contraste au niveau des autres lésions sous
épendymaires en IRM traduit une évolutivité persistante de
ces lésions.
4.2. Autres tumeurs
4.2.1. Lymphome
Les caractéristiques radiologiques des lymphomes cérébraux pri-
mitifs en scanner et en IRM, bien que non spécifiques, permet-
tent souvent d’évoquer le diagnostic (4). En scanner, il s’agit
d’une lésion iso ou spontanément hyperdense du fait de leur
hypercellularité. L’IRM montre une tumeur volumineuse infil-
trante, uni ou bilatérale antérieure en regard du genou du corps
calleux ou plus postérieure dans le splénium (fig. 3). Malgré sa
taille, cette tumeur respecte la morphologie des cornes frontales
ou des carrefours ventriculaires. Son signal est préférentielle-
ment en hyposignal T1 et pratiquement toujours en hypersignal
hétérogène T2, se rehaussant intensément et de façon homogène
avec le chélate de Gadolinium. Les calcifications et les hémorra-
gies sont exceptionnelles. L’œdème périlésionnel est souvent dis-
cret et l’effet de masse est minime voire absent. Il faudra penser
au lymphome devant une discordance entre l’importance des
signes directs et la discrétion, voire l’absence des signes indirects.
Le diagnostic sera confirmé par les biopsies effectuées en condi-
tions stéréotaxiques.
4.2.2. Lipome du corps calleux
Les lipomes du corps calleux sont le plus souvent asymptomati-
ques et de découverte fortuite. Il existe deux localisations particu-
lières du lipome :
• antérieur tubulonodulaire, le plus souvent associé à des ano-
malies des lobes frontaux, des thalami, de l’hypothalamus et du
rostrum calleux (5-6) ;
• postérieur curviligne ou en « C », avec un corps calleux quasi
normal ou présentant une agénésie partielle.
© 2017 Elsevier Masson SAS. Tous droits réservés. - Document téléchargé le 11/11/2017 Il est interdit et illégal de diffuser ce document.

J Radiol 2006;87
766
Tumeurs de la ligne médiane C Delmaire et al.
Fig. 1 : Astrocytome anaplasique. Lésion du splénium, à l’origine d’une augmentation de taille du corps calleux, se rehaussant de façon
hétérogène après injection, en anneau dans la partie centrale et de manière floue en périphérie. À noter une lésion en dehors du
ventricule droit.
aCoupe axiale FLAIR.
bCoupe sagittale après injection.
Fig. 1: Anaplastic astrocytoma. Lesion of the splenium causing enlargement of the corpus callosum. On postcontrast T1W images, the lesion
shows heterogeneous enhancement, with rim enhancement in the central portion and ill-defined enhancement in the peripheral por-
tion. A second lesion is present next to the wall of the right lateral ventricle.
aAxial FLAIR.
bSagittal T1W after injection.
ab
Fig. 2 : Gliome du corps calleux. Processus expansif frontocalleux droit envahissant le genou du corps calleux hétérogène, hypointense en T1,
hyperintense en T2, se rehaussant après injection de chélates de Gadolinium de façon très hétérogène, à l’origine d’un effet de masse
sur la corne frontal droite. Le rehaussement permet de mieux apprécier la diffusion de la tumeur à tout le genou du corps calleux. La
lésion est entourée d’un œdème périlésionnel visible en FLAIR.
aCoupe axiale FLAIR.
b-c Coupe axiale T1 avant (b) et après injection (c).
Fig. 2: Corpus callosum glioma. Heterogenous mass involving the genu of the corpus callosum. It is T1W hypointense, T2W hyperintense and
shows heterogeneous enhancement. The lesion compresses the right frontal horn. Contrast enhancement allows for better visualiza-
tion of the extensive involvement of the genu of the corpus callosum. Peritumoral oedema is visible on the FLAIR sequence.
aAxial FLAIR.
b-c Axial T1WI without (b) and with contrast (c).
abc
© 2017 Elsevier Masson SAS. Tous droits réservés. - Document téléchargé le 11/11/2017 Il est interdit et illégal de diffuser ce document.

J Radiol 2006;87
C Delmaire et al. Tumeurs de la ligne médiane
767
L’imagerie retrouve les caractéristiques d’une lésion graisseu-
se, hypodense au scanner avec des calcifications et hypersignal
T1, hyposignal T2 en IRM (fig. 4). Il ne se rehausse pas après
injection.
4.2.3. Métastases
Elles peuvent prendre des aspects multiples : solides, hémorragi-
ques, kystiques, voire être calcifiées. Leur aspect IRM est donc
non spécifique.
5. Conduite à tenir
Les tumeurs bien limitées comme les tumeurs trigonales pures,
septales, trigono-septales, sont en général des tumeurs gliales de
bas grade qui peuvent être réséquées par voie chirurgicale. Dans
la mesure du possible, il est important de respecter les piliers du
trigone, partie intégrante du rhinencéphale, dont l’importance
fonctionnelle est considérable dans les composantes instinctives,
émotionnelles et affectives du comportement. Leur destruction
bilatérale provoque en effet des troubles mnésiques irréversibles.
Quand la tumeur est extensive et se propage aux structures adjacentes
(noyaux gris centraux, hypothalamus), les possibilités chirurgicales
sont réduites. Il est utile alors de connaître la morphologie exacte et
les rapports de la lésion, ainsi que sa nature histologique par des
biopsies multi-étagées en conditions stéréotaxiques. Le traitement
peut alors être réduit à une dérivation du liquide céphalorachidien
par valve ou à une radiothérapie externe.
Tumeurs de la faux du cerveau
1. Données anatomiques
Ces tumeurs prennent naissance à partir des méninges de la faux
du cerveau et constituent une entité particulière de par leur topo-
graphie.
2. Données cliniques
Ces tumeurs uni ou bilatérales entraînent une compression de la
face interne des lobes frontaux et pariétaux, occasionnant le plus
souvent des crises Bravais-Jacksoniennes du membre inférieur.
3. Données anatomo-pathologiques
Les cellules mésenchymateuses pluripotentes des méninges le
long de la faux du cerveau, de la tente du cervelet et de la conve-
xité cérébrale, sont les précurseurs de plusieurs types de tumeurs,
la plus fréquente étant le méningiome (15 % des tumeurs intra-
crâniennes toutes localisations comprises) (7). Les autres lésions
sont plus rares : les métastases méningées, l’hémangiopéricyto-
me, le chordome et la tumeur cartilagineuse.
4. Imagerie du méningiome (fig. 5)
Macroscopiquement, il s’agit d’une lésion sphérique ou lobulée, à
large base d’implantation, le plus souvent durale. Il existe des formes
de méningiome en plaque et d’autres avec collet étroit, rendant le
diagnostic différentiel avec l’hémangiopéricytome plus délicat.
4.1. Scanner
C’est une lésion lobulée bien limitée, extraparenchymateuse, le
plus souvent spontanément hyperdense, se rehaussant intensé-
ment et de façon homogène. On peut déceler des calcifications au
sein de la tumeur dans 20 à 25 % des cas. Un œdème péri-tumoral
hypodense peut être retrouvé. Une hyperostose réactionnelle ou
une destruction de l’os adjacent est souvent retrouvée.
4.2. IRM
La lésion présente le plus souvent un signal iso ou hypointense
en T1 et un signal variable sur les séquences en pondération T2
(8-9). On visualise une lame de LCS entre la masse et le paren-
chyme cérébral avec refoulement des vaisseaux piaux. Un œdème
Fig. 3 : Lymphome du corps calleux. Lésion infiltrante de tout le
splénium se rehaussant fortement avec peu d’effet de
masse sur le ventricule. Coupe axiale T1 après injection.
Fig. 3: Corpus callosum lymphoma. Enhancing lesion involving
the entire corpus callosum showing minimal mass effect
on the ventricle. Contrast enhanced axial T1WI.
Fig. 4 : Lipome du corps calleux. Lésion typique du splénium du
corps calleux en hypersignal T1. Coupe sagittale en T1.
Fig. 4: Corpus callosum lipoma. Characteristic lesion of the sple-
nium of the corpus callosum, hyperintense on sagittal T1W
image.
© 2017 Elsevier Masson SAS. Tous droits réservés. - Document téléchargé le 11/11/2017 Il est interdit et illégal de diffuser ce document.

J Radiol 2006;87
768
Tumeurs de la ligne médiane C Delmaire et al.
modéré à sévère est fréquent. Le rehaussement est intense, le
plus souvent homogène, avec rehaussement de la dure-mère à
la périphérie de la masse, non spécifique, mais très suggestive
du diagnostic de méningiome (fig. 5). Cette tumeur peut être
infiltrative et englober les vaisseaux et sinus dure-mériens adja-
cents. De ce fait, une étude ARM des artères péricalleuses et
calloso-marginales et du sinus longitudinal supérieur est sys-
tématique.
Les autres tumeurs méningées présentent pratiquement la même
séméiologie à l’imagerie que le méningiome, et le diagnostic de
certitude ne sera fait qu’à l’anatomo-pathologie (10).
5. Conduite à tenir
Le traitement est en première intention chirurgical. En cas de re-
liquat tumoral ou de résection incomplète, une radiochirurgie ou
une radiothérapie externe peuvent être envisagées. Une angio-
graphie conventionnelle ne pourra être réalisée que dans le cas de
tumeurs volumineuses et bilatérales qui peuvent bénéficier d’une
embolisation pré-chirurgicale.
Tumeurs du troisième ventricule (V3)
et de ses parois
1. Données anatomiques
Les tumeurs du V3 sont classées en fonction de leur topographie
en quatre groupes présentant une certaine homogénéité radio-
logique et thérapeutique (11).
1.1. Les tumeurs du toit du troisième ventricule
et de la toile choroïdienne
Elles se développent dans la lumière du V3 et ne font que s’insé-
rer sur la toile choroïdienne sans y avoir d’extension notable.
1.2. Les tumeurs du plancher du troisième ventricule
Elles se développent à partir du plancher lui-même ou sont d’ori-
gine thalamique envahissant le plancher du V3, ou même corres-
pondent à des tumeurs extrinsèques refoulant le plancher du V3.
1.3. Les tumeurs des parois latérales du troisième
ventricule constituées par la face interne des thalamus
Les tumeurs thalamiques ont une extension naturelle externe vers
la capsule interne ou encore en direction des centres semi-ovales.
Toutefois, elles peuvent présenter une extension interne réduisant
alors le diamètre transverse voire comblant progressivement le V3.
1.4. Les tumeurs du fond du troisième ventricule
ou tumeurs de la région pinéale
2. Données cliniques
Ces tumeurs sont donc variées, mais ont cependant en commun
dans leur expression clinique, l’apparition d’une hypertension
intracrânienne provoquée par un blocage de la lumière du
troisième ventricule ou de l’aqueduc de Sylvius. En fonction
de la localisation dans ou autour du V3, certains signes clini-
ques pourront parfois permettre un dépistage en début
d’évolution.
2.1. Les céphalées révélant les tumeurs du toit du V3
Elles sont de siège frontal ou occipital, uni ou bilatérales, conti-
nues ou à recrudescence matinale. Certaines tumeurs pédiculées,
mobiles dans la lumière ventriculaire, provoquent à la faveur
d’un changement de position, des poussées d’hypertension intra-
crânienne paroxystique par un mécanisme de clapet.
2.2. Les tumeurs du plancher du troisième ventricule
Elles se caractérisent par la diversité des signes cliniques qui peu-
vent être endocriniens, nerveux et neuro-psychologiques, visuels,
mais aussi peu spécifiques.
Fig. 5 : Volumineux méningiome de la faux du cerveau. Volumineux processus expansif frontal avec une implantation sur la faux du cerveau,
isointense en T1 se rehaussant fortement et de façon homogène après injection.
aCoupe axiale T1 sans injection.
bCoupe coronale T1 après injection.
Fig. 5: Meningioma of the falx. Large frontal lesion inserted on the falx, isointense on T1WI and hyperintense after injection.
aAxial T1.
bCoronal T1 with contrast.
ab
© 2017 Elsevier Masson SAS. Tous droits réservés. - Document téléchargé le 11/11/2017 Il est interdit et illégal de diffuser ce document.
 6
6
 7
7
 8
8
 9
9
 10
10
 11
11
 12
12
 13
13
 14
14
 15
15
1
/
15
100%