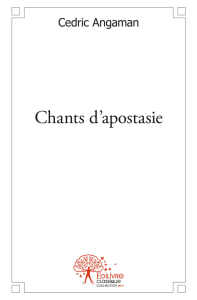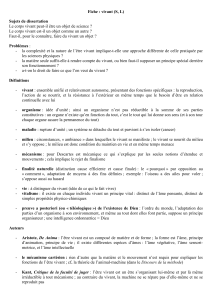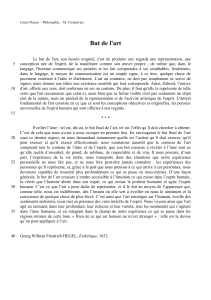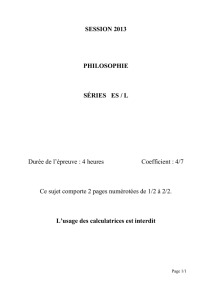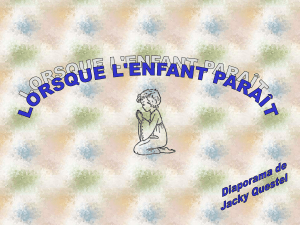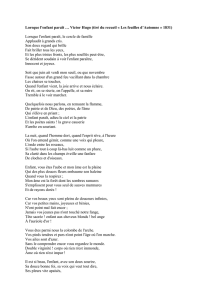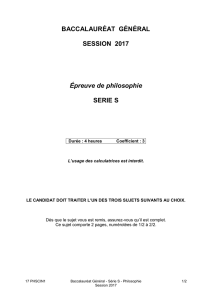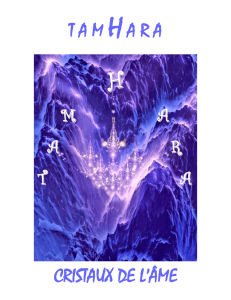A
G
L
A
E
I
E
H
E
L
O
H
A
A
D
O
N
A
Y
A
U
R
I
E
L
AA
9HSMJLH*aeaaba+
¹!LAIN4ROCMÏ%DITEUR
Les Grands Initiés
Les Grands Initiés
Edouard Schuré
)3".


A LA MÉMOIRE
DE
MARGHERITA ALBANA MIGNATY
Sans toi, ô grande âme aimée ! ce livre n’eût point vu le jour. Tu l’as couvé de ta fl amme puissante,
tu l’as nourri de ta douleur, tu l’as béni d’une divine espérance. Tu avais l’intelligence qui voit
le Beau et le Vrai éternels au-dessus des réalités éphémères ; tu avais la Foi qui transporte les
montagnes ; tu avais l’Amour qui éveille et qui crée des âmes ; ton enthousiasme brûlait comme
un feu rayonnant.
Et voici, tu t’es éteinte et tu as disparu. D’une aile sombre, la Mort t’a emportée dans le grand
Inconnu... Mais si mes regards ne peuvent plus t’atteindre, je te sais plus vivante que jamais !
Aff ranchie des chaînes terrestres, du sein de la lumière céleste où tu t’abreuves, tu n’a cessé de suivre
mon oeuvr et j’ai senti ton rayon fi dèle veiller jusqu’au bout sur son éclosion prédestinée.
Si quelque chose de moi devait survivre parmi nos frères, dans ce monde où tout ne fait que
passer, je voudrais que ce fût ce livre, témoignage d’une foi conquise et partagée. Comme un
fl ambeau d’Éleusis, orné de noir cyprès et de narcisse étoilé, je le voue à l’Âme ailée de Celle qui
m’a conduit jus qu’au fond des Mystères, afi n qu’il propage le feu sacré et qu’il annonce l’Aurore
de la grande Lumière !
e

INTRODUCTION
SUR LA
DOCTRINE ÉSOTÉRIQUE
Je suis persuadé qu’un jour viendra où le physiologiste,
le poète et le philosophe parleront la même langue
et s’entendront tous.
Claude Bernard.
Le plus grand mal de notre temps est que la Science et la Religion y apparaissent comme deux
forces ennemies et irréductibles. Mal intellectuel d’autant plus pernicieux qu’il vient de haut et
s’infi ltre sourdement, mais sûrement, dans tous les esprits, comme un poison subtil qu’on respire
dans l’air. Or, tout mal de l’intelligence devient à la longue un mal de l’âme et par suite un mal
social.
Tant que le christianisme ne fi t qu’affi rmer naïvement la foi chrétienne au milieu d’une Europe
encore à demi-barbare, comme au moyen âge, il fut la plus grande des forces morales ; il a formé
l’âme de l’homme moderne. - Tant que la science, expérimentale, ouvertement reconstituée au
seizième siècle, ne fi t que revendiquer les droits légitimes de la raison et sa liberté illimitée, elle fut
la plus grande des forces intellectuelles ; elle a renouvelé la face du monde, aff ranchi l’homme de
chaînes séculaires et fourni à l’esprit humain des bases indestructibles.
Mais depuis que l’Église, ne pouvant plus prouver son dogme primaire en face des objections de la
science, s’y est enfermée comme dans une maison sans fenêtres, opposant la foi à la raison comme
un commandement absolu et indiscutable ; depuis que la Science, enivrée de ses découvertes dans
le monde physique, faisant abstraction du monde psychique et intellectuel, est devenue agnostique
dans sa méthode, matérialiste dans ses principes comme dans sa fi n ; depuis que la Philosophie,
désorientée et impuissante entre les deux, a en quelque sorte abdiqué ses droits pour tomber dans
un scepticisme transcendant, une scission profonde s’est faite dans l’âme de la société comme dans
celle des individus. Ce confl it, d’abord nécessaire et utile, puisqu’il a établi les droits de la Raison
et de la Science, a fi ni par devenir une cause d’impuissance et de dessèchements. La Religion
répond aux besoins du coeur, de là sa magie éternelle ; la Science à ceux de l’esprit de là sa force
invincible.
Mais depuis longtemps, ces puissances ne savent plus s’entendre. La Religion sans preuve et la
Science sans espoir sont debout, l’une en face de l’autre, et se défi ent sans pouvoir se vaincre.
De là une contradiction profonde, une guerre cachées non seulement entre l’État et l’Église mais
encore dans la Science elle-même, dans le sein de toutes les églises et jusque dans la conscience de
tous les individus pensants. Car, qui que nous soyons, à quelque école philosophique, esthétique

et sociale que nous appartenions nous portons en nous ces deux mondes ennemis, en apparence
irréconciliables, qui naissent de deux besoins indestructibles de l’homme : le besoin scientifi que
et le besoin religieux. Cette situation, qui dure depuis plus de cent ans, n’a certainement pas peu
contribué à développer les facultés humaines en les tendant les unes contre les autres. Elle a inspiré
à la poésie et à la musique des accents d’un pathétique et d’un grandiose inouï. Mais aujourd’hui
la tension prolongée et suraiguë a produit l’eff et contraire. Comme l’abattement succède à la
fi èvre chez un malade, elle s’est changée en marasme, en dégoût, en impuissance. La Science ne
s’occupe que du monde physique et matériel ; la philosophie morale a perdu la direction des
intelligences ; la Religion gouverne encore dans une certaine mesure les masses, mais elle ne règne
plus sur les sommets sociaux ; toujours grande par la charité, elle ne rayonne plus par la foi. Les
guides intellectuels de notre temps sont des incrédules ou des sceptiques parfaitement sincères et
loyaux. Mais ils doutent de leur art et se regardent en souriant comme les augures romains. En
public, en privé, ils prédisent les catastrophes sociales sans trouver le remède, ou enveloppent leurs
sombres oracles d’euphémismes prudents. Sous de tels auspices, la littérature et l’art ont perdu
le sens du divin. Déshabituée des horizons éternels, une grande partie de la jeunesse a versé dans
ce que ses maîtres nouveaux appellent le naturalisme, dégradant ainsi le beau nom de Nature.
Car ce qu’ils décorent de ce vocable n’est que l’apologie des bas instincts, la fange du vice ou la
peinture complaisante de nos platitudes sociales, en un mot, la négation systématique de l’âme et
de l’intelligence. Et la pauvre Psyché ayant perdu ses ailes gémit et soupire étrangement au fond de
ceux-là même qui l’insultent et la nient.
A force de matérialisme, de positivisme et de scepticisme cette fi n de siècle en est arrivée à une
fausse idée de la Vérité et du Progrès.
Nos savants, qui pratiquent la méthode expérimentale de Bacon pour l’étude de l’univers visible
avec une précision merveilleuse et d’admirables résultats, se font de la Vérité une idée tout extérieure
et matérielle. Ils pensent qu’on s’en rapproche à mesure qu’on accumule un plus grand nombre
de faits. Dans leur domaine, ils ont raison. Ce qu’il y a de grave, c’est que nos philosophes et nos
moralistes ont fi ni par penser de même. A ce compte, il est certain que les causes premières et les
fi ns dernières resteront à jamais impénétrables à l’esprit humain. Car, supposez que nous sachions
exactement ce qui se passe, matériellement parlant, dans toutes les planètes du système solaire, ce
qui, soit dit en passant, serait une magnifi que base d’induction ; supposez même que nous sachions
quelle sorte d’habitants renferment les satellites de Sirius et de plusieurs étoiles de la voie lactée.
Certes, il serait merveilleux de savoir tout cela, mais en saurions-nous davantage sur la totalité de
notre amas stellaire, sans parler de la nébuleuse d’Andromède et de la nuée de Magellan ? - Cela
fait que notre temps conçoit le développement de l’humanité comme la marche éternelle vers une
vérité indéfi nie, indéfi nissable et à jamais inaccessible.
Voilà la conception de la philosophie positiviste d’Auguste Comte et de Herbert Spencer qui a pré
valu de nos jours.
Or, la Vérité était tout autre chose pour les sages et les théosophes de l’Orient et de la Grèce. Ils
savaient sans doute qu’on ne peut l’embrasser et l’équilibrer sans une connaissance sommaire
du monde physique, mais ils savaient aussi qu’elle réside avant tout en nous-mêmes, dans les
principes intellectuels et dans la vie spirituelle de l’âme. Pour eux, l’âme était la seule, la divine
réalité et la clef de l’univers. En ramassant leur volonté à son centre en développant ses facultés
latentes, ils atteignaient à ce foyer vivant qu’ils nommaient Dieu, dont la lumière fait comprendre
les hommes et les êtres. Pour eux, ce que nous nommons le Progrès, à savoir l’histoire du monde
 6
6
 7
7
 8
8
 9
9
 10
10
 11
11
 12
12
 13
13
 14
14
 15
15
 16
16
 17
17
 18
18
 19
19
 20
20
 21
21
 22
22
 23
23
 24
24
 25
25
 26
26
 27
27
 28
28
 29
29
 30
30
 31
31
 32
32
 33
33
 34
34
 35
35
 36
36
 37
37
 38
38
 39
39
 40
40
 41
41
 42
42
 43
43
 44
44
 45
45
 46
46
 47
47
 48
48
 49
49
 50
50
 51
51
 52
52
 53
53
 54
54
 55
55
 56
56
 57
57
 58
58
 59
59
 60
60
 61
61
 62
62
 63
63
 64
64
 65
65
 66
66
 67
67
 68
68
 69
69
 70
70
 71
71
 72
72
 73
73
 74
74
 75
75
 76
76
 77
77
 78
78
 79
79
 80
80
 81
81
 82
82
 83
83
 84
84
 85
85
 86
86
 87
87
 88
88
 89
89
 90
90
 91
91
 92
92
 93
93
 94
94
 95
95
 96
96
 97
97
 98
98
 99
99
 100
100
 101
101
 102
102
 103
103
 104
104
 105
105
 106
106
 107
107
 108
108
 109
109
 110
110
 111
111
 112
112
 113
113
 114
114
 115
115
 116
116
 117
117
 118
118
 119
119
 120
120
 121
121
 122
122
 123
123
 124
124
 125
125
 126
126
 127
127
 128
128
 129
129
 130
130
 131
131
 132
132
 133
133
 134
134
 135
135
 136
136
 137
137
 138
138
 139
139
 140
140
 141
141
 142
142
 143
143
 144
144
 145
145
 146
146
 147
147
 148
148
 149
149
 150
150
 151
151
 152
152
 153
153
 154
154
 155
155
 156
156
 157
157
 158
158
 159
159
 160
160
 161
161
 162
162
 163
163
 164
164
 165
165
 166
166
 167
167
 168
168
 169
169
 170
170
 171
171
 172
172
 173
173
 174
174
 175
175
 176
176
 177
177
 178
178
 179
179
 180
180
 181
181
 182
182
 183
183
 184
184
 185
185
 186
186
 187
187
 188
188
 189
189
 190
190
 191
191
 192
192
 193
193
 194
194
 195
195
 196
196
 197
197
 198
198
 199
199
 200
200
 201
201
 202
202
 203
203
 204
204
 205
205
 206
206
 207
207
 208
208
 209
209
 210
210
 211
211
 212
212
 213
213
 214
214
 215
215
 216
216
 217
217
 218
218
 219
219
 220
220
 221
221
 222
222
 223
223
 224
224
 225
225
 226
226
 227
227
 228
228
 229
229
 230
230
 231
231
 232
232
 233
233
 234
234
 235
235
 236
236
 237
237
 238
238
 239
239
 240
240
 241
241
 242
242
 243
243
 244
244
 245
245
 246
246
 247
247
 248
248
 249
249
 250
250
 251
251
 252
252
 253
253
 254
254
 255
255
 256
256
 257
257
 258
258
 259
259
 260
260
 261
261
 262
262
 263
263
 264
264
 265
265
 266
266
 267
267
 268
268
 269
269
 270
270
 271
271
 272
272
 273
273
 274
274
 275
275
 276
276
 277
277
 278
278
 279
279
 280
280
 281
281
 282
282
 283
283
 284
284
 285
285
 286
286
 287
287
 288
288
 289
289
 290
290
 291
291
 292
292
 293
293
 294
294
 295
295
 296
296
 297
297
 298
298
1
/
298
100%