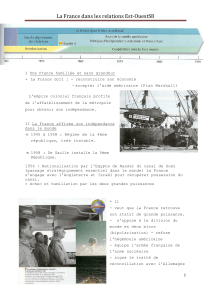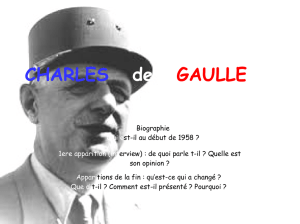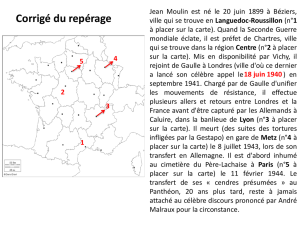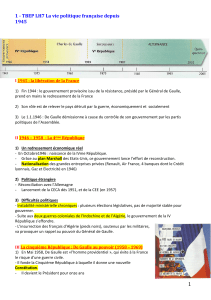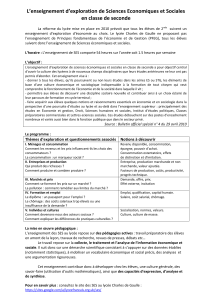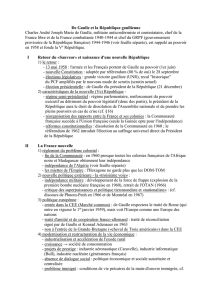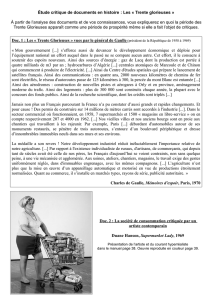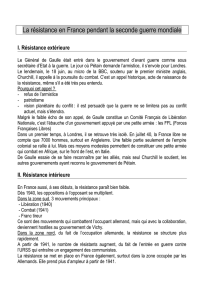LES
MEILLEURES
COPIES
ADMISSIONS
AU COLLÈGE
UNIVERSITAIRE
SESSION 2017

Afin de renforcer la diversité de ses étudiants, Sciences Po a créé
diérentes voies d’accès au Collège universitaire. Toutes ces procédures
d’admission sont sélectives.
• Uneprocédure par examenpour les candidats qui
préparent le baccalauréat de l’enseignement général
ou technologique français,ainsi que pour les candidats qui
préparent à l’étranger un diplôme d’études secondaires dont
l’équivalence a été reconnue.
• Uneprocédure internationalepour les candidats qui
préparent un baccalauréat français à l’étranger ouun
diplôme étranger.
• Uneprocédure Conventions éducation prioritaire
qui s’adresse aux élèves scolarisés dans l’un des lycées
partenairesde Sciences Po.
• Sciences Po ore également plusieursprogrammes de
doubles diplômesavec des universitésà l’international
eten France.
La procédure par examen comporte deux étapes : l’admissibilité et
l’entretien d’admission.
Après un examen approfondi des dossiers, un jury établit souverainement
la liste des candidats exemptés d’épreuves écrites et déclare ces derniers
directement admissibles.
Pour les autres candidats, la phase d’admissibilité se poursuit par trois
épreuves écrites.
• L’histoire, l’une des cinq disciplines qui constituent le socle de
la formation fondamentale délivrée à Sciences Po (coef. 2).
• L’épreuve à option : littérature et philosophie, mathématiques ou
sciences économiques et sociales (coef. 2).
• L’épreuve de langue étrangère (coef. 1).
Les candidats déclarés admissibles sont ensuite invités en entretien
d’admission. D’une durée de vingt minutes, il permet d’évaluer la
motivation du candidat, son ouverture d’esprit, son goût pour l’innovation,
sa curiosité intellectuelle, sa capacité à mobiliser et à mettre en relation
des connaissances pertinentes, sa disposition à être en prise avec les
enjeux contemporains, son esprit critique et sa capacité à développer une
réflexion personnelle.
Le saviez-vous ?
Seule l’orthographe a été corrigée. Les copies peuvent comporter certaines
erreurs factuelles ou d’analyse, qui ont été signalées aux candidats lors de
la correction.

Épreuve de littérature et philosophie
Frédéric Moreau est monté à Paris en 1840 dans l’espoir de faire fortune et de retrouver une femme aper-
çue quelque temps auparavant. Entre amours incertaines et ambitions avortées, il participe passivement
aux mouvements de l’histoire. Le 24 février 1848, il se trouve aux Tuileries avec son ami Hussonnet. Ils sont
témoins tous les deux des émeutes qui ont lieu dans la résidence royale, et qui vont mettre fin à la Monarchie
de Juillet.
« Tout à coup la Marseillaise retentit. Hussonnet et Frédéric se penchèrent sur la rampe. C’était le peuple.
Il se précipita dans l’escalier, en secouant à flots vertigineux des têtes nues, des casques, des bonnets rouges,
des baïonnettes et des épaules, si impétueusement, que des gens disparaissaient dans cette masse grouil-
lante qui montait toujours, comme un fleuve refoulé par une marée d’équinoxe, avec un long mugissement,
sous une impulsion irrésistible. En haut, elle se répandit, et le chant tomba.
On n’entendait plus que les piétinements de tous les souliers, avec le clapotement des voix. La foule
inoensive se contentait de regarder. Mais, de temps à autre, un coude trop à l’étroit enfonçait une vitre ;
ou bien un vase, une statuette déroulait d’une console, par terre. Les boiseries pressées craquaient. Tous les
visages étaient rouges ; la sueur en coulait à larges gouttes ; Hussonnet fit cette remarque :
— Les héros ne sentent pas bon !
— Ah ! vous êtes agaçant, reprit Frédéric.
Et poussés malgré eux, ils entrèrent dans un appartement où s’étendait au plafond, un dais de velours
rouge. Sur le trône, en dessous, était assis un prolétaire à barbe noire, la chemise entr’ouverte, l’air hilare et
stupide comme un magot1. D’autres gravissaient l’estrade pour s’asseoir à sa place.
— Quel mythe ! dit Hussonnet. Voilà le peuple souverain !
Le fauteuil fut enlevé à bout de bras, et traversa toute la salle en se balançant.
— Saprelotte ! comme il chaloupe ! Le vaisseau de l’État est ballotté sur une mer orageuse ! Cancane-
t-il ! cancane-t-il !2
On l’avait approché d’une fenêtre, et, au milieu des siets, on le lança.
— Pauvre vieux ! dit Hussonnet en le voyant tomber dans le jardin, où il fut repris vivement pour être
promené ensuite jusqu’à la Bastille, et brûlé.
Flaubert, L’Éducation sentimentale, III, 1 (1869)
1- Singe du genre macaque.
2- Danser le cancan, danse très enlevée, en vogue au XIXe siècle dans les bals publics, pratiquée encore dans certains cabarets.
I
Flaubert, L’Éducation sentimentale, III, 1 (1869)
Commentaire de texte

II
Gustave Flaubert est l’un des représentants
majeurs du mouvement réaliste, qui se développe
en France à partir de 1830 en réaction à l’idéalisme
et au lyrisme romantique. L’Éducation sentimentale,
datant de 1869, est considérée comme un roman
d’apprentissage réaliste. Le personnage principal,
Frédéric Moreau, est, dans ce passage, en compagnie
de son ami Hussonnet, et ils sont témoins de la
révolution de 1848. En pleine année du printemps
des peuples, celle-ci mettra fin définitivement à la
monarchie en France. Ainsi, cet extrait décrit la prise
des Tuileries par la révolte populaire. Il s’agira de
montrer en quoi Frédéric Moreau et Hussonnet sont
témoins d’une scène de prise de pouvoir populaire
décrite de façon réaliste, mais transfigurée par
Flaubert, afin de montrer le naufrage de la monarchie
française.
Si la scène est décrite de façon réaliste à travers
les impressions des deux personnages amusés
et enthousiastes, Flaubert la transfigure, afin de
montrer le naufrage de la monarchie par l’énergie
d’une marée humaine.
Frédéric Moreau et Hussonnet sont des témoins
passifs de la prise des Tuileries de 1848. Ils portent
un regard à la fois enthousiaste, mais aussi ironique
sur les événements. La scène romanesque est
décrite de façon réaliste.
Le narrateur est externe dans cet extrait, mais
il suit les deux protagonistes. En eet, la scène est
décrite en fonction de la place qu’occupent Frédéric
et Hussonnet : en haut de l’escalier (« sur la rampe ») ;
puis dans un appartement où ils sont « poussés malgré
eux ». Ce dernier complément circonstanciel de
moyen rappelle leur passivité face aux événements.
Les deux personnages se montrent à la fois amusés
et enthousiastes face à ce qui se passe autour
d’eux. En eet, leurs impressions sont rapportées au
discours direct. Ironiquement, Hussonnet qualifie les
insurgés de « héros », en registre héroï-comique, qui
« ne sentent pas bon ». Cependant, l’enthousiasme
et l’emphase de Hussonnet sont montrés avec de
nombreuses phrases exclamatives : « quel mythe! »,
« Saprelotte! ». Cette dernière interjection est dans
un registre de langue plus bas que le reste du texte,
ce qui est réaliste pour un petit-bourgeois. Le
portrait des insurgés fait par Flaubert correspond
à celui d’antihéros réalistes. En eet, ceux-ci « ne
sentent pas bon », comme nous l’avons vu. En outre,
Flaubert les animalise en singes : « barbe noire » ;
« comme un magot » ; et les dépeint « rouges »
et dégoulinants de « sueur ». Vêtus de « bonnets
rouges », « la chemise entr’ouverte » et portant
la baïonnette, ils ont « l’air hilare et stupide ». Ils
sont la caricature du prolétaire. C’est donc une
description réaliste que fait Flaubert des héros
révolutionnaires, des personnages que l’on pourrait
qualifier, pour reprendre sa formule, de « grotesques
tristes ». La description de la scène romanesque est
réalisée d’un rythme enlevé, énergique. Une phrase
courte inaugure la description, commençant par
« tout à coup », qui rappelle le coup de théâtre, une
péripétie, une action de premier plan annoncée
par la valeur du passé simple « retentit ». La
provenance de l’allusion sonore à la Marseillaise est
résolue par une deuxième phrase courte : « c’était
le peuple ». Dans le premier paragraphe, l’adverbe
« impétueusement » et le substantif « impulsion »
renvoient à l’énergie déployée par l’insurrection
populaire. L’accumulation « des têtes nues, des
casques, des bonnets rouges, des baïonnettes et
des épaules » montre le désordre, la dimension
hétéroclite de l’ensemble de la « masse grouillante ».
Cette scène est donc décrite à travers la
progression des deux protagonistes le long de
l’insurrection, à laquelle ils assistent passivement.
Flaubert propose une description réaliste, même
peu flatteuse des insurgés, et le rythme énergique
de la description traduit le désordre et l’énergie
déployés par les révolutionnaires.
Bien que la description puisse être qualifiée
de réaliste, Flaubert transfigure le réel de cette
insurrection populaire pour montrer le naufrage de la
monarchie française, comme une épopée populaire
et anarchique. Flaubert file la métaphore des flots
pour décrire le peuple qui, dans une destruction
anarchique, telle une tempête, engloutit le trône
royal symbole de la monarchie.
Tout le long de l’extrait, dans les passages
descriptifs et dialogiques, Flaubert file la métaphore
in praesentia des flots pour qualifier les insurgés. Le
peuple, « anonymé » par les pronoms personnels « il »,
secoue « à flots vertigineux » ses membres. Ainsi,
durant tout l’extrait est présent le champ lexical
marin, bien qu’on trouve une occurrence du mot
« fleuve » ; le peuple est impétueux, c’est une marée
d’équinoxe, puissante qui mugit. Les insurgés sont
une masse, une marée qui progresse tout le long de
l’extrait jusqu’à l’aboutissement : l’engloutissement
du trône royal. Flaubert en fait une épopée dont
témoignent les hyperboles : « flots vertigineux » et
« fleuve refoulé ».
Cette marée impétueuse est responsable d’une
anarchie. En eet, son poids presse « les boiseries

[qui] craquent ». Les objets, comme personnifiés,
ne sont pas décrits au passif, mais à l’actif : « une
statuette déroulait d’une console » ; le fauteuil
« traversa toute la salle en se balançant ». On trouve
trois occurrences du mot « rouge » dans l’extrait:
le bonnet des prolétaires, qui renvoie au bonnet
phrygien de 1789, mais aussi au drapeau rouge
communiste brandi durant cette révolution, et
refusé par Lamartine ; mais également le rouge du
visage, qui renvoie à la chaleur ; et le rouge royal.
Cependant, on peut se demander si cette couleur
rouge ne renvoie pas également à une violence
anarchique et au sang versé durant la révolution
de 1848. L’anarchie à venir est signifiée par le fait
que les insurgés veulent « s’asseoir à [la] place » du
prolétaire animalisé par Flaubert, sur le trône, ce qui
signifie qu’ils veulent prendre le contrôle de la marée
humaine.
Le « tout » collectif de la marée humaine détrône
la monarchie, en engloutissant le trône royal dans ses
flots, puis en le brûlant. Telle une tempête orageuse, la
marée humaine métaphorisée par Flaubert engloutit
la monarchie. Le fauteuil traverse « toute la salle en
se balançant ». Hussonnet commente le parcours
du trône en filant la métaphore de la tempête
– « le vaisseau de l’État est ballotté sur une mer
orageuse ! » –, et en utilisant les verbes « chalouper »
et « cancaner », qui renvoient à un mouvement de
ballottement. L’emphase de Hussonnet renvoie à la
tension dramatique de l’instant. Enfin, le trône est
défenestré puis brûlé, comme si le peuple liguait tous
les éléments contre ce symbole de la monarchie:
l’eau par leur marée humaine, l’air dans la chute du
fauteuil, et enfin le feu, aboutissement de la révolte
qui a lieu à la Bastille.
Ainsi, Flaubert transfigure le réalisme de la
description de l’insurrection pour en faire une marée
populaire engloutissant la monarchie.
Cet extrait de L’Éducation sentimentale de
Gustave Flaubert propose donc une description
réaliste de l’insurrection du palais des Tuileries le
24 février 1848, tout en transfigurant le réel pour
métamorphoser le dernier naufrage de la monarchie
française, après les soulèvements de 1789 et 1830.
Afin de poursuivre cette étude, il serait intéressant de
s’attarder à la description de l’insurrection populaire
de la Commune et de ses barricades réalisée par
Victor Hugo dans Les Misérables. n
III
 6
6
 7
7
 8
8
 9
9
 10
10
 11
11
 12
12
 13
13
 14
14
 15
15
 16
16
1
/
16
100%