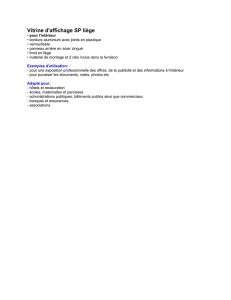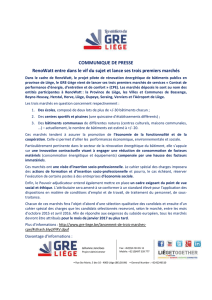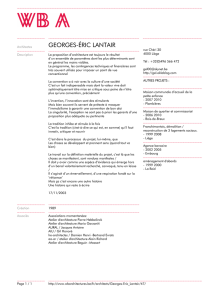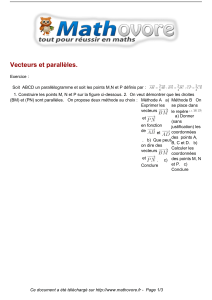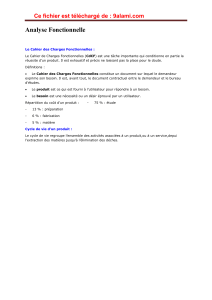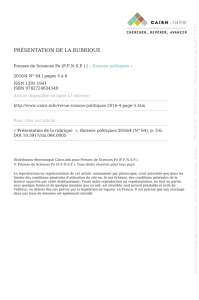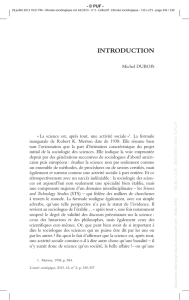Prévention des risques psycho-socio-organisationnels : pluralité des méthodes
Telechargé par
Merielly Greicy Dornelas Muzi

L’APPORT DE LA PLURALITÉ DES MÉTHODES DANS LA
PRÉVENTION DU RISQUE PSYCHO-SOCIO-ORGANISATIONNEL
Tony Machado,Pascale Desrumaux , Alain Lancry
De Boeck Supérieur | « @GRH »
2014/4 n° 13 | pages 43 à 73
ISSN 2034-9130
ISBN 9782807300590
Article disponible en ligne à l'adresse :
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
http://www.cairn.info/[email protected]
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Pour citer cet article :
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Tony Machado et al., « L’apport de la pluralité des méthodes dans la prévention du risque
psycho-socio-organisationnel », @GRH 2014/4 (n° 13), p. 43-73.
DOI 10.3917/grh.144.0043
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Distribution électronique Cairn.info pour De Boeck Supérieur.
© De Boeck Supérieur. Tous droits réservés pour tous pays.
La reproduction ou représentation de cet article, notamment par photocopie, n'est autorisée que dans les limites des
conditions générales d'utilisation du site ou, le cas échéant, des conditions générales de la licence souscrite par votre
établissement. Toute autre reproduction ou représentation, en tout ou partie, sous quelque forme et de quelque manière
que ce soit, est interdite sauf accord préalable et écrit de l'éditeur, en dehors des cas prévus par la législation en vigueur en
France. Il est précisé que son stockage dans une base de données est également interdit.
Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)
Document téléchargé depuis www.cairn.info - Université de Liège - - 139.165.31.12 - 09/06/2015 14h24. © De Boeck Supérieur
Document téléchargé depuis www.cairn.info - Université de Liège - - 139.165.31.12 - 09/06/2015 14h24. © De Boeck Supérieur

L’APPORT DE LA PLURALITÉ DES MÉTHODES DANS LA PRÉVENTION DU RISQUE…
43
FR
L’APPORT DE LA PLURALITÉ
DES MÉTHODES DANS LA PRÉVENTION
DU RISQUE PSYCHO-SOCIO-
ORGANISATIONNEL
Tony Machado
Docteur en psychologie du travail et ergonomie
Université Picardie Jules Verne
machado.tony1@gmail.com
Pascale Desrumaux
Professeure de psychologie du travail et des organisations
Université Lille3
pascale.desrumaux@univ-lille3.fr
Alain Lancry
Professeur émérite de psychologie du travail et ergonomie
Université de Picardie Jules Verne
alain.lancry@u-picardie.fr
Résumé
Le diagnostic et la prévention du risque psycho-socio-organisationnel (RPSO) nécessite
l’utilisation de méthodes complémentaires (examen des indicateurs de fonctionnement
et de santé, entretiens, analyse de l’activité, adaptation d’un questionnaire) permettant
de prendre en compte différentes exigences et ressources impactant la santé des tra-
vailleurs. L’intervention menée dans le secteur de l’hôtellerie-restauration (N = 230)
a mobilisé ces différentes méthodes interrogeant des déterminants organisationnels
propres à l’entreprise. Les entretiens et les analyses de l’activité ont permis d’identifier
des exigences (exposition aux comportements antisociaux, risque perçu d’exposition à un
accident du travail, exigences physiques et environnementales) et des ressources (com-
munication, accompagnement au changement) complémentaires à celles des modèles
de référence de Karasek et Siegrist (demande, latitude, soutien, récompense). Les résul-
tats indiquent que la prise en compte des exigences et ressources spécifiques permet de
mieux expliquer les atteintes sur la santé, évaluée sous les dimensions de stress, d’épui-
sement physique et émotionnel. Par ailleurs, conformément au modèle JDR, un rôle
Document téléchargé depuis www.cairn.info - Université de Liège - - 139.165.31.12 - 09/06/2015 14h24. © De Boeck Supérieur
Document téléchargé depuis www.cairn.info - Université de Liège - - 139.165.31.12 - 09/06/2015 14h24. © De Boeck Supérieur

@GRH • 13/2014
44
modérateur des ressources sur le lien existant entre exigences et santé a été observé.
Lors de l’évaluation du RPSO, il semble donc nécessaire d’articuler l’intervention autour
d’une méthodologie combinatoire afin d’être au plus près des réalités de terrain vécues
par les agents et construire un plan d’actions de prévention efficace.
Mots-clés
Risques psychosociaux, ressources, exigences, prévention.
Abstract
Diagnosis and prevention of psycho-socio-organizational risk requires the use of comple-
mentary methods (review of indicators, interview activity analysis, questionnaire) to take
into account different demands and resources impacting the health of workers. The inter-
vention carried out in the hotel & catering sector (N = 230) has employed these meth-
ods taking account of organizational determinants specific to the company. Interviews
and analysis of the activity lead to identify demands (exposure to antisocial behavior,
perceived risk of exposure to workplace accident, physical and environmental require-
ments) and resources (communication, change management) complementary to those of
Karasek’s and Siegrist’s models (demand, control, support, reward). The results indicate
that taking into account the specific demands and resources helps to explain impacts on
health, evaluated by both dimensions of stress and physical and emotional exhaustion.
Moreover, according to JDR, a moderating role of resources on the relationship between
demands and health was observed. During the psycho-socio-organizational risk evalua-
tion, it appears necessary to articulate the intervention around a combinatorial metho-
dology in order to be at the nearest of the reality experienced by agents.
Keywords
Psychosocial risk, resources, demands, prevention.
INTRODUCTION
Bien qu’approché sous d’autres terminologies depuis des décennies (qualité de vie,
santé au travail), les risques dits « psychosociaux » ou « RPS » recouvrent des réalités
qui deviennent incontournables pour les entreprises (Gollac & Baudier, 2011 ; Vallery &
Leduc, 2012). Cependant, de réelles difficultés persistent, tant au niveau de la définition
que de l’évaluation de ces risques (Nasse & Légeron, 2008) dont l’incidence sur la santé
des travailleurs est forte (Commission des Affaires Sociales, 2011 ; Vallery & Leduc,
EN
Document téléchargé depuis www.cairn.info - Université de Liège - - 139.165.31.12 - 09/06/2015 14h24. © De Boeck Supérieur
Document téléchargé depuis www.cairn.info - Université de Liège - - 139.165.31.12 - 09/06/2015 14h24. © De Boeck Supérieur

L’APPORT DE LA PLURALITÉ DES MÉTHODES DANS LA PRÉVENTION DU RISQUE…
45
2012). Selon Tabanelli et al. (2008) et Vézina (2008), deux modèles permettant d’ex-
plorer les contraintes de travail sont internationalement reconnus, le « job demands/
control » de Karasek et Theorell (1990) ainsi que le « effort-reward imbalance » de
Siegrist (1996, 2004). Pourtant, Chouanière (2009) constate que les échelles associées
à ces modèles n’explorent pas toutes les contraintes présentes dans les situations de
travail. Aussi, Gollac et Baudier (2011) estiment qu’aucun outil de mesure ne s’impose
comme un standard. Selon le modèle « job demands-resources » ou JDR (Bakker &
Demerouti, 2007 ; Demerouti, Bakker, Nachreiner, & Schaufeli, 2001) chaque activité de
travail met en jeu des facteurs qui peuvent être classés dans deux grandes catégories
générales. D’une part, les exigences au travail (job demands) constituent des précur-
seurs d’un processus de dépréciation de la santé. D’autre part, les ressources au travail
(job resources) peuvent initier un processus de motivation au travail. S’inscrivant dans
le modèle JDR, cette recherche a été menée dans le cadre du diagnostic des risques
dit « psychosociaux » au sein d’une enseigne de l’hôtellerie-restauration. L’objectif a été
de comprendre comment articuler la démarche d’intervention afin de mieux spécifier le
contexte organisationnel et prévenir efficacement les RPS. À cet effet, se référant aux
étapes d’un diagnostic préconisées par l’INRS et la CRAM (2010), une démarche multi-
méthodologique a été déployée. Les indicateurs de santé et de fonctionnement ont été
exploités, des entretiens individuels menés et des analyses de l’activité réalisées. Ce
cumul d’informations a permis d’adapter un questionnaire interrogeant des détermi-
nants psychosociaux et organisationnels propres à la situation de l’entreprise.
Dans un premier temps, nous aborderons la notion de RPS en interrogeant les réalités
qu’elle recouvre et la place de l’organisation dans l’émergence et la prévention de ces
risques. Ensuite, nous discuterons de la pertinence de la méthodologie suivie (INRS &
CRAM, 2010) et des modèles théoriques de référence mobilisés (Bakker & Demerouti,
2007 ; Karasek & Theorell, 1990 ; Siegrist, 1996 ; Siegrist et al, 2004) dans l’évaluation
des risques dits « psychosociaux ».
1. REVUE DE LITTÉRATURE
›1.1. DES RPS au risque psycho-socio-organisationnel
Une augmentation importante de plusieurs pathologies dans le monde du travail, direc-
tement liées aux changements organisationnels, est observée depuis plusieurs années
(Davezies, 1999, 2005 ; Desrumaux, 2011 ; Desrumaux, Ntsame Sima & Leroy-Frémont,
2012 ; Jourdan, Antonmattei, Derue & Morand, 2010 ; Lerouge, 2009 ; Lhuiller, Giust-
Desprairies & Litim, 2010 ; Pezé, 2011 ; Truchot, 2010 ; Vézina, 2008, 2009). L’expression
risques psychosociaux ou son acronyme RPS ont été largement utilisés pour définir ces
réalités, qui connaissent hélas, une augmentation en termes de fréquence et de gravité.
Document téléchargé depuis www.cairn.info - Université de Liège - - 139.165.31.12 - 09/06/2015 14h24. © De Boeck Supérieur
Document téléchargé depuis www.cairn.info - Université de Liège - - 139.165.31.12 - 09/06/2015 14h24. © De Boeck Supérieur

@GRH • 13/2014
46
Selon Miossec et Clot (2011), « les risques psychosociaux constituent une catégorie
émergente pour désigner un ensemble de risques que le travail fait courir à la santé
psychique et somatique des travailleurs » (p. 342). Pourtant, l’appellation générique
« psychosociaux » utilisée pour définir ces risques soulève deux problèmes sans doute
liés. Elle ne fait pas consensus chez les chercheurs et elle occulte la référence à l’or-
ganisation du travail qui a une place pourtant centrale dans l’émergence d’atteintes
à la santé des travailleurs. De plus en plus visible ces dernières années, la réalité
sous-jacente à ce risque est identifiée depuis 1980 par Dejours. Cependant, la compré-
hension, le diagnostic et surtout le traitement de ce risque sont loin d’être acquis en
entreprise. Ces difficultés sont peut-être en partie dues à la confusion existant autour
des thèmes recouvrant le champ des RPS (Althaus, Grosjean, Brangier & Aptel, 2013 ;
INRS & CRAM, 2010 ; Nasse & Légeron, 2008 ; Ponnelle, Vaxevanoglou & Garcia, 2012 ;
Vallery & Leduc, 2012). Ughetto (2009) remarque que l’expression RPS a été utilisée,
notamment lors de la vague de suicide en 2009, comme un concept familier et ancien.
Ainsi, le qualificatif psychosocial, bien que vague, s’est institutionnalisé. L’utilisation de
l’appellation « RPS » ferait, dans ce cadre, consensus pour référer à des maux partagés
par un nombre croissant de salariés. Comme le remarquent Cru et Lapeyrière (2009),
« le seul fait de dire risques psychosociaux donne existence aux risques psychosociaux »
(p.136) alors que paradoxalement, l’utilisateur n’a pas clarifié ce qu’il désigne. Cette
confusion et ce manque de clarté autour de l’appellation RPS rendent son appréhension
moins aisée que d’autres risques professionnels (Gollac & Baudier, 2011). Nasse et
Légeron (2008) préconisent alors l’utilisation du terme risque « psychosocial » au singu-
lier, à l’instar du risque cardio-vasculaire, et l’utilisation d’une autre terminologie pour
aborder les causes, les manifestations et les conséquences. Il y a donc des causes, ou
facteurs de risque, des manifestations du risque (stress, épuisement professionnel,
etc.) ainsi que les conséquences qu’il pourrait entraîner (addiction, dépression, etc.).
Afin de mieux appréhender les réalités que recouvre l’expression RPS, plusieurs défi-
nitions apportent des informations complémentaires. De manière générale, les risques
dits « psychosociaux » recouvrent les risques professionnels qui portent atteinte à l’in-
tégrité physique et à la santé mentale des salariés. Ces risques sont « liés au mode de
conception, d’organisation et de gestion du travail, ainsi qu’à son contexte économique
et social » (Agence européenne pour la sécurité et la santé au travail (AESST), 2010,
p.7). Si bien que pour Miossec et Clot (2011), « les risques psychosociaux constituent une
catégorie émergente pour désigner un ensemble de risques que le travail fait courir à la
santé psychique et somatique des travailleurs » (p.342). Plus spécifiquement, les risques
dits psychosociaux peuvent être définis comme des risques qui « recouvrent en réalité
des risques professionnels d’origine et de nature variées, qui mettent en jeu l’intégrité
physique et la santé mentale des salariés et ont un impact sur le bon fonctionnement des
entreprises. On les qualifie de psychosociaux car ils sont à l’interface de l’individu et de
Document téléchargé depuis www.cairn.info - Université de Liège - - 139.165.31.12 - 09/06/2015 14h24. © De Boeck Supérieur
Document téléchargé depuis www.cairn.info - Université de Liège - - 139.165.31.12 - 09/06/2015 14h24. © De Boeck Supérieur
 6
6
 7
7
 8
8
 9
9
 10
10
 11
11
 12
12
 13
13
 14
14
 15
15
 16
16
 17
17
 18
18
 19
19
 20
20
 21
21
 22
22
 23
23
 24
24
 25
25
 26
26
 27
27
 28
28
 29
29
 30
30
 31
31
 32
32
1
/
32
100%