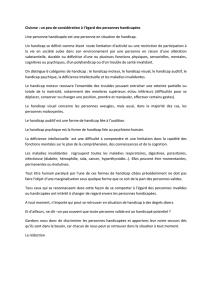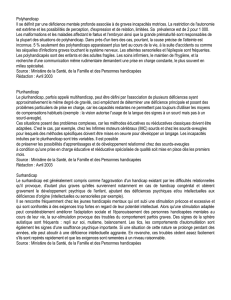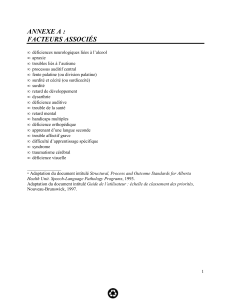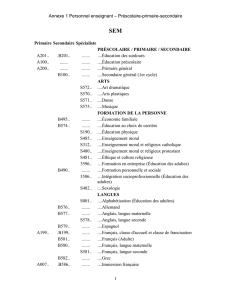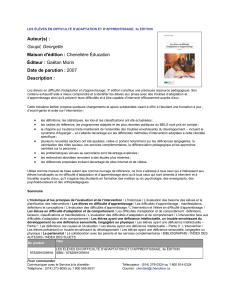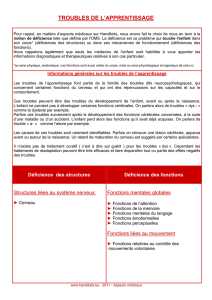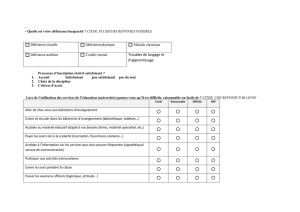Sport de haut niveau et handicap : jeux séparés, parallèles, handicap
Telechargé par
Begue Anaïs

UN SPORT DE HAUT NIVEAU ACCESSIBLE ? JEUX SÉPARÉS, JEUX
PARALLÈLES ET JEUX À HANDICAP
Anne Marcellini
ERES | Reliance
2005/1 - no 15
pages 48 à 54
ISSN 1774-9743
Article disponible en ligne à l'adresse:
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
http://www.cairn.info/revue-reliance-2005-1-page-48.htm
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Pour citer cet article :
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Marcellini Anne, « Un sport de haut niveau accessible ? Jeux séparés, jeux parallèles et jeux à handicap »,
Reliance, 2005/1 no 15, p. 48-54. DOI : 10.3917/reli.015.0048
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Distribution électronique Cairn.info pour ERES.
© ERES. Tous droits réservés pour tous pays.
La reproduction ou représentation de cet article, notamment par photocopie, n'est autorisée que dans les limites des
conditions générales d'utilisation du site ou, le cas échéant, des conditions générales de la licence souscrite par votre
établissement. Toute autre reproduction ou représentation, en tout ou partie, sous quelque forme et de quelque manière que
ce soit, est interdite sauf accord préalable et écrit de l'éditeur, en dehors des cas prévus par la législation en vigueur en
France. Il est précisé que son stockage dans une base de données est également interdit.
1 / 1
Document téléchargé depuis www.cairn.info - - - 81.253.73.42 - 05/10/2014 16h41. © ERES
Document téléchargé depuis www.cairn.info - - - 81.253.73.42 - 05/10/2014 16h41. © ERES

Comment penser un sport de « haut niveau »
de personnes dites « handicapées » au regard
d’un certain nombre d’incapacités les met-
tant, de façon répétée, en situation de handi-
cap dans les jeux sportifs classiques? Il semble
qu’il faille éclaircir en premier lieu cette
notion de « sport de haut niveau » pour pou-
voir discuter cette question. En effet, la diver-
sité des sens qu’on veut bien lui accorder
nous semble être, on le verra, au centre des
malentendus et des incompréhensions autour
du « sport de haut niveau des personnes han-
dicapées ». Pour commencer, nous parlerons
de sport de haut niveau pour désigner des
épreuves sportives nationales ou internatio-
nales auxquelles participe une élite consti-
tuée par le jeu de la sélection/élimination aux
niveaux inférieurs de la compétition.
D’un point de vue strictement théorique, on
peut alors avancer que si des personnes dites
handicapées dans la vie quotidienne peuvent
accéder au sport de haut niveau, c’est forcé-
ment dans une épreuve sportive qui se pré-
sente de telle manière qu’elle ne crée pas,
pour eux de situation de handicap par rap-
port à leurs adversaires. De multiples situa-
tions concrètes peuvent répondre à cela,
nous le verrons. Mais au-delà du raisonne-
ment théorique, l’idée de sport de haut niveau
pour des personnes handicapées semble
contenir une contradiction dont on a du mal
à se défaire, et qui la rend suspecte, voire
impertinente. Pour certains les compétitions
sportives de personnes handicapées ne sont,
UN SPORT DE HAUT NIVEAU
ACCESSIBLE ? JEUX SÉPARÉS, JEUX
PARALLÈLES ET JEUX À HANDICAP
Anne Marcellini
Laboratoire « Génie des procédés symboliques en
santé et en sport », JE n° 2416, UFR STAPS, université
Montpellier 1
© F. Meynaud
singulier à universel 5- 10/05/05 15:48 Page 48
Document téléchargé depuis www.cairn.info - - - 81.253.73.42 - 05/10/2014 16h41. © ERES
Document téléchargé depuis www.cairn.info - - - 81.253.73.42 - 05/10/2014 16h41. © ERES

SPORT DE HAUT NIVEAU ET SITUATIONS DE HANDICAP 49
au mieux, que des simulacres du « vrai » sport
que l’on valoriserait avec une once de com-
passion.
L’objet de cet article sera de mettre en évi-
dence à partir des différentes formes exis-
tantes de participation des personnes dites
handicapées à des compétitions de haut
niveau, les formes potentielles d’intégration
sportive non encore retenues par les organi-
sations dans la sphère du sport de haut
niveau. Nous essaierons alors de comprendre
les significations sous jacentes des choix de
pratique qui ont été faits, et d’analyser com-
ment, dans l’espace sportif, se construit de
façon singulière le processus d’intégration
sociale des personnes dites handicapées à
travers des pratiques compétitives de haut
niveau.
Cette analyse pourrait ouvrir des pistes de
réflexion sur les différentes conceptions pos-
sibles du sport de compétition des personnes
présentant des incapacités au regard de la
norme, et sur les intérêts mais aussi les limi-
tations que crée l’adhésion au monde du
sport de haut niveau, en termes d’intégration
sociale de ces publics spécifiques.
Les pratiques physiques
des personnes en situation
de handicap : d’une logique
rééducative à une logique
sportive
L’histoire des pratiques physiques des per-
sonnes présentant des déficiences souligne la
forte valence médicale et rééducative de
leurs débuts. Un processus progressif de
sportivisation, marqué par l’organisation asso-
ciative puis fédérale de ces pratiques, est
ensuite repérable particulièrement dans les
20 dernières années. La gymnastique médi-
cale et orthopédique, la rééducation fonc-
tionnelle, puis l’éducation physique adaptée
développées au sein des institutions spéciali-
sées dans l’accueil des jeunes déficients se
sont vues en quelque sorte complétées dans
les dernières décennies par une offre de pra-
tique au sein d’associations sportives s’affi-
liant progressivement au monde sportif et
reconnues par celui-ci sous la forme de fédé-
rations multi-sports1. Ce déplacement vers le
milieu sportif contenait, dans sa logique
même, le développement d’une perspective
compétitive et éventuellement d’un secteur
de haut niveau, puisqu’il signifiait l’affiliation
idéologique à l’institution sportive. Cependant
il a été l’objet de multiples débats2, plus ou
moins virulents selon les fédérations, mais
particulièrement vifs au sein de la Fédération
Française du Sport Adapté.
Aujourd’hui l’organisation paralympique
représente de façon centrale cette orienta-
tion internationale vers le sport d’élite des
fédérations sportives de personnes handica-
pées, qui se construit dans un redoublement
de l’événement olympique dont l’ampleur et
la médiatisation ne cessent d’augmenter,
même si cette dernière reste encore limitée.
L’institutionnalisation d’une telle pratique
sportive de haut niveau s’est construite pour
part sur le modèle du sport « valide », tout
en tentant de créer les conditions d’une
équité dans les épreuves pour des individus
présentant des capacités des plus diverses.
Elle est alors le lieu à la fois de la reproduc-
tion d’un modèle sportif élitiste classique, et
celui de la construction originale de catégo-
>>>
1. Pour un développement plus précis de cette institutionna-
lisation sportive selon les différents groupes de personnes
déficientes voir D. Séguillon, 1998, A. Marcellini et coll. 2000.
2.Voir par exemple le texte de Henri Miau, 1991, directeur
technique national de la Fédération française de sport adapté,
ou encore celui de Serge Bluteau, 1991, alors conseiller tech-
nique national de cette même fédération.
singulier à universel 5- 10/05/05 15:48 Page 49
Document téléchargé depuis www.cairn.info - - - 81.253.73.42 - 05/10/2014 16h41. © ERES
Document téléchargé depuis www.cairn.info - - - 81.253.73.42 - 05/10/2014 16h41. © ERES

50 RELIANCE - N° 15
ries et d’épreuves sportives inédites. C’est ce
que nous voudrions développer maintenant
en insistant sur les principes d’organisation
retenus pour mettre en œuvre ce sport de
haut niveau des personnes handicapées, mais
en insistant également sur ceux des principes
qui ont été rejetés.
Le haut niveau, le spectacle
et le jeu de l’incertitude :
la production des catégories
à partir des différences
du corps biologique
Si l’on se demande quels sont les principes et
règlements mis en place pour ces confronta-
tions sportives de sujets présentant des inca-
pacités, une première réponse est celle de
l’adaptation des sports classiques aux capaci-
tés des sujets, pour les leur rendre acces-
sibles (simplifier les règles si elles s’avèrent
trop complexes pour certains, réduire le
nombre de joueurs sur le terrain, autoriser
l’utilisation d’engins, augmenter les pas ou les
rebonds de balle autorisés etc.).
Mais pour construire un système compétitif
visant à produire une élite, c’est le problème
de la diversité des capacités et incapacités des
sujets qui doit être traité. En effet, l’incertitude
de l’issue de la rencontre, aspect central du jeu
sportif et de son attrait ensuite en tant que
spectacle, doit être maintenue dans chaque
épreuve, en même temps que la possibilité de
participation de tous, au départ, en fonction de
ses capacités et incapacités. Le sport ordinaire
s’est déjà posé des questions identiques pour
gérer certaines différences des athlètes: âge,
poids, sexe essentiellement, et y a répondu en
créant des catégories et des épreuves paral-
lèles. On a donc, dans le sport classique, des
athlètes de haut niveau catégories « jeunes »
ou « espoirs »3, sélectionnés dans des cham-
pionnats séparés de ceux des adultes, comme
on a des champions hommes et femmes dans
quasiment tous les sports, ou encore des
médailles olympiques pour chaque catégorie
de poids dans certains sports.
Personne ne songe à s’étonner d’une telle
catégorisation des épreuves, construite sur
les différences du corps biologique des sujets,
tellement elle est inscrite comme évidence
du système sportif de haut niveau. On s’éton-
nerait plutôt de son absence dans les cas
rares où cela existe, comme par exemple en
équitation, ou dans les courses au large à la
voile, lorsque l’expérience de cavalier ou de
marin semble pouvoir prendre le pas sur la
distinction biologique entre hommes et
femmes.
La catégorisation mise en place pour les
épreuves sportives des personnes handica-
pées suit souvent cette logique instituée de la
classification renvoyant au corps biologique,
et passant par des indicateurs mesurables des
différences entre les individus. Pour les diffé-
rences entre personnes handicapées, c’est la
mesure de la déficience qui s’est bien souvent
imposée comme critère de distinction, don-
nant lieu à la mise en place d’une classifica-
tion médicale sur laquelle s’organise le sys-
tème des catégories sportives4. Mais la classi-
fication médicale présente un inconvénient
majeur, celui de pouvoir être détaillée quasi-
ment à l’infini au regard de la diversité des
types de déficience et de leur gravité. Elle a
ainsi produit, en ce qui concerne les défi-
ciences motrices et physiques, une multitude
de distinctions selon la mesure de la défi-
cience, qui dans le contexte sportif aboutis-
sait à un nombre très important de catégo-
ries sportives. De ce fait elle a parfois été
récusée, accusée de discréditer le sport han-
dicapé, et en particulier le secteur du haut
niveau, en offrant l’image d’une fausse compé-
tition où tout participant était finalement
médaillé. D’autre part, elle est souvent discu-
tée sur le plan des problèmes de validité de
la mesure de la déficience qui se posent (diffi-
culté des procédures de testing de la défi-
cience motrice, ou encore de la mesure de la
déficience intellectuelle).
On peut donc dire qu’en suivant le modèle de
la catégorisation sportive en vigueur dans le
sport de haut niveau ordinaire, les personnes
handicapées ont repris à leur compte la logique
dominante, ce qui semblait pouvoir garantir
leur assimilation dans le monde sportif. Ce
modèle a abouti aujourd’hui à des rapproche-
ments certains entre sport ordinaire et sport
des personnes handicapées, puisque certaines
fédérations unisport organisent des champion-
nats nationaux au sein desquels des épreuves
sont prévues pour différentes catégories de
singulier à universel 5- 10/05/05 15:48 Page 50
Document téléchargé depuis www.cairn.info - - - 81.253.73.42 - 05/10/2014 16h41. © ERES
Document téléchargé depuis www.cairn.info - - - 81.253.73.42 - 05/10/2014 16h41. © ERES

SPORT DE HAUT NIVEAU ET SITUATIONS DE HANDICAP 51
handicap5. Par ailleurs les sportifs handicapés
constituant l’élite des fédérations sportives
Handisport et Sport adapté s’entraînent sou-
vent à la fois au sein de ces fédérations spéci-
fiques et dans des clubs sportifs classiques,
cherchant à progresser en partageant leurs
séances de travail avec des sportifs au meilleur
niveau de leur discipline6. C’est ainsi un rap-
prochement au quotidien qui s’effectue par le
biais du sport d’élite.
Cependant la mise en œuvre de ce principe
catégoriel génère un certain nombre d’effets
que l’on pourrait regretter, dans le sens où il
génère inévitablement des jeux séparés ou
parallèles, et non des pratiques mixtes. Cette
séparation crée une hiérarchie des catégories
instituées, hiérarchie dans laquelle les athlètes
handicapés sont le plus souvent moins perfor-
mants, de façon comparée, que les athlètes
« valides ».Tout se passe comme si la perfor-
mance brute signait l’organisation hiérarchique
des catégories7, réaffirmant ainsi le « manque »
de certains en lieu et place de leur différence.
Mais, au-delà de l’organisation de catégories,
d’autres principes semblent plus à même de
donner aux sportifs handicapés aspirant au
haut niveau une place de leaders imbattables.
L’annulation des situations
de handicap pour un « véritable »
sport de haut niveau
des personnes handicapées ?
Les situations de handicap que sont générale-
ment les sports classiques pour toute per-
sonne présentant une déficience, quelle
qu’elle soit, ont conduit, au-delà de la sépara-
tion catégorielle, à une autre logique de parti-
cipation sportive, plus affirmative, plus com-
munautaire aussi vraisemblablement, qui
consiste à transformer de façon radicale un
sport classique, qui peut être vu comme un
nouveau sport, en créant les conditions de
l’annulation du handicap.
Annuler la situation de handicap dans un
sport peut se faire de différentes manières,
d’un point de vue théorique. On peut choisir
un sport classique dans lequel les capacités
qui sont limitées par la déficience n’intervien-
>>>
3. On notera d’ailleurs que la définition en âge de ces catégo-
ries est très variable selon les sports, et étroitement liée aux
capacités nécessaires pour accéder à la plus haute perfor-
mance dans la tâche sportive considérée.
4. Par exemple, le critère de définition d’un sportif de petite
taille (Fédération France Nano Sport) est celui d’une taille de
moins de 1,50m. Celui d’un sportif déficient intellectuel (INAS-
FID) est un QI de moins de 70… Il convient de souligner que
le passage d’indicateurs biologiques à des indicateurs de la
déficience mesurés et formulés numériquement produit en
même temps l’association entre déficience et corps biolo-
gique, ce qui est pour la déficience intellectuelle en particulier
assez regrettable, mais néanmoins très significatif.
5. Pour exemple, les championnats de France Open de nata-
tion ont accueilli en 2003 deux épreuves de sport adapté
(50 m hommes et femmes), et trois épreuves handisport.
6. Une enquête récente a montré par exemple que 75 % des
athlètes d’élite de sport adapté avaient une double pratique,
à la fois à sport adapté et dans la fédération délégataire cor-
respondant à leur sport d’élection (A. Marcellini et
R. Compte, 2004)
7. Les jeunes nageurs handisport d’élite, par exemple, compa-
rent leurs performances avec celles des nageurs valides,
constatant (pour certaines catégories) qu’ils peuvent
atteindre les performances des femmes valides, mais reste-
ront toujours en dessous de celles des hommes valides.
© F. Meynaud
singulier à universel 5- 10/05/05 15:48 Page 51
Document téléchargé depuis www.cairn.info - - - 81.253.73.42 - 05/10/2014 16h41. © ERES
Document téléchargé depuis www.cairn.info - - - 81.253.73.42 - 05/10/2014 16h41. © ERES
 6
6
 7
7
 8
8
1
/
8
100%