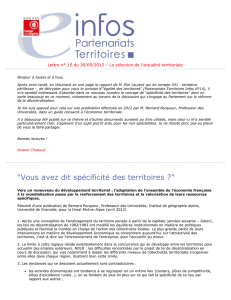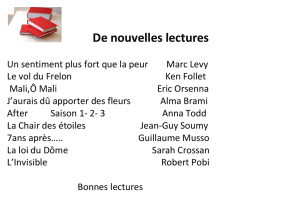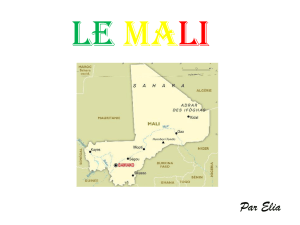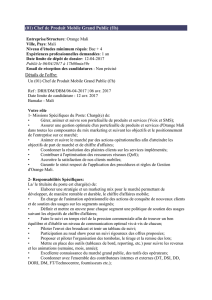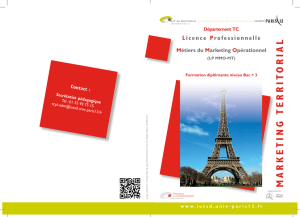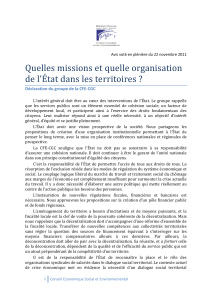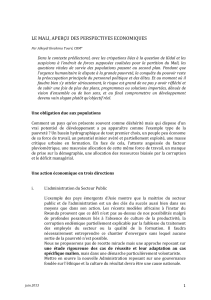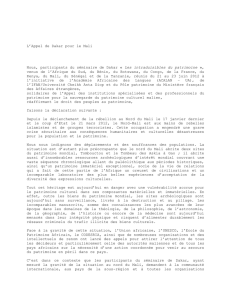Développement territorial au Mali : Analyse Genre - Thèse
Telechargé par
Salifou Koné

Salifou Koné-projet de thèse-Genre et Développement territorial au Mali
1
Projet de thèse
Analyse des déterminants du Développement territorial
Introduction
Mesurer l’effort de la femme dans le développement socioéconomique, n’est pas
chose aisée au Mali, surtout en milieu rural et ce pour des nombreux obstacles liés aux normes
sociales et à des stéréotypes que les sont attribuées par la société. Les rôles de
soumissionnaires, de gardiennes, de ménagères entre autres, font d’elles des actrices entrant
en second plan, dans les activités de développement. Plusieurs constats confirment cet état de
fait, à savoir les difficultés d’accès aux facteurs de production, le faible pouvoir décisionnel,
mais aussi une organisation incommode et inefficaces entre les femmes elles-mêmes. Ce cas
de figure est aussi fréquent chez les jeunes à la différence que les jeunes hommes sont enclins
à l’exode et à l’immigration, lorsqu’ils se sentent marginalisés.
Le corollaire de ce phénomène se situe à deux niveaux, rural et urbain. Au niveau
rural c’est la persistance de la pauvreté ; vu que nombre de femmes ne sont pas assistées
financièrement dans leurs activités ménagères. Elles s’occupent elles-mêmes des dépenses
afférent à l’alimentation familiale, à l’habillement et souvent mêmes à la santé des enfants.
Avec un taux de fécondité allant à 6,1 enfants, ce statut de dépensière met considérablement
la femme rurale dans une posture de pauvreté structurelle. Au niveau urbain, c’est la
croissance démesurée résultant d’un exode rural massif des jeunes, se traduisant par une
urbanisation anarchique accompagnée de la multiplication des zones d’exclusion. Le constat
qui en découle à ce niveau est que cette urbanisation excessive et démesurée empêche les
villes de jouer leur rôle de dynamisation économique. Pour cause, l’émigration par étapes au
niveau des villes moyennes rend absent ou faibles, les relations interurbaines (J. LAPEZ-
2014). Une dynamisation de développement des territoires basée sur une articulation
optimale entre aménagement du territoire, déconcentration et décentralisation tout en mettant
l’accent sur le genre, s’impose. Notamment la mise en place d’un système de gouvernance
favorisant les conditions financières, alimentaires et nutritionnelles, éducatives,
institutionnelles et organisationnelles des jeunes et des femmes.

Salifou Koné-projet de thèse-Genre et Développement territorial au Mali
2
Les Collectivités Territoriales, issues de la décentralisation, ont été armées dans le
but de faire face aux différentes problématiques liées au bien-être inclusif et durable. Car l’un
des grands enjeux de la décentralisation, est la participation des populations locales à la
dynamisation du développement socioéconomique et inclusive des territoires.
Pendant 20 ans, ces collectivités territoriales ont été mises à l’œuvre faces à ces
enjeux. Mais malgré cet état de fait, les résultats escomptés n’ont pas été à la hauteur des
attentes.
Le présent document, projet de thèse, donne des esquisses de cadrage des
investigations à mener pour analyser la dimension genre dans le développement territoriale à
travers une évaluation de la dynamique du développement des collectivités territoriales de
2000 à 2020. A ce titre, il a été rédigé en vue de l’inscription à l’Institut Universitaire de
Pédagogie (IUP) dans l’optique d’un possible encadrement des expertises Nord-Sud et de
mobilisation des ressources nécessaires.

Salifou Koné-projet de thèse-Genre et Développement territorial au Mali
3
Contexte et justification
Estimée à 19 973 000 hbts en 2019
1
, la population malienne est représentée à 49,6% par les
femmes et plus de 80% par les jeunes. Plus de 74% des maliens vivent en milieu rural et sont
plus touchées par la pauvreté.
Le Mali fut l’un des premiers pays en Afrique à s’intéresser à l’idée du développement des
territoires de par la mise en place des outils et actions de décentralisation et de développement
local; la finalité étant de palier la problématique de pauvreté au Mali. Cependant, il faut
reconnaitre que malgré la mise en place et l’adoption des politiques et actions de
décentralisation et de développement local, et ce, depuis l’avènement de la démocratie, cette
problématique demeure.
Plusieurs explications en lien avec la mauvaise gouvernance au niveau national, infranational
et local ont été évoquées.
La quasi-totalité des données statistiques (EMOP), affirment que l’économie du Mali
repose sur l’Agriculture et qu’elle emploi plus de 80% de maliens surtout en milieu rurale. Le
milieu rural qui abrite cette activité substantielle à hauteur de 85,6%, est malheureusement la
plus touchée par les phénomènes naturels et anthropiques, allant à l’encontre du bien-être
socioéconomique et environnemental. Au rang de ces phénomènes, on peut citer la pauvreté
économique et financière, l’insécurité alimentaire et nutritionnelle, la dégradation
environnementale, le chômage, etc.
Nombre d’auteurs admettent également que les femmes et les jeunes sont les plus exposés
à ces phénomènes ; surtout les femmes. Tout d’abords, elles sont piégées démographiquement
par l’abondance des enfants. A cause des occupations familiales, elles n’ont pas le temps pour
les activités économiques. Ensuite elles n’ont pas le libre accès aux terres cultivables, dû à
plusieurs facteurs que sont les us et coutumes, les spéculations foncières et la croissance
démographique (Oumarou I. -2008). Enfin, elles ne bénéficient pas d’accès aux services
1
Enquête Modulaire et Permanente auprès des ménages (EMOP-2019)

Salifou Koné-projet de thèse-Genre et Développement territorial au Mali
4
financiers, car les fond contractés sont insuffisants et ne permettent pas de générer de revenus
conséquents (DIOUF A.-2013 ; Oumarou I-2008). Quant aux jeunes, plusieurs facteurs leurs
incombent : Les travaux pénibles et sans revenus de l’agriculture et l’extrême pauvreté
2
, les
mauvaises perspectives d’emplois, dû à la situation socioéconomique du pays. A ceux-là
s’ajoutent les manques ou insuffisances des services sociaux de base (eaux potables, santé de
qualité et abordable, éducation pour tous).
Cependant, plusieurs statistiques affirment que les femmes et les jeunes, jouent et ont
un grand rôle à jouer dans la promotion de la sécurité alimentaire et nutritionnelle, dans la
valorisation des ressources locales et les services sociaux de base.
L’Etat malien, à travers ses actions de développement, à toujours pris en compte les
préoccupations des femmes et jeunes. L’une des actions les plus importantes fut la
décentralisation. La décentralisation qui est définie comme étant, une modalité d’organisation
institutionnelle de l’administration par laquelle l’Etat centrale transfère une partie de ses
attributions et moyens aux collectivités territoriales (KEITA et al, 2017), a été un moyen
préconisé, en réponse aux inégalités de bien-être, liées au genre, à l’âge et à l’espace ; dans
la mesure où l’une des ambitions de la décentralisation repose sur le postulat que la gestion de
proximité peut promouvoir le développement local inclusif et durable en optimisant la
mobilisation des énergies et ressources locales, souvent latentes, et en rationalisant les
décisions de dépenses, ce qui est source d’efficacité.
En effet, les collectivités territoriales, issues de cette démarche, qu’est la
décentralisation ont eu la charge, depuis leur création, d’accommoder les politiques et
programme de l’Etat aux réalités de leur territoire respectif. Il s’agit de promouvoir le
développement territorial à travers les outils/instruments juridiques, économiques,
institutionnels et financière qui leur ont été transféré. Il est également admis que l’Etat
encourage les organismes de coopération à opérer sur le territoire national pour la cause du
genre au Mali.
Cependant, malgré ces innombrables actions traitant les questions liées au genre,
l’autonomisation économique et financière des femmes et des jeunes, en milieu rural plus
particulièrement, restent toujours des défis à relever. L’analyse des indicateurs
sexospécifiques montre toujours un déséquilibre au niveau local, dans l’acquisition des terres
2
Les revenus générés par les cultures de rente, surtout le coton en zones cotonnières, sont monopolisés par les
chefs de ménages.

Salifou Koné-projet de thèse-Genre et Développement territorial au Mali
5
cultivables, dans l’accès au financement, aux pratiques entrepreneuriales, aux pouvoirs
décisionnelles, aux postes nominatives, dans l’exercice de certaines fonctions. Les
collectivités territoriales, étaient pourtant les mieux placées pour relever ces défis, eu égard à
leurs missions et prérogatives financières qui leur sont assignées par l’Etat centrale. Bref, les
collectivités territoriales sont considérées comme étant le noyau central dans la réussite du
pari du développement territoriale.
Le développement territorial, dont il s’agit ici, est le développement local enrichi par
l’intégration de trois dimensions essentielles, à savoir le territoire, les parties prenantes et les
usages des sols (Torre A.-2016). Il fait allusion à la production collective, résultant des
actions d’un groupe humain, avec les citoyens, ses dispositifs de gouvernance et son
organisation. Cette notion soutient que les territoires ne sont pas seulement des entités
géographiques. La finalité de tous ceux-ci est, l’acquisition du bien-être inclusif et durable et
que l’inclusive comprend en grande partie les femmes et les jeunes. Ce qui nous amène à faire
une analyse “genrée’’ dans la dynamique du développement territoriale au Mali, pour mieux
appréhender l’implication de l’action public et privé, face aux enjeux du développement
socioéconomique en milieu rural.
Revue de la littérature
Nombre d’auteurs (Guétat H et al-2015 ; Torre A., 2015, 2016 ; Courlet C.-2008 ;…) et
instituts de recherche (FAO-2011, CFSI-2019, RECOFEM-2007, CEDEAO-2018,…) se sont
beaucoup prononcés sur la dimension genre, sur les rapports entre femmes, entre femmes et
hommes, entre femmes et sociétés, le rôle de la femme dans l’économie nationale, rurale,
locale et international. Egalement il existe une large littérature pour ce qui est du
développement territoriale, du développement local, de la décentralisation, du développement
rurale. Mais très peu de ces écrits traitent de la dimension genre dans un processus de
développement territorial ; et ce, dans un pays avancé en matière de décentralisation en
Afrique de l’Ouest, retardé en matière de développement socioéconomique. Encore moins
lorsqu’il s’agit de faire une analyse de la dynamique de développement des collectivités
territoriales en lien avec les acteurs/trices et le territoire, selon les théories de l’économie
territoriale dans un contexte malien.
La notion de Genre et son évolution
 6
6
 7
7
 8
8
 9
9
 10
10
 11
11
 12
12
 13
13
 14
14
 15
15
 16
16
 17
17
 18
18
 19
19
 20
20
1
/
20
100%