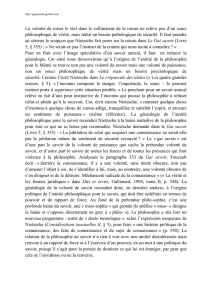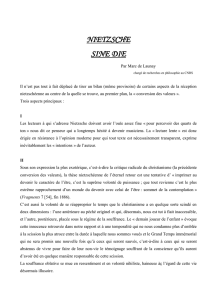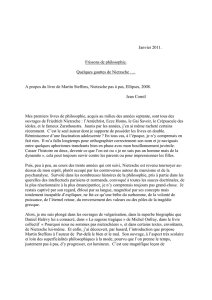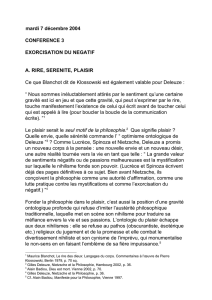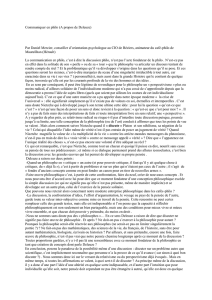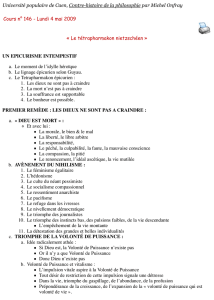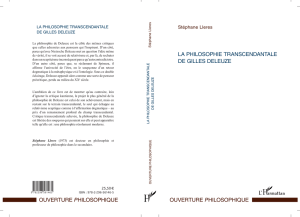Accueil Numéros 19 Analyses et interprétations Le Nietzsche de Deleuze : entre l...
Methodos
Savoirs et textes
19 | 2019 :
Dire et vouloir dire dans les arts du langage anciens et ta
Analyses et interprétations
Résumés
Français English
Dans cet article, nous revenons sur le premier moment de l'appropriation de Nietzsche dans le
parcours de Gilles Deleuze. Le livre Nietzsche et la philosophie (1962) s'inscrit de plein pied
dans une phase inédite de légitimation institutionnelle du philosophe allemand comme en
témoigne toute une série de stratégies de lecture et de prises de position stylistiques propres au
travail de Deleuze visant à constituer pleinement Nietzsche en philosophe, mais aussi ces
opérations de courts-circuits de différents champs de production culturelle (littéraire,
politique, « marginaux ») au sein desquels la lecture de Nietzsche était particulièrement
vivante durant la première moitié du XXe siècle. Restituer cette légitimation philosophique de
Nietzsche par le haut, c'est aussi se donner les moyens de comprendre la force et l'audace de ce «
second moment » (au début des années 1970 notamment) où Nietzsche, à l'inverse, devient chez
Deleuze le nom de ralliement d'un rapport hétérodoxe à la lecture des textes
philosophiques.
We came back in this article to the very first time in his career when Gilles Deleuze assimilated the
work of Nietzsche. The book Nietzsche and Philosophy (1962) was fully in line with an
unprecedented phase of institutional legitimization of the German philosopher. Indeed, the
reading strategy and stylistic stances specific to the work of Deleuze and which aimed at
recognizing Nietzsche as a philosopher can testify it, as well as his strategies of avoidance of the
different fields – whether literary or political – of cultural production in which the reading of
Nietzsche's work was particularly alive during the first half of the twentieth century.
Reporting this philosophical legitimisation of Nietzsch is also a way to provide ourselves with the
means of understanding the power and audacity of this ''second stage'' (particularly in the early
1970s) when Nietzsche conversely became for Deleuze the rallying figure of a heterodox
Libraries and institutions
OpenEdition Freemium
Our services
Follow us
Le Nietzsche de Deleuze : entre
légitimation institutionnelle et
mise en question de l'institution
philosophique
Nietzsche by Deleuze: between the institutional legitimacy to the questionning of the philosophical institution
BRUNO MEZIANE
https://doi.org/10.4000/methodos.5727

Texte intégral
Introduction
1. Une position d'historien de la
philosophie
1.1. Gravitas et celeritas
Nous interprétons ici la lecture que Deleuze propose de Nietzsche au début des
années 1960 en termes d'entreprise de légitimation institutionnelle. Il sera bien
question du texte et des concepts deleuziens, mais à travers eux, ce sont des stratégies
de lecture que nous chercherons à objectiver. Une telle objectivation implique
simultanément un effort d'historicisation – comme y invite la sociologie de Pierre
Bourdieu –, permettant de situer Deleuze dans le champ philosophique du moment et
ce afin de mesurer l'espace des contraintes (conceptuelles, stylistiques, idéologiques,
etc.) dans lequel ces stratégies de lecture jouent et pour en apprécier l'originalité voire
les effets subversifs qu'elles produisent. D'où nos références au couple conceptuel
bourdieusien du champ et de l'habitus ainsi qu'aux travaux de Jean-Louis Fabiani. En
effet, les enquêtes historiques de Fabiani sur la constitution du champ philosophique
français au XIXe siècle mettent au jour les cadres intellectuels fondateurs de
l'institution philosophique et certaines de ses oppositions structurantes. Plus que des
informations périphériques, ces enquêtes donnent les moyens d'interpréter la
dimension paradoxale – c'est l'idée que nous défendons à la fin de notre article –, de la
lecture deleuzienne de Nietzsche par rapport à l'institution philosophique.
1
Lorsque Deleuze fait paraître Nietzsche et la philosophie en 1962, il est maître
assistant à la Sorbonne, accompagnant l’enseignement magistral de Jean Wahl qui
étudie lui-même l’œuvre de Nietzsche à peu près au même moment. Ce poste fait suite à
une période d’enseignement dans les lycées d’Amiens et d’Orléans, entre 1948 et 1954,
puis en hypokhâgne à Louis-le-Grand, entre 1955 et 1957. Au moment où il enseigne à
la Sorbonne, Deleuze est, pour reprendre le terme d’une opposition structurante du
champ philosophique français1, un reproducteur, autrement dit, un commentateur de
textes encouragé sur la voie de l’histoire de la philosophie à la fin des années 1940 par
deux de ses maîtres académiques, Jean Hyppolite et Ferdinand Alquié. À l'exception
d'une monographie consacrée à David Hume et de deux longs articles consacrés à
Bergson, la plupart des écrits de Deleuze durant la décennie 1950 sont des comptes
rendus d'ouvrages publiés en majorité pour la Revue philosophique de la France et de
l'étranger. Quelques articles sur des livres d'Hyppolite, Alquié ou Bréhier montrent
aussi son intérêt pour un certain nombre de philosophes universitaires qui animent en
2

1.2. Un produit pédagogique
profondeur toute une série de débats épistémologiques portant sur le statut de l’histoire
de la philosophie en France. Cette identité savante d'historien de la philosophie
déterminera d'ailleurs toute la production de Deleuze, du début des années 1950 au
milieu des années 1960 au moins. Inscrit en doctorat au début des années 1950 sous la
direction d’Hyppolite puis de Maurice de Gandillac, Deleuze ne soutiendra ses deux
thèses (la principale et la secondaire) qu’à la fin des années 1960, soit presque dix ans
après Michel Foucault, François Châtelet ou René Scherer, titulaires comme lui de
l’agrégation de philosophie à la fin des années 1940. Suivant une à une les étapes du
cursus honorum (agrégé, enseignement dans le secondaire en province, retour à Paris
pour des postes courts dans le supérieur, longue thèse, retour définitif dans le supérieur
parisien après une nouvelle parenthèse en province), Deleuze semble avoir opposé sa
gravitas, « cette saine lenteur dont on aime à penser qu’elle constitue par soi une
garantie de sérieux »2, aux trajectoires apparemment plus hétérodoxes de certains de
ses pairs durant la décennie 1950 et le début de la décennie 1960, comme Foucault,
perçu alors comme psychologue d'orientation marxiste et phénoménologique ou
comme Kostas Axelos, marxiste et heideggerien, rattaché au CNRS puis à l'École
Pratique des Hautes Études en 1957, dirigeant la revue marxiste hétérodoxe Arguments
à partir de 1960 ainsi que la collection du même nom chez Minuit.
Nietzsche et la philosophie sera publié aux Presses Universitaires de France dans la
collection « Bibliothèque de philosophie contemporaine ». Il s'agit d'une collection
historique du champ philosophique français, lancée en 1864 par Jean-Baptiste
Baillière, reprise par Félix Alcan à partir de 1884 puis par les PUF en 1940. Fondant
d'avantage son unité dans l'imposition de normes et de critères scolaires d'exposition et
de traitement des questions que dans la constitution d'un consensus idéologique, cette
collection aura joué un rôle essentiel dans la transformation des professeurs de
philosophie en auteurs d’une production scientifique régulière, dépassant la seule
publication de la thèse de doctorat3. Nietzsche et la philosophie semble d'ailleurs, pour
une large part, être issu des cours que Deleuze donne à la Sorbonne sur le philosophe
allemand entre 1957 et 1960. Les premières lectures ainsi que les premiers usages
scolaires de Nietzsche dans le parcours de Deleuze pourraient bien remonter aux
années d'enseignement à Orléans entre 1954 et 1955 en classe de terminale et en classe
préparatoire. Mais le travail préparatoire de Nietzsche et la philosophie ne commence
sans doute qu'à la fin des années 1950, vers 1957, au moment où, pour la première fois
en France, un livre de Nietzsche (il s’agit de La généalogie de la morale) est inscrit au
programme de l’agrégation de philosophie, soit une cinquantaine d’années après son
inscription dans le programme d’agrégation d’allemand en 19034. Si par son lieu de
publication, par sa « matière » professorale, par le rapport étroit qu'il entretient avec le
programme de l’agrégation de philosophie de l'année 1958, l’ouvrage de Deleuze
s'apparente à un produit pédagogique, il contribue simultanément à une nouvelle
légitimation institutionnelle de l’auteur de La généalogie de la morale qui se poursuit
peu après avec l’introduction (elle aussi inédite) d’Ainsi parlait Zarathoustra dans le
programme du baccalauréat de philosophie. Non que Nietzsche ait été ignoré au sein du
champ philosophique français d'avant-guerre. Sa présence est massive dans la plupart
des champs de production intellectuelle (littéraire, philosophique, politique...) en
France entre 1890 et 1940, et, comme l'affirme Donato Longo dans sa thèse, elle n'a pas
d'équivalent, si ce n'est celle de Marx5. L'enquête de Longo rencontre sur ce point celle
de Jacques le Rider et de Laure Verbaere6 lorsqu'ils démontrent chacun de leur
côté l'ampleur exceptionnelle de la réception de Nietzsche en France à la fin du XIXe et
au début du XXe siècle. Si des philosophes pleinement académiques comme Alfred
Fouillé l'ont régulièrement discuté dans leurs travaux, si la revue principale du pôle
3

2. Un Nietzsche « scolastique »
2.1. Le jugement de Jean Wahl
« Jean Wahl représente le cas exceptionnel d’un individu couvrant à lui seul,
pendant une cinquantaine d’années, le spectre entier du champ philosophique,
et présent à la fois au sommet de l’institution et au cœur de l’avant-garde. Il eut
le projet de transcender les clivages qui structuraient le champ »10.
institutionnel du champ philosophique, La Revue de Métaphysique et de Morale,
compte parmi celles (avec la Revue bleue, la Revue blanche, Le Mercure de France) qui
totalisent le plus d'articles consacrés à Nietzsche ou l'évoquant au début du XXe siècle7,
une différence de taille apparaît à partir de la fin des années 1950 et du début des
années 1960 : à savoir que Nietzsche intègre les programmes d'enseignement de
philosophie via son introduction successive au concours d'agrégation de philosophie et
au baccalauréat. L'ouvrage de Deleuze s'inscrit pleinement dans ce processus
d'institutionnalisation. Il s'y inscrit et il y contribue. C'est bien sur cette contribution
deleuzienne à un tel processus de légitimation institutionnelle que nous souhaiterions
revenir avec cet article.
Produit pédagogique disions-nous plus haut à propos du livre de Deleuze. Dans
l'importante recension qu'il consacrera à l'ouvrage pour la Revue de métaphysique et
de morale, Jean Wahl ne dissimulera pas, cependant, un mélange d'admiration et de
malaise devant un exposé qu'il juge « trop scolastique »8. Deux ans auparavant, Wahl
avait publié ses propres cours de la Sorbonne consacrés à Nietzsche. Sa longue série de
commentaire de citations de Nietzsche s'attachait à montrer les tensions et
contradictions inhérentes à la pensée nietzschéenne, tensions et contradictions qu'il
voit disparaître dans l'exposé deleuzien au profit d'une série de forçages destinés, selon
lui, à construire un Nietzsche beaucoup plus philosophe qu'il ne l'est vraiment. Le
jugement de Wahl, maître académique de Deleuze au moment où celui-ci se formait à la
Sorbonne, à la fin des années 1940, nous intéresse à plus d'un titre. Il témoigne des
catégories de perception d'un membre formé dans un état antérieur du champ
philosophique. Mais il y a plus. L'hommage que Deleuze rendra à Wahl dans Dialogues
est aussi bref que remarquable. Il y salue moins un professeur ou un maître qu'un
philosophe aussi important et original que Sartre9. La comparaison avec Sartre souligne
implicitement la position exceptionnelle qui fut celle de Wahl dans le champ
philosophique français, position irréductible à sa place de professeur sorbonnard
comme l'a montré Isabelle Kalinowski :
4
Ce sont ces transgressions de clivage que Deleuze a sans doute en tête lorsqu'il loue
Wahl pour son rôle d'introducteur de la pensée anglaise et américaine en France, mais
aussi pour son style de pensée et d'écriture (il écrivit de la poésie et prit régulièrement
la littérature pour objet). En ce sens, le jugement de Wahl sur Deleuze nous intéresse
parce qu'il a l'avantage d'émaner d'un philosophe qui a tenté de couvrir l'ensemble du
spectre de ce champ et qui était par là-même bien placé pour mesurer l'originalité et les
audaces de la lecture deleuzienne. Du reste, Wahl ne découvre pas Nietzsche en 1958.
S'il ne lui consacre pas alors d'ouvrage majeur comme il le fit pour Descartes, Platon,
Kierkegaard ou Hegel, Nietzsche est présent dans la bibliographie wahlienne depuis les
années 1930 au moins : outre l'article dans le premier numéro de la revue Acéphale
intitulé « Réparation à Nietzsche » (1937), dans ses Études kierkegaardiennes (1938)
Wahl mobilise Nietzsche avec Kierkegaard dans une opposition à Hegel dont Deleuze
va hériter.
5

2.2. La critique du rationalisme en héritage
C'est en reprenant à son compte les catégories philosophiques de Wahl, celles de
« pluralisme » et de « pensée de la différence » qu'on trouve exposées dans ses travaux
sur la philosophie anglo-américaine et sur Kierkegaard, que Deleuze va asseoir la
philosophie nietzschéenne dans toute sa systématicité. Le pluralisme, présenté par
Deleuze comme « la manière de penser proprement philosophique »11, qualifie
doublement la pensée de Nietzsche et sa méthode généalogique. Cette philosophie
pluraliste est, d'un côté, une philosophie du sens capable d'interpréter la complexité du
réel, c'est-à-dire de rendre compte de la pluralité de sens d’un phénomène quelconque
au regard des forces, différentes en nature, qui cherchent à se l'approprier. D'un autre
côté, le pluralisme est un art de l’évaluation des vraies différences : tous les sens ne se
valent pas, il faut déterminer le type de volonté et les actes d'évaluation qui donnent sa
valeur au sens d’une chose. Cette détermination pluraliste est pensée dans une
opposition aussi essentielle que systématique à Hegel, à la dialectique comme réflexion
de la différence (ou pensée de l'opposition et de la contradiction) et à la philosophie de
la volonté comme pensée de la lutte pour la reconnaissance. Mais c'est sur le terrain de
l’histoire de la religion que Deleuze majore l’opposition à la dialectique hégélienne. À ce
niveau Deleuze motive fortement l'opposition Nietzsche-Hegel puisqu'il tient la théorie
de la mauvaise conscience développée dans La généalogie de la morale pour une ré-
interprétation volontaire de la conscience malheureuse de Hegel12. Au sein d'un tel
dispositif de lecture, l'apport de Wahl est particulièrement significatif puisque Deleuze
se sert explicitement de la présentation originale que Wahl avait donné de Hegel dans
Le malheur de la conscience dans la philosophie de Hegel, ce Hegel des écrits de
jeunesse, un Hegel d'avant la Logique et le système, méditant sur la pensée chrétienne :
« Derrière le philosophe, nous découvrons le théologien, et derrière le rationaliste, le
romantique »13. C'est à partir de cette interprétation que Deleuze peut opérer une
généalogie de la dialectique comme « pensée fondamentalement chrétienne »14, ainsi
qu'une typologie du dialecticien comme penseur « réactif », valorisant la tristesse, la
souffrance et le déchirement de la conscience. C'est à cet Hegel interprète du
christianisme que s'oppose en effet la généalogie nietzschéenne relue par Deleuze,
dénonçant dans la philosophie hégélienne de la religion une conception tronquée du
sens, de l'essence et du changement, comme en témoigne, selon Deleuze,
l'interprétation hégélienne et néo-hégélienne (Feuerbach en particulier) de la mort de
Dieu aboutissant aux permutations abstraites : l'Homme remplaçant Dieu,
l'anthropologie remplaçant la théologie, mais la place restant inchangée15. Le Hegel de
Wahl permet donc à Deleuze de mettre au jour l'affinité du rationalisme dialectique
avec la théologie chrétienne et, par contraste, de souligner l'athéisme philosophique de
Nietzsche16.
6
S'il est patent que Nietzsche et la philosophie hérite des premiers travaux de Wahl
sur les philosophies dites « pluralistes » (anglaises et américaines), et plus largement,
de sa position critique vis-à-vis du rationalisme philosophique, le livre donne à cette
critique une amplitude conceptuelle que Wahl ne pouvait reconnaître à Nietzsche. En
qualifiant l'exposé deleuzien de « scolastique », Wahl révèle en fait les conditions dans
lesquelles il a construit sa lecture de Nietzsche dans les années 1930. Soit à travers une
double médiation existentialiste, Karl Jaspers d'un côté, dont Wahl a lu et commenté le
Nietzsche ; Kierkegaard de l'autre, auquel Wahl a consacré une importante étude dans
laquelle la pensée de Nietzsche est régulièrement mobilisée. Suivant cette double
médiation, Nietzsche y est conçu comme « philosophe de l'existence » dont la pensée,
non systématique, est fondamentalement caractérisée par la contradiction ; un
« éducateur » et un poète après lequel on ne peut plus vivre dans la continuité de la
« tradition conceptuelle »17. Or, à l'inverse de Wahl, Deleuze comprend
l'« irrationalisme » nietzschéen comme pensée conceptuelle, capable de rivaliser, du
point de vue de la méthode et de la précision systématique, avec Hegel et de dépasser sa
7
 6
6
 7
7
 8
8
 9
9
 10
10
 11
11
 12
12
 13
13
 14
14
 15
15
 16
16
 17
17
 18
18
 19
19
 20
20
 21
21
1
/
21
100%