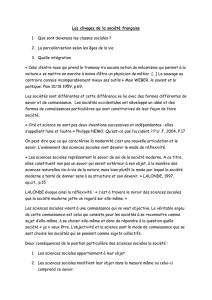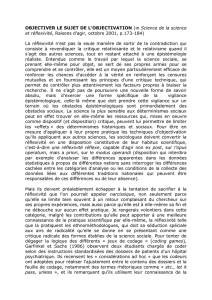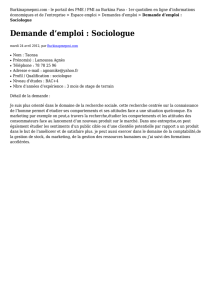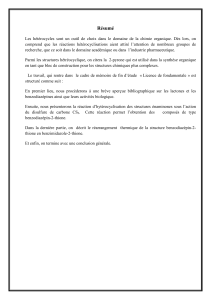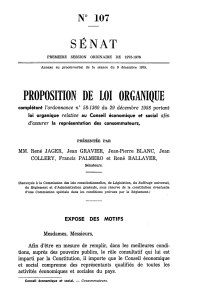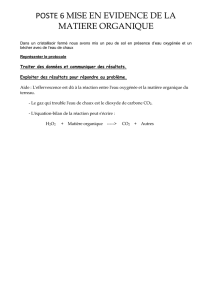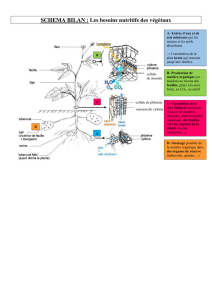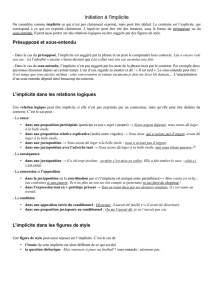Corps et Corps Social*

Corps et Corps Social
Henri-Pierre JEUDY
Le célèbre metteur en scène japonais, Ozu, a choisi comme acteur principal de ses films, Chishu Ryu
dont le visage est aussi déconcertant que la pleine lune un soir d’été après l’orage. Même l’annonce de la
fin imminente du monde ne ferait pas changer ce sourire qui acquiesce avec un bonheur inébranlable à
tout ce qui advient. Tout simplement, semble-t-il, pour la raison que ce qui advient serait déjà ce qui est.
Rien ne fait disparaître son sourire. Même dans les moments les plus douloureux, dans « Voyage à Tokyo »,
son sourire est encore là. On pourrait penser que Ryu n’est jamais vraiment affecté, qu’il est parvenu à une
telle sagesse qu’il vit presque au-delà des sentiments humains. Bien au contraire, toute sa puissance
affective est contenue dans son visage, en ce sourire qui ne s’éteint pas. Pas l’ombre d’une démission !
Cette expression d’un « il en est ainsi » ne signifie pas la résignation, elle donne corps à la manière de se
moquer du consentement perpétuel en exaltant le fait irréductible d’être au monde tout en n’y étant pas.
Pas le moindre soupçon d’un mouvement dialectique ! Ce qui se transforme au rythme du temps qui
s’écoule, passe par la seule voie du sourire. L’absence d’intervention n’est pas le refus d’intervenir : il y a
cette façon de s’immiscer dans le cours des choses qui agit par la seule passion de vivre. Une étrange
union entre l’émerveillement et la mort, comme si le dénouement se suffisait à lui-même sans subir une
autorité qui lui imposerait son sens.
L’indifférence prise à son propre piège, déjouée dès son origine, rendue victime de sa parodie.
L’équivalence soumise à la loi du sourire. Le « comme si » devenu un « il en est ainsi ». Plus besoin de
moralisme : ce qui est retors n’a plus lieu d’être. Les échanges de regard, les gestes les plus infimes, les
paroles les plus simples, tout ce qui fait l’existence la plus quotidienne est mis en œuvre par le visage de
Ryu. Il n’y a pas un détail qui manque, rien n’échappe à la sérénité simiesque d’une pareille expression
des mouvements de la vie. L’oubli définitif de la distinction entre l’être et l’apparaître. Si tout s’équivalait
en ce qui advient, son sourire disparaîtrait. Ryu ne pose pas son regard sur le monde et sur la vie, avec
cette distance d’une infinie tendresse, ce sont le monde et la vie qui se reflètent en lui. Contre l’apologie
de l’extase, si chère à nos littérateurs occidentaux, Ryu affiche une grâce majestueuse. Puisqu’il en est
ainsi, ce qui doit être n’est plus un devoir. Ce que j’imagine devoir faire s’impose comme un « je dois » qui
se dispense de toute représentation de mes obligations morales. En quelque sorte : une nécessité à l’état
pur, une nécessité qui advient de la contingence absolue. Pas l’ombre d’une quelconque transcendance,
cette ombre qui, s’évanouissant, apporterait la lumière du Bien et la complaisance éthique. Ni cette
béatitude sournoise du devoir accompli, ni cette jubilation d’une cruauté masquée. Une étrange tendresse
qui a vaincu le cynisme, cette tendresse que l’immanence de la nécessité révèle contre tout penchant à la
mièvrerie humaniste.
Le corps nous délivre des stéréotypes du langage. Les sentiments et les émotions qu’il manifeste
présentent la naissance énigmatique du sens au moment même où l’octroi de leur signification se plie aux
conventions de l’interprétation. Quand il est énoncé, le stéréotype réduit à une désignation péremptoire
l’ambivalence affective qu’il contient encore. Le corps n’est pas le lieu d’un autre langage, mystérieux,
d’un langage qui prendrait forme « avant les mots », il met en abyme la construction du sens en affichant
Mots-clefs: réflexivité, soi organique, l’implicite
Sociologue au Centre National de la Recherche Scientifique.
October

une permanence organique de la contingence. Les visages de l’enfant et du cadavre persistent au fil du
temps comme l’arrière scène vivante, et pourtant pétrifiée, des expressions du corps. La jubilation
innocente et l’horreur séduisante de la mort.
1. Les apparences corporelles
L’accomplissement de la pensée, le travail de la rationalisation sont encore considérés comme la
manifestation même du passage de la singularité de l’intuition à la généralité du concept. Tantôt la
conceptualisation de la chose précède l’intuition puisqu’elle rend préalablement possible sa perception,
tantôt l’appréhension de la chose antécède sa représentation. Du coup, et de manière très stéréotypée, le
concept est tenu pour le symptôme d’une réduction des intuitions et pour le signe d’une ascension de la
pensée. Or, la représentation relève autant de l’intuition que du concept . Comment puis-je avoir une
intuition sans me la représenter telle qu’elle m’apparaît ? Dans un monde où règne l’impératif de la
communication, la rationalité du concept est glorifiée à des fins pragmatiques. Le sentiment ressenti ne
prend valeur d’existence que dans la mesure où il est verbalisé. Son objectivation entraîne pourtant la
certitude de sa réduction puisqu’elle ramène le jeu complexe des sensations et des intentions au modèle
de sa formulation. Si expliquer un sentiment est toujours une manière de restreindre ce qu’on ressent, en
préférant le taire, on préserve comme une illusion vitale, l’aspect ineffable de notre sensibilité immédiate.
Dans le domaine médical, c’est une tradition de considérer que l’état du patient représente le concept
de sa maladie et que l’ensemble des symptômes reconnus conforte la pertinence du nom donné à cette
même maladie. Le diagnostic consiste à faire croire au passage d’une description phénoménale de la
maladie à sa nosographie alors que, bien entendu, le concept lui-même est déjà là, prêt à subsumer les
sensations du patient qui, de son côté, s’acharne à manifester les signes tangibles de sa douleur. Il faut en
quelque sorte que la maladie soit elle-même irréalisée par son concept pour que les soins appropriés
puissent être entrepris. La souffrance du patient est une représentation que le concept de son état
pathologique ne désigne pas. Sa colère, provoquée par l’occultation de sa douleur, sera malvenue puisque
les causes et les effets de ses troubles confirment ce que le savoir médical a déjà pronostiqué. Une
vocation thérapeutique implicite est ainsi prêtée au concept. Elle suppose la soumission de la
représentation à son pouvoir d’abstraction. Le concept semble alors infliger un démenti thérapeutique à la
représentation de la souffrance. Il irréalise, par son abstraction formelle, ce que le patient croit être la
réalitémêmedesadouleur.
La psychosomatique anéantit la puissance des signes du corps en instaurant le principe de leur lecture
par le jeu de relations causales. Elle sépare le corps du langage pour fonder l’existence organique du
symptôme et en assujettir les effets à des formes de causalité qui légitiment le travail de l’interprétation.
L’hypothèse d’un Soi organique implique au contraire l’absence de séparation entre le corps et le langage:
l’apparente inadéquation entre l’un et l’autre, produite par la domination qu’exerce le pouvoir
d’objectivation du langage, masque leur connivence implicite qui, elle, se moque de la rationalité de
l’interprétation. La psychosomatique a toujours un aspect tragi-comique parce que l’évidence trop
excessive d’une relation causale entre le corps, le comportement et le langage anéantit de manière
souvent benoîte les charmes cruels de l’ambivalence affective. Elle fait des signes du corps l’objet même
du langage, elle use d’un vocabulaire finaliste qui prédétermine ce que le corps manifeste pour signifier
l’expression objective de son énigme. Elle accentue la visibilité des signes comme les preuves tangibles de
On connaît les propos célèbres de Nietzsche: « chaque mot devient immédiatement un concept par le fait que,
justement, il ne doit servir comme souvenir pour l’expérience originelle, unique et complètement singulière à
laquelle il doit sa naissance, mais qu’il doit s’adapter également à d’innombrables cas plus ou moins semblables,
autrement dit, en toute rigueur, jamais identiques, donc à une multitude de cas différents. Tout concept naît de
l’identification du non-identique » (Vérité et mensonge au sens extra-moral, pp. 14 15, Babel)

son interprétation. Quand elle dit : « si j’ai mal au dos, c’est parce que j’en ai plein le dos », la
psychosomatique se fait caricaturale, elle signale ses propres limites en se jouant de la causalité comme
d’une tautologie hyperréaliste. Sa fatuité la rend elle-même parodique. Le Soi organique ne dépend ni des
interprétations d’un Moi qui gouvernerait les manifestations du corps, ni des discours objectifs qui sont
tenus sur les comportements ou les postures du corps. Il est ce qui advient du corps au fil du temps
comme l’expression d’une mémoire qui nous échappe et que pourtant nous avons formée.
Entre l’intérieur et l’extérieur du corps s’élabore une réversibilité visionnaire. Tantôt l’intérieur s’exhibe à
l’extérieur, tantôt l’extérieur devient interne et forge le secret, ce qui se dérobera momentanément au regard de
l’Autre. Les liens de causalité établis entre l’extérieur et l’intérieur peuvent paraître invraisemblables ou
même disparaître sans que pour autant le rapport entre ce qui est visible et ce qui ne l’est pas annule ce
jeu de la réversibilité visionnaire. Le savoir médical ne sert qu’à mesurer la vraisemblance des analogies et
de la correspondance des liens de causalité. Il ne menace pas la puissance des images, il entraîne leur
métamorphose. La vérité qu’il signifie comme “scientifique” ne fait que relancer indéfiniment la dynamique
de l’endoscopie imaginaire. Ce qui n’est pas visible, ce qui se passe à l’intérieur du corps est rendu
accessible à la représentation par la radiographie qui devient elle-même une source intarissable d’images.
Plus la connaissance médicale progresse, plus elle active l’imaginaire du corps grâce au perfectionnement
technologique de son examen interne. Ce que nous confirme les plus hautes technologies de l’aperception
interne du corps, c’est la capacité étonnante de notre endoscopie imaginaire à nous offrir la représentation
partielle du Soi organique --- c’est-à-dire des manières dont le corps organise ses propres défenses. Ce qui se
passe au-dedans n’est pourtant pas l’image virtuelle de ce qui se passe au dehors, car la vie intérieure du
corps n’est pas destinée à être rendue lisible par ses manifestations extérieures. En somme, la réversibilité
visionnaire suppose la distinction dedans!dehors pour mieux la supprimer. Le Soi organique règle la
contingence en l’exaltant alors que la façon d’imaginer un équilibre corporel se soutient traditionnellement
d’une maîtrise des tendances suicidaires que provoque toute exacerbation de la contingence.
Nous croyons lire sur le visage l’expression des tensions internes du corps. Si le regard des autres
m’incite à me représenter tel que j’apparais, je ne suis pas pour autant le seul auteur de l’image que je
crois me donner. Quand je songe à quelqu’un que j’aime bien, je le vois comme un personnage, sans avoir
la moindre assurance de pouvoir lui dire la manière dont je le vois. L’image qu’il me donne ne m’échappe
pas, elle se fragmente et je la retrouve entière quand je pense à lui en marchant ou en m’éveillant. Que ce
soit la sienne ou que ce soit la mienne, notre image ne nous appartient pas entièrement. Travailler son
look, apprêter ses atouts, s’entraîner à capter le regard des autres, voici autant de tactiques parmi d’autres
encore qui nous laisseraient croire que le destin de notre image reste entre nos mains. A la différence des
immeubles neufs construits derrière une façade du dix huitième siècle bien conservée, la façade du visage
ne cache rien, elle contient les tourments et les enthousiasmes, le rayonnement des illusions et l’obscurité
du désespoir, elle est ce qu’elle est, et derrière elle ne reste que ce qui a déjà paru. L’allure galvanisée ou
le sourire fatigué ne sont que les signes de ce qui est là pour avoir déjà été. Je peux faire tous les efforts
possibles pour être gai quand je suis las, pour être exalté quand je suis abattu, rien ne changera le fait que
la lassitude donnera une certaine image à mon exaltation passagère. De cette alliance représentative des
états d’âme les plus opposés naîtra le vertige d’un charme malmené.
Ce qui reste surprenant, c’est la manière dont les expressions acquises gardent leur puissance active,
comme un volcan qui ne crache plus de feu mais dont les fumerolles laissent à penser qu’il n’est pas
définitivement éteint. Elles dévoilent notre passif, le plus souvent pris pour l’unique raison d’un acte. On
dira : « c’était inscrit sur son visage ». La tête de l’emploi signale que l’apparence physionomique est
conforme à l’acte qui vient d’être perpétré. On dit quand on voit un meurtrier sadique à la télévision qu’on
n’aimerait pas le rencontrer au fond d’un bois parce qu’on présume qu’il a la tête de ce qu’il fait. On dira
également d’un fonctionnaire tatillon qu’il a la tête de son emploi, surtout quand il travaille dans les
October

douanes, qu’il porte des lunettes à double foyer, qu’il dépose tout ce qu’il touche sur une longue table en
énumérant les objets tandis que s’écoule le temps de la fouille au rythme de ses commentaires et de ses
silences. La tête de l’emploi unit le passif de nos expressions corporelles aux actes présents. Si toutes nos
réactions étaient déjà inscrites sur notre visage, la vie pourrait devenir infernale puisqu’une quantité de
traces indélébiles seraient là pour figurer un passif contre lequel nous ne pourrions plus rien.
Le souci de maintenir la façade d’une harmonie victorieuse des tensions du corps est communément
devenu le modèle social du flegme. Pareil modèle implique de démontrer aux yeux des autres le
surpassement de la résignation par le contrôle des troubles émotionnels. Ce qui prévaut alors, c’est le
vieillissement prématuré. Il faut vieillir au plus vite pour que règne l’apparence froide de l’équilibre des
tensions. Point de commune mesure avec la sagesse ; il en va de l’anéantissement pur et simple de la
contingence. On dénigre les hommes et les femmes qui n’acceptent pas leur âge parce qu’ils veulent
démontrer que l’âge lui-même n’a pas d’âge. Sont-ils aussi insensés qu’on se l’imagine ? On entendra dire
qu’on a l’âge de ses artères, de la même manière qu’on a l’âge de ses organes ou celui de ses neurones. Et
on conseillera aux personnes du troisième âge de remplacer leurs débordements sexuels par l’exercice
d’une tendresse infinie qui ne manquera pas de leur apporter un repos bien mérité. La représentation
sociale de l’âge semble bien calée sur des limites physiques reconnaissables. Seule compte la limite d’âge.
Est-ce l’âge qui, de lui-même, impose des limites ? Comparable à l’horizon, l’âge recule chaque fois qu’on
l’approche parce qu’à vrai dire on n’en a aucune représentation autre que celle des limites que nous lui
attribuons. Et pour preuve : le vieillard à l’article de la mort vit bien souvent dans son enfance qui ne l’a
jamais quitté. Kant est mort âgé en se branlant. L’usure du corps n’est que le constat d’un mauvais calcul.
L’estimation des limites permet de rester convaincu publiquement et moralement qu’un enfant amoureux
d’un autre enfant écarte tout soupçon de pédophilie ou que le vieillard amoureux d’une vieillarde réjouit
une humanité friande de bienséance. Au regard des convenances sociales, les attributs du corps
correspondent à des périodes successives de la vie que seule nie la présence tenace des images de
l’enfance toujours tardive.
2. Le corps social pris comme un corps malade
Ce qui nous sidère, c’est la méfiance dont le social fait l’objet. Il est tenu pour si malade qu’il est
appelé à subir tous les traitements thérapeutiques susceptibles de lui redonner une santé. Il devient ainsi
l’alibi d’une gestion dont la nécessité et la finalité paraissent indiscutables. Le social est pris dans des
procédures de réflexivité qui lui donnent le sens de sa destinée, de son évolution possible. Il est assimilée
à cette « réalité sociale » que les sociologues étudient en la construisant, en la façonnant afin que les
manifestations « vitales » du social soient toujours des symptômes de ce qui ne va pas dans un « corps
social ».
La maladie du lien social est la «condition d’être »du sociologue. On pourrait faire une hypothèse
inverse en considérant ce qui échappe à l’objectivité de l’interprétation sociologique, et, par voie de
conséquence à ce fameux principe de réflexivité. L’ensemble des conventions régissant les rapports
sociaux dans la vie quotidienne se prête à des analyses qui évacuent toute manifestation implicite des
attitudes et des comportements comme si l’incongruité du geste, du regard était d’emblée prise pour le
signe d’une pathologie de la sociabilité. Cette méfiance à l’égard de ce qui produit un effet d’effraction
dans la logique attendue des comportements suppose que le corps, de par lui-même, ne soit pas considéré
comme un « être-là social ». Toute expression du corps demeurant soumise à la reflèxivité, si elle n’est pas
conforme à la normativité des règles usuelles de la communication, relève aussitôt d’un symptôme qui
annonce un malaise de « l’être social ». Nous nous trouvons souvent dans des situations où justement notre
corps nous surprend comme si, d’une manière instantanée, il pouvait trahir une rupture dans le jeu des
conventions. A ce moment précis, nous ressentons combien notre corps est « en puissance », combien il vit

à l’épreuve d’une indécidabilité du sens donné à nos intentions. Cette incongruité peut surgir dans la
prolifération même des signes que délivrent les corps dans l’espace public, celle-ci étant provoquée par
l’excès et la contagion des signes. Ce qu’on prend pour un échec de la communication, ou pour un
symptôme d’une disruption du lien social, n’est, en fait, que le fruit d’une manifestation cohérente du
corps qui nous échappe. Prise au contraire pour une incohérence, pareille manifestation appelle une
solution thérapeutique, que celle-ci soit sociale ou culturelle.
Notre corps est hétéronome. Sans nom, puisqu’il n’est pas un unique personnage, il est, d’une certaine
manière, l’autre de nous même. L’incongruité de ses manifestations se joue de la pérennité apparente de
notre identité. C’est pourquoi dans la vie sociale, les malentendus constituent en eux-mêmes une forme
singulière de l’échange bien qu’ils apparaissent parfois comme des situations insensées. Toutefois,
l’hétéronomie de notre corps peut aussi bien apparaître dans les situations les plus conventionnelles. C’est
grâceàellequesemetenœuvre,unecertaine métaphoricité du corps, laquelle suggère d’étranges
dissonances dans les représentations sociales du comportement.
Qu’en est-il de cette métaphoricité du corps ? S’agit-il d’un jeu de substitutions qui épouse sa propre
logique et que figure un comportement tenu conventionnellement pour « pathologique » ? Le malentendu
peut prendre une allure tragique dans l’accomplissement du jeu même de la substitution, comme si notre
propre corps était capable de se jouer de nous. C’est la fameuse formule de « l’ironie du sort » qui traduit
cette mise en scène d’un retournement de situation que nous ne pouvons pas saisir dans une procédure
classique de réflexivité. D’une manière générale, ce phénomène est pris pour un « archaïsme mental » au
regard de nos impératifs coutumiers de rationalité. « L’ironie du sort »estuneformedeparodiedela
réflexivité.
Dans l’espace public, on est souvent pris pour ce qu’on n’est pas. Pour qu’une pareille substitution
s’impose comme une évidence, il faut que nous manifestions des signes qui la rendent possible. Des signes
qui, selon nous, auraient été mal interprétés. Je marche dans la rue, je crois reconnaître quelqu’un que j’ai
déjà vu, je m’approche de lui, je le nomme par son prénom et je constate brusquement ma bévue. Le
quiproquo peut devenir plus tragique lorsque je prends quelqu’un qui m’a dit la vérité pour un menteur.
Le fait d’être pris pour un autre entraîne quelquefois la destruction de toute une vie. Celui qui est pris pour
un criminel a beau crier son innocence, plus il le fera, plus il risque d’augmenter les soupçons contre lui.
Et ce en vertu de l’application psychologique d’une simple règle de la rhétorique : la dénégation est une
double affirmation. Si vous dites « je ne suis pas celle que vous croyez », vous attirez l’attention sur le fait
que vous pourriez l’être, vous êtes aussitôt soupçonnée de l’être. Bien plus : en croyant affirmer que vous
n’êtes pas celle que les autres pourraient croire que vous êtes, vous semblez confirmer de manière plus
affirmative encore que vous l’êtes. Lorsqu’on réclame avec véhémence de ne pas être pris pour ce qu’on
n’est pas, on se donne au contraire toutes les chances de finir par être pris pour ce qu’on croyait ne pas
être. Autant s’habituer à l’idée d’être pris pour ce qu’on n’est pas en pratiquant l’art de ne point se
présenter autrement qu’on est.
N’oublions pas que l’origine de la violence est souvent une méprise, et que toute méprise demeure
fondamentalement liée à une erreur d’interprétation d’un comportement. Ainsi la « bavure » outrepasse-t-
elle le champ d’exercice de la police en caractérisant le mode de fonctionnement de la gestion du social.
En somme, nous ne décidons pas vraiment de l’hétéronomie de notre corps. Ce que je veux signaler en
faisant référence à ces enchaînements pour le moins fantaisistes d’une telle métaphoricité qui unit le corps
au langage, c’est le fait que la vie sociale, individuelle et collective, ne cesse de créer des espaces
intermédiaires d’expression, lesquels échappent au processus de réflexivité qui tente de les réinsérer en les
tenant a priori pour pathologiques. Quand je parle de l’alibi du social, c’est bien dans la mesure où la
« maladie présumée du social » sert d’alibi à l’entreprise thérapeutique de la réflexivité sociologique
October
 6
6
 7
7
1
/
7
100%