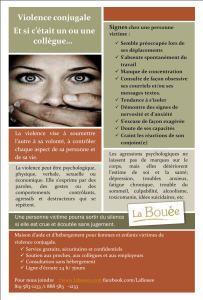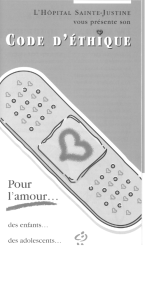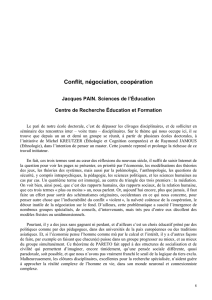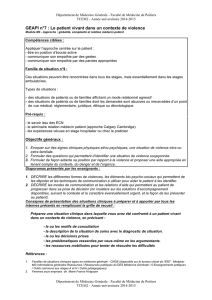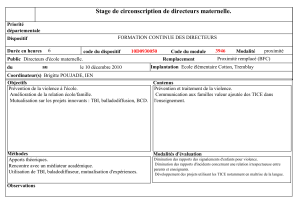Données de la littérature scientifique sur la violence au travail
Telechargé par
snajah20

271
Violence au travail
Arch Mal Prof Env 2006
JEUDI 1ER JUIN
8. La Boétie E. (de la) (2003), La servitude volontaire (1574),
texte mis en français moderne par C. Pinganaud, Paris : Arléa.
9. Hamraoui E. (2005), Servitude volontaire : l’analyse philoso-
phique peut-elle éclairer la recherche pratique du clinicien ?,
Travailler, 13, 35-51.
10. Barkat S.M. (2005), Le corps d’exception. Les artifices du
pouvoir colonial et la destruction de la vie, Paris : Éditions Ams-
terdam.
11. Barkat S.M. (2006), La dimension anthropologique et institu-
tionnelle du travail, à paraître.
12. Barkat S.M. (2005), « Enjeu anthropologique de la dimension
institutionnelle et politique dans le travail : le cas du suicide »,
Collège international de philosophie, 7 décembre 2005.
Données de la littérature scientifique
sur la violence au travail
G. LASFARGUES
Médecine et santé au travail, Faculté de médecine et CHU de Tours.
Introduction
Si des données sur la violence au travail sont présentes
dans la littérature scientifique, de nombreuses ques-
tions y sont encore peu ou non abordées, depuis la des-
cription et la connaissance des différentes formes de
violence, des facteurs de risque liés au travail ou à ses
modes organisationnels jusqu’aux évaluations des dif-
férentes modalités d’intervention en entreprise et de
prise en charge ou de prévention individuelle ou col-
lective.
Les définitions de la violence au travail sont plus ou
moins globales, en fonction de la référence à des actes
physiques contre les autres ou contre soi uniquement,
ou à des rapports de force ou domination s’exerçant
aussi par des « brutalités mentales ». Pour rappel, le BIT
propose une définition large : « Toute action, tout inci-
dent ou tout comportement qui s’écarte d’une attitude
raisonnable par lesquels une personne est attaquée,
menacée, lésée ou blessée, dans le cadre ou du fait direct
de son travail ». Les diverses définitions englobent deux
aspects de la violence en milieu de travail : d’une part
les phénomènes de violence sociale subie par des tra-
vailleurs, avec des incidences possibles sur leurs activi-
tés, et d’autre part des phénomènes de violence au
travail résultant en général des rapports sociaux ou de
domination dans le travail ou plus rarement de l’usage
de la violence comme un instrument de pouvoir.
Violence sociale en milieu de travail
Les données quantitatives disponibles, tirées notamment
de la littérature anglo-saxonne ou scandinave, montrent
essentiellement la fréquence des phénomènes de vio-
lence sociale subis en particulier dans le secteur des ser-
vices et dans les professions en contact direct avec le
public : personnels soignants des hôpitaux et des servi-
ces d’urgence, gardiens de prison, policiers, conducteurs
de transports publics, pompistes, personnel enseignant,
travailleurs sociaux, éducateurs, personnel des agences
bancaires, transporteurs de fonds, personnel au contact
du public dans les services administratifs (ANPE, sécu-
rité sociale, trésor public, poste…), caissières de la grande
distribution, agents de restauration, employés de com-
merce, personnel des plateaux clientèle des entreprises,
pharmaciens, médecins généralistes… Les pourcentages
de personnel touché sont extrêmement variables en
fonction des méthodes d’étude et des secteurs étudiés.
Nous n’aborderons pas ici les origines de cette vio-
lence sociale, renvoyant à la lecture d’investigations
sociologiques spécifiques qui mettent clairement en
avant les problèmes de non emploi et de grande préca-
rité économique et sociale dans les populations en
cause.
Les conséquences psychopathologiques de la violence
subie par les salariés dans les secteurs énumérés ci-des-
sus et leur traitement font l’objet de publications relati-
vement nombreuses. Beaucoup sont centrées sur une
approche symptomatique censée traiter les troubles
psychiques liés au traumatisme ou leur chronicisation
à distance et font l’impasse sur l’analyse du travail et
des facteurs professionnels favorisant les situations de
violence. Dans les situations de stress post traumatique,
l’efficacité à moyen ou long terme des différentes
méthodes de débriefing, pratiquées généralement par
des cliniciens ayant une méconnaissance du travail,
n’a pourtant pas été réellement démontrée comme
l’indiquent en particulier certaines méta analyses ou
revues de la littérature récentes. Un risque d’effet délé-
tère est même avancé par certains auteurs, du fait de la
réexposition au traumatisme à travers les processus
mnésiques, de la fixation et de la dramatisation accrue
des événements traumatisants. Ces éléments risquent
d’interférer avec les processus spontanés d’adaptation
et le rétablissement de la santé psychique. Ces données
ne sont pas contradictoires avec la possibilité d’un sou-
tien social immédiat ou rapide apporté par l’entourage
proche, notamment professionnel, et avec le travail
d’écoute compréhensive de la part du médecin du tra-
vail afin d’instruire la question du travail derrière le
traumatisme vécu.
Les études qualitatives, sociologiques, ergonomiques
ou se référant en particulier à la psychodynamique et la
psychopathologie du travail à partir d’investigations

29e Congrès national de médecine et santé au travail
272 Arch Mal Prof Env 2006
cliniques de terrain, sont assez fournies. Elles montrent
comment la violence des clients ou usagers apparaît
bien aujourd’hui comme une composante du travail
réel des salariés dans les activités de service. Elles
apportent surtout un éclairage compréhensif des phé-
nomènes de violence au travail du point de vue de la
santé au travail. Derrière ces phénomènes, il s’agit
effectivement de comprendre comment les évolutions
de l’organisation et des conditions de travail peuvent
engendrer des formes très diverses de souffrances et
décompensations psychopathologiques, favoriser et
aggraver les situations de violence sociale subie par les
salariés ou/et aboutir à des dégradations des rapports
sociaux suffisamment avancées pour engendrer des
situations de violence au travail.
Plusieurs facteurs importants ressortent particulière-
ment des enquêtes publiées sur ce thème dans les
services :
- les problèmes de réduction d’effectifs et leur gestion,
l’utilisation habituelle de contractuels précaires rem-
plaçants non qualifiés pour pallier les arrêts de travail
des personnels en souffrance, induisant des augmenta-
tions lourdes de charge de travail pour les personnels
en place, la baisse de qualité du travail fourni, augmen-
tant le risque de conflictualité entre salariés et d’actes
de violence qui en découle ;
- le turn-over important des personnels, l’évaluation
individualisée des performances et la mise en compéti-
tion des salariés qui entravent la construction de stra-
tégies collectives de défense face à la peur et aux
situations de violence et l’élaboration de règles collec-
tives de métier, notamment pour désamorcer la vio-
lence ;
- les conflits éthiques posés aux salariés entre des
objectifs quantitatifs de rentabilité économique pres-
crits et le désir d’un service de qualité réel pour l’usager
ou le client, amenant à des situations de mal être per-
manent avec risque de décompensation et à des réac-
tions défensives individuelles inévitables.
Au-delà, d’un secteur d’activité à l’autre, on retrouve
très fréquemment des stratégies collectives de défense
du même type, celles des personnels en contact avec le
public pour lutter contre la souffrance et la peur de
l’agression, et celles des hiérarchies dans la crainte de
voir mises en cause les stratégies organisationnelles et
de gestion de l’entreprise. Le déni de l’importance quan-
titative ou de la gravité des phénomènes de violence, le
rejet de responsabilité des incidents sur des employés à
la personnalité « fragile » ou incompétents sont par
exemple des réactions habituelles des personnels
d’encadrement. L’impossibilité pour les uns et les autres
de penser ce qui fait difficulté dans le travail aboutit
dans bien des situations à des fausses solutions de pré-
vention car déconnectées de la réflexion sur l’activité
réelle. Les propositions dans ce sens de formations alibi
à la gestion du stress, de « coaching » individuel de
salariés « fragiles » par des organismes ou personnes
extérieures à l’entreprise, ou de sélection à l’embauche
des salariés sur le « profil psychologique », de plus en
plus banalisées, ne peuvent constituer de fait des solu-
tions au problème complexe de la violence et risquent
de radicaliser les stratégies de défense des uns et des
autres. Comme le montrent des investigations ou
recherches faites dans certains des secteurs cités plus
haut, la recherche de vraies solutions est difficile et
implique nécessairement la création ou reconstitution
d’espaces de délibération sur le travail impliquant les
différents niveaux de l’entreprise pour ouvrir plus glo-
balement à la réflexion collective sur le travail réel dans
les activités de service et sur ses conséquences dans la
survenue et la gestion de la violence des usagers.
Violence au travail
Les phénomènes de violence en milieu de travail appa-
raissent dans la majorité des cas comme une consé-
quence possible des rapports sociaux de travail et de la
domination. Que ce soit dans les entreprises de services
ou dans d’autres secteurs, ils sont habituellement le
reflet d’une réaction paroxystique de personnes souf-
frant de l’injustice liée à l’iniquité non reconnue de leur
situation de travail. La fréquence des actes de violence
au travail, qu’il s’agisse d’actes compulsifs contre les
autres (agressions, actes de sabotage, etc.) ou d’actes
prémédités contre soi (tentatives de suicides…) est diffi-
cile à apprécier du fait de l’insuffisance d’études quan-
titatives et des stratégies de dissimulation dont ils font
très souvent l’objet. Les investigations cliniques révè-
lent pourtant que ces actes sont associés à des états de
souffrance mentale grave s’exprimant par des troubles
psychopathologiques très divers (dépression, bouffée
délirante, syndrome confusionnel, etc.) nécessitant des
prises en charge médicales urgentes.
Les études sur le stress au travail, utilisant les modèles
épidémiologiques (Karasek, Siegrist) et pointant sur les
facteurs de risque psychosociaux, mettent en avant
deux facteurs de risque importants de décompensation
psychopathologique, notamment de dépression, et de
passage à l’acte violent éventuel :
- d’une part l’absence de reconnaissance symbolique
ou/et matérielle des efforts consentis par les salariés
concernés pour assurer malgré tout leur travail comme
l’absence de réponse aux difficultés qu’ils éprouvent
dans le travail ;

273
Violence au travail
Arch Mal Prof Env 2006
JEUDI 1ER JUIN
- d’autre part l’absence du facteur protecteur important
que constitue le soutien social de la part des collègues
de travail et de l’encadrement.
Les écrits de médecins du travail comme les enquêtes
menées en psychodynamique du travail décrivent clai-
rement cet isolement des victimes, la dégradation des
rapports sociaux, la désorganisation des coopérations
et au final la perte des solidarités individuelles ou col-
lectives dans le milieu de travail. Comme l’indique
C. Dejours, « L’inégalité est tolérable, l’injustice est
tolérable et l’iniquité peut être tolérable… », mais
« …C’est, dans tous les cas rapportés de violence face à
l’iniquité dans le travail, lorsque la communauté mani-
feste de l’indifférence, que la réaction à l’injustice peut
dégénérer en violence ».
En amont, ces études mettent en exergue les facteurs
organisationnels et les modes de management agressifs
qui favorisent les tensions et la dégradation des rap-
ports sociaux dans l’entreprise : réductions d’effectifs,
restructurations et modifications brutales non discu-
tées de l’organisation du travail, flexibilité et précarisa-
tion, individualisation du travail, objectifs imposés
quantitatifs ou de qualité totale irréalisables … Dans ce
contexte, les situations dites de « harcèlement moral »,
au delà de la représentation habituellement focalisée
sur la relation interpersonnelle entre « harceleur » et
« harcelé », sont bien l’expression de la conflictualité
aboutissant au repli individuel et à la dégradation des
relations dans le travail. Ignorer les conflits sous-
jacents dans ces situations revient à négliger ce que
leur élaboration pourrait produire en terme de liaison
intrapsychique comme en termes de reconstruction des
liens sociaux. Comme l’indique P. Davezies, « dans la
plupart des cas, c’est bien l’organisation du travail et
non la structure de personnalité perverse d’un chef ou
d’un collègue qui est à l’origine de comportements qui
semblent échapper à la logique, à la raison et à
l’entendement ». Comme dans la confrontation à la
violence sociale en milieu de travail, on ne peut donc
faire ici l’économie de l’analyse du réel du travail, du
débat sur l’organisation du travail et de ses conflits. Les
femmes payent un tribut plus lourd encore du fait de la
division sexuelle du travail persistante et donc de leur
présence en masse dans des secteurs d’activité et des
emplois où l’ampleur des contraintes de travail, le
cumul des facteurs de risque psychosociaux ajoutent
au risque d’isolement et aux difficultés d’organisation
de la vie familiale et du travail domestique supplémen-
taire qu’elles assument encore de façon très majori-
taire. La dernière enquête européenne de la fondation
de Dublin montre qu’elles sont beaucoup plus soumises
que les hommes aux situations de violence psychologi-
que, intimidations, menaces ou harcèlement.
La violence elle même peut être utilisé comme instru-
ment de pouvoir au sein de l’entreprise, notamment
lorsque des salariés sont exposés délibérément au
mépris des réglementations de sécurité et du droit du
travail à des risques graves d’accident ou de pathologies
(toxiques ou cancérogènes par exemple), sans forma-
tion et information données sur les risques encourus.
Des exemples de ce type sont régulièrement rapportés
dans le cas du travail intérimaire ou en sous-traitance,
généralement dans toutes les formes de travail précaire,
et plus encore dans les cas, comme dans le travail clan-
destin, où il est difficile voir impossible pour les tra-
vailleurs de recourir au droit.
Enfin, il est actuellement bien reconnu que les condui-
tes violentes constituent des stratégies collectives de
défense virile contre la peur dans certaines situations
de travail impliquant des risques importants d’atteinte
à l’intégrité corporelle, ce qui est le cas par exemple du
BTP. Ces stratégies et le risque contingent d’exporta-
tion de la violence dans l’espace privé familial ont été
bien décrits. Des techniques de prévention de ces con-
duites dangereuses ont d’ailleurs été expérimentées en
France dans la prévention des accidents dans le BTP.
Études d’intervention en milieu de travail
Les modalités des études d’intervention à visée préven-
tive de la violence sont variables en fonction des pro-
blèmes de violence étudiés et des savoir-faire des
intervenants.
Certaines privilégient une démarche mixte, d’abord
quantitative à partir des investigations épidémiologi-
ques de la santé mentale par les modèles de stress au
travail, puis qualitative visant à la réflexion sur les fac-
teurs de risque du travail et à la diminution des con-
traintes psychosociales. A partir de l’expérience
d’études d’intervention au Québec dans divers milieux
de travail, M. Vézina insiste sur les conditions de l’effi-
cacité de telles approches : nécessité d’une construction
méthodologique rigoureuse, démarche participative des
différents acteurs, implication de tous les niveaux hié-
rarchiques, participation des employés à la discussion
des problèmes et à l’élaboration des solutions et mise en
place rigoureuse des changements requis auprès des
populations de travailleurs ciblés. L’impact de l’inter-
vention peut être apprécié en comparant les résultats
obtenus après à la situation observée avant le projet ou
dans un autre groupe de l’entreprise non visé par
l’intervention.

29e Congrès national de médecine et santé au travail
274 Arch Mal Prof Env 2006
Les interventions de type qualitatif, utilisant l’analyse
ergonomique et la psychodynamique du travail ont
montré leur intérêt dans des situations de violence avec
dégradation avancée des rapports sociaux. Elles sont
utiles lorsqu’elles privilégient des modalités d’interven-
tion permettant de renouer avec le vécu et le réel du
travail et qui puissent dans le même temps relier la
diversité des points de vue (métiers et hiérarchie) de
façon à recréer de la coopération. Elles impliquent éga-
lement une négociation préalable visant à l’obtention
d’un minimum de marges de manœuvre avec les res-
ponsables de l’entreprise. Il faut effectivement savoir ce
qu’ils sont prêts à entendre sur les liens entre santé
mentale, violence et organisation du travail. L’expé-
rience montre que l’engagement du médecin du travail
est essentiel dans de nombreuses interventions, en
amont pour préparer les esprits à ce débat, pour créer la
confiance entre les acteurs internes et des intervenants
externes puis pour accompagner l’intervention.
Enfin, de plus en plus de publications font état d’inter-
ventions de médecins du travail basées sur une démar-
che clinique spécifique en santé au travail, afin d’aider
réellement les salariés victimes de violence dans le pro-
cessus de reconstruction de leur santé en instruisant la
question du travail. Cette démarche ne s’improvise pas,
elle peut se nourrir de l’expérience de la mise en débat
de cas cliniques et pratiques dans des structures profes-
sionnelles adaptées. Ceci peut aider non seulement à
clarifier et enrichir la nosographie de la psychopatho-
logie du travail mais aussi, par l’élaboration commune
de règles de métier, de bien spécifier l’intervention du
médecin du travail dans des situations cliniques
variées, qu’il s’agisse de situations d’urgences sanitai-
res ou psychosociales liées à la violence ou d’anticiper
et prévenir les risques de violence. Favorisée par l’orga-
nisation d’espaces de délibération collective, l’activité
coopérative des médecins du travail permet sans aucun
doute d’augmenter leurs marges de manœuvre dans
l’action vis à vis de la violence en milieu de travail
dans toutes ses formes.
Bibliographie
Aulagnier M., Verger P., Rouillon F. Efficiency of psychological
debriefing in preventing post-traumatic stress disorders. Rev
Epidemiol Santé Publique 2004, 52 : 67-79.
Beaud S., Pialoux M. Violences urbaines, violences sociales.
Genèse des nouvelles classes dangereuses. Éds Fayard, 2003.
Bourbonnais R. et al. Une intervention en centres d’hébergement
et de soins de longue durée visant à réduire les problèmes de
santé mentale liés au travail. Pistes 2005, 7, 3 3 (www.pis-
tes.ucam.ca).
Chappell D., Di Martino V. La violence au travail. Publications
du BIT : Bureau International du Travail. Genève, 2000.
Cru D. Les savoir-faire de prudence dans les métiers du bâtiment.
Nouvelles contributions de la psychopathologie du travail à
l’étude de la prévention. Cahiers médico-sociaux 1983, 27 :
239-47.
Davezies P. Évolution des organisations du travail et atteintes à
la santé. Travailler 1999, 3 : 87-114.
Davezies Ph., Les impasses du harcèlement moral. Travailler
2004, 11 : 83-90.
Dejours C. Souffrance en France. La banalisation de l’injustice
sociale. Éds du Seuil. Paris, 1998.
Dejours C. Rapport final des Travaux préparatoires à l’élabora-
tion du Plan Violence et Santé en application de la loi relative à
la politique de santé publique du 9 août 2004. Commission
« Violence, travail, emploi, santé ». Mars 2005.
Dejours C. Nouvelles formes de servitude et suicide, Travailler
2005, 13 : 53-74.
Doniol-Shaw G., Huez D., Sandret N. Les intermittents du
nucléaire. (Enquête STED sur le travail en sous-traitance dans la
maintenance des centrales nucléaires). Éds Octares, 1995.
Huez D. Développer des « alertes de risque psychosocial » par le
médecin du travail. Cahiers SMT 2004, 19 : 18-20.
Renault E. L’expérience de l’injustice. Reconnaissance et clini-
que de l’injustice. Éds La Découverte. Paris, 2004.
Rose S., Bisson J., Churchill R., Wessely S. Psychological debrie-
fing for preventing post traumatic stress disorder (PTSD). The
Cochrane Database of Systematic Reviews 2005, Issue 4. The
Cochrane Collaboration. John Wiley et Sons Publ., Ltd.
Vezina M., Dussault J. Au delà de la relation « bourreau-
victime » dans l’analyse d’une situation de harcèlement psycho-
logique. Pistes 2005, 7, 3 (www.pistes.ucam.ca).
Violence faite aux femmes au travail :
le point de vue des sociologues
H. HIRATA
S’il est vrai que la violence faite aux femmes au travail
(professionnel et salarié) se déroule dans la sphère du
public, elle est indissociable de la violence dans la
sphère du privé, notamment dans les lieux où s’effectue
le travail domestique, ce travail dit « d’amour ». En
effet, les rapports sociaux de sexe sont transversaux à
ces deux sphères et il n’est pas possible de les dissocier
quand il s’agit des rapports entre les hommes et les
femmes, notamment de violence des hommes sur les
femmes. Les liens qui unissent public et privé, dans ce
cas, ce sont les rapports hiérarchiques de domination,
d’oppression et de pouvoir [1].
Les premières études sociologiques et historiques con-
cernant la violence faite aux femmes au travail ont
porté essentiellement sur les violences liées à l’organi-
sation du travail, et notamment le harcèlement sexuel,
des chefs et des supérieurs hiérarchiques en général sur
les ouvrières et les subordonnées dans la hiérarchie de
1
/
4
100%