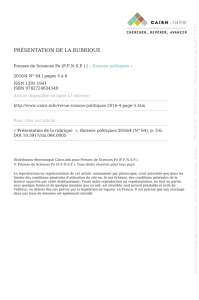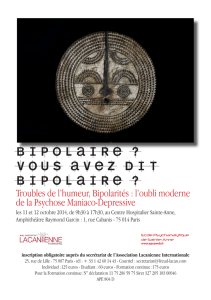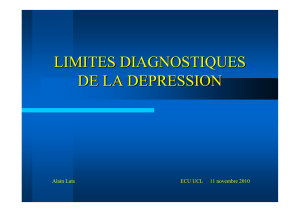Mélancolie : Folie, Génie ou Tristesse ? Psychanalyse
Telechargé par
jules.escargueil

MÉLANCOLIE : FOLIE, GÉNIE OU TRISTESSE ? LES VICISSITUDES DE
L'IDENTIFICATION ET DE LA FORMATION DU MOI
Jacqueline Amati-Mehler
Presses Universitaires de France | « Revue française de psychanalyse »
2004/4 Vol. 68 | pages 1113 à 1131
ISSN 0035-2942
ISBN 2130547230
Article disponible en ligne à l'adresse :
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
https://www.cairn.info/revue-francaise-de-psychanalyse-2004-4-page-1113.htm
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Distribution électronique Cairn.info pour Presses Universitaires de France.
© Presses Universitaires de France. Tous droits réservés pour tous pays.
La reproduction ou représentation de cet article, notamment par photocopie, n'est autorisée que dans les
limites des conditions générales d'utilisation du site ou, le cas échéant, des conditions générales de la
licence souscrite par votre établissement. Toute autre reproduction ou représentation, en tout ou partie,
sous quelque forme et de quelque manière que ce soit, est interdite sauf accord préalable et écrit de
l'éditeur, en dehors des cas prévus par la législation en vigueur en France. Il est précisé que son stockage
dans une base de données est également interdit.
Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)
© Presses Universitaires de France | Téléchargé le 15/02/2021 sur www.cairn.info (IP: 88.122.147.19)
© Presses Universitaires de France | Téléchargé le 15/02/2021 sur www.cairn.info (IP: 88.122.147.19)

Mélancolie : folie, génie ou tristesse ?
Les vicissitudes de l’identification
et de la formation du moi
Jacqueline AMATI-MEHLER
Dans toute séparation importante réside un
germe de folie ; il faut penser à le faire éclore
et à l’entretenir avec attention.
J. W. Goethe, Réflexions et pensées.
INTRODUCTION
Après une brève description de l’importance accordée à la mélancolie au
cours des siècles, je m’efforce d’explorer ce syndrome à la lumière des connais-
sances plus récentes que non seulement Freud, mais aussi les post-freudiens ont
apporté à notre discipline. J’examinerai notamment les implications des diffé-
rentes vicissitudes ayant trait à l’identification en rapport avec la complexité de
l’organisation psychique et, en particulier, en égard aux relations entre le moi et
le surmoi.
De façon assez singulière, le terme de « mélancolie », qui occupait une
place de première importance dans la philosophie, les arts et la médecine de
l’Antiquité, n’a pas mérité une rubrique propre dans le Vocabulaire de la psy-
chanalyse de Laplanche et Pontalis. Il se trouve inclus dans une rubrique qui a
trait au deuil en tant que résultat particulier du deuil pathologique dont Freud
parle dans son essai fondamental de 1915. La mélancolie semble, par la suite,
davantage à sa place dans des textes littéraires plutôt que dans la littérature
psychanalytique, dans laquelle on trouve la plupart du temps le terme de
« dépression », mais rarement celui de « mélancolie ».
Dans la traduction italienne de l’ouvrage exceptionnel qui rassemble des
textes de Klibansky, Panofsky et Saxl, intitulé Saturn and Melancholy, que j’ai
trouvé très inspirant, quelques lignes de la première page font référence au
Rev. franç. Psychanal., 4/2004
© Presses Universitaires de France | Téléchargé le 15/02/2021 sur www.cairn.info (IP: 88.122.147.19)
© Presses Universitaires de France | Téléchargé le 15/02/2021 sur www.cairn.info (IP: 88.122.147.19)

terme de « mélancolie » et à ses transformations au cours de deux mille ans
d’histoire :
« Dans le langage moderne, le terme de “mélancolie” (...) est employé pour désigner
indistinctement des choses très différentes. Il peut désigner une maladie mentale carac-
térisée par des attaques d’angoisse, de dépression et de fatigue, bien que, récemment,
le concept médical se soit sans aucun doute largement désintégré. »
Comme Starobinski l’a montré avec beaucoup d’érudition, ses origines
remontent à l’ancienne doctrine des quatre humeurs développée au cours de nom-
breux siècles, de nouvelles significations ayant de temps en temps été ajoutées aux
anciennes. La signification première de « mélancolie » renvoyait à une concep-
tualisation littérale dérivée d’une partie concrète, visible et tangible du corps, la
bile noire (en grec, melas signifie « noir ») qui, avec le flegme, la bile jaune et le
sang, formait les quatre humeurs. On pensait autrefois qu’elles correspondaient à
des éléments cosmiques contrôlant l’existence et les comportements humains et
qu’à travers leurs différentes combinaisons elles déterminaient les caractères indi-
viduels comme flegmatiques, colériques, sanguins et mélancoliques.
Les liens et inférences dérivés des quatre humeurs en rapport avec le tem-
pérament et les théories cosmologiques n’ont essentiellement pas varié jusqu’à
la Renaissance, bien qu’ils soient restés au centre de vives controverses philo-
sophiques.
Les considérations humorales ayant trait à la mélancolie ont toutefois
connu un sort très différent de celles se rapportant aux autres humeurs du fait
qu’elles attiraient l’attention sur le caractère fondamental de ses caractéris-
tiques psychologiques.
Au IVesiècle avant notre ère, aussi bien la folie que la dépression étaient
considérées comme des conséquences de cette « funeste substance » liée à ce qui
était nocturne et mortel. Des mythes et certains philosophes ont toutefois asso-
cié l’ « humor melancholicus » à des dieux et héros, bien que Platon ait consi-
déré que la mélancolie pouvait affaiblir l’esprit et la moralité.
La compréhension de la mélancolie fait un pas en avant quand le concept
de folie (furor) apparaît dans la philosophie de Platon qui la décrit comme
« obscurcissement de la conscience », peur et délires qu’il a cependant parfois
tendance à identifier à la « funeste sublimité », idéalisant ainsi furor et maladie
mentale comme des dons divins. Aristote, moins enclin à accepter la fureur
comme divine – bien qu’il reconnaisse que l’excellence humaine dans l’art, la
poésie, la philosophie et la politique soit souvent liée à la mélancolie –, tente
de donner une description plus scientifique de celle-ci, notamment de ses éven-
tuelles conséquences pathologiques tragiques. Dans un essai qui lui est attri-
bué, il décrit de façon détaillée le passage de la dépression et de l’angoisse
– résultat de la bile noire « froide » – comme faisant place à la joie et à
1114 Jacqueline Amati-Mehler
© Presses Universitaires de France | Téléchargé le 15/02/2021 sur www.cairn.info (IP: 88.122.147.19)
© Presses Universitaires de France | Téléchargé le 15/02/2021 sur www.cairn.info (IP: 88.122.147.19)

l’exaltation (état maniaque), résultat d’un « réchauffement » de la bile. Selon
l’incorporation des différents états possibles de la bile, dit Aristote, la mélan-
colie et l’état d’excitation peuvent entraîner des dispositions physiologiques
naturelles et temporaires ou des états d’exaltation incontrôlés suivis de graves
tendances suicidaires quand cet état (maniaque) fait place à la mélancolie.
Mais de nouveau, et pendant des siècles, la conviction que certains cas de
mélancolie sont un trait particulier du génie survit à côté de ce type de des-
criptions cliniques précises. Selon cette conviction, ces cas tombent dans la
catégorie des états d’esprit d’individus exceptionnellement doués sur les plans
intellectuel et moral, mus par la passion – parfois employé comme synonyme
de « mélancolie » – qui gouverne les héros et les personnages des grandes tra-
gédies. Ainsi :
« Le concept de “fureur” comme unique fondement d’un don élevé de création
appartenait à Platon. Il appartint à Aristote de tenter de faire passer la reconnais-
sance du lien mystérieux entre génie et folie – que Platon n’avait exprimé que dans le
mythe – dans le domaine de la rationalité scientifique ; de même que ce fut Aristote
qui tenta de résoudre les contradictions entre le monde des objets physiques et celui
des idées à travers une nouvelle interprétation de la nature » (Klibansky, Panofsky,
Saxl, p. 38).
L’évolution de la conceptualisation de la mélancolie a été ensuite, pendant
longtemps, déterminée par l’opposition entre les idées et pratiques médicales
spécifiques et celles des philosophies de la nature ou de la morale. L’idée de la
mélancolie, non pas seulement comme une maladie, mais plutôt comme une
constitution particulière, a fait son chemin au début du IIemillénaire, l’état
mélancolique intéressant alors aussi les théologiens de la morale, certains asso-
ciant la mélancolie à des influences démoniaques alors que d’autres y voyaient
une punition divine. La dépression monastique caractéristique et la punition
infligée à soi-même dans l’accablement de la culpabilité constituent un chapitre
fascinant dans l’histoire de l’évolution de la mélancolie, de la contamination
mythique et théologique à l’investigation de ses symptômes psychologiques et
physiques. Du Xeau XIIesiècle, les médecins arabes parlent de « maladie de
l’âme » qui pouvait affecter les trois principales vertus du cerveau, c’est-à-dire
l’imagination, la cognition et la mémoire.
À la fin du Moyen Âge, la mélancolie est de plus en plus employée comme
synonyme de simple « tristesse », même lorsque aucune raison reconnaissable
ne pouvait l’expliquer. Il est intéressant de noter que le dictionnaire de la
langue italienne mentionne explicitement le terme malinconia (que je n’ai trouvé
dans aucune autre langue) qui désigne un « sentiment de tristesse doux, presque
mélancolique et nostalgique » (la matière de tant de poèmes) ; aussi, une per-
sonne malincolic est définie comme envahie par un état d’esprit apaisant, calme
Mélancolie : folie, génie ou tristesse ? 1115
© Presses Universitaires de France | Téléchargé le 15/02/2021 sur www.cairn.info (IP: 88.122.147.19)
© Presses Universitaires de France | Téléchargé le 15/02/2021 sur www.cairn.info (IP: 88.122.147.19)

et mélancolique, temporaire (ou durable), certainement très éloigné de la psy-
chose maniaco-dépressive1.
La signification de l’adjectif « mélancolique » s’est étendue en passant de la
qualification d’un état individuel à une description plus générale de choses ou
de situations, telles celles, par exemple, d’un paysage, une soirée, ou d’un
automne qualifiés de mélancoliques. Des expressions comme celles-ci sont
devenues des composantes de textes littéraires et poétiques.
Selon Klibansky, Panofsky et Saxl, en France le terme de « mélancolie »
dans les récits, la poésie et la prose a été particulièrement adopté par des écri-
vains des belles-lettres de la fin du Moyen Âge et l’on trouve de nombreux
exemples littéraires dans leurs œuvres. On trouve même dans la littérature fran-
çaise le verbe merencolier comme synonyme d’ « attrister », ou bien, dans la lit-
térature amoureuse, l’expression de petites merencolies pour parler des querelles
entre amants. Autour du XVesiècle, la fusion des termes de « mélancolie » et de
« tristesse » acquiert des significations plus complexes allant des sentiments
subjectifs à la maladie psychique objective mêlée à un sentiment de douleur et
de malheur ; aussi, le sentiment de tristesse mélancolique est évoqué comme fai-
sant partie de la conscience humaine de la finitude et de la mort. Au début des
années 1800, la mélancolie romantique, si chère aux écrivains, poètes et musi-
ciens, exprime ce que l’expression allemande de Welt Schmertz2illustre particu-
lièrement bien.
Avant de laisser ces considérations et d’entrer dans une discussion plus
spécifiquement psychanalytique, je voudrais noter que le titre du livre que j’ai
cité, Saturn and Melancholy, rappelle la solide conviction (toujours présente à
l’époque de la Renaissance) que la mélancolie a un rapport particulier avec
Saturne considéré comme responsable du « caractère triste et du sort malheu-
reux du mélancolique » (ibid.). Je ne peux, bien entendu, évoquer toutes les
représentations célèbres de la mélancolie dans la sculpture, la peinture et le
design, celle de Dürer, par exemple, ou encore les nombreuses figures de mélan-
coliques représentant les fils de Saturne. J’ai seulement pris la liberté de citer à
la fin de mon texte un poème de Paul Verlaine, tout à fait évocateur de ce dont
nous parlons ici.
1116 Jacqueline Amati-Mehler
1. Cette façon d’être nostalgique semble se rapprocher de ce que certains phénoménologues tels
que Binswanger et Minkowski ont décrit comme un « monde mélancolique » teinté d’une façon parti-
culièrement pleine de regret de vivre le temps, les relations entre passé, présent et futur. Il y a une ten-
dance à s’attarder sur des pensées telles que : ... si j’avais eu... si je n’avais pas fait ceci ou cela... – un
sentiment d’occasions perdues ou de choses que l’on aurait pu faire qui expose les sujets à la
mélancolie.
2. On peut traduire à peu près cette expression en français par « vague à l’âme ». [N.d.T.]
© Presses Universitaires de France | Téléchargé le 15/02/2021 sur www.cairn.info (IP: 88.122.147.19)
© Presses Universitaires de France | Téléchargé le 15/02/2021 sur www.cairn.info (IP: 88.122.147.19)
 6
6
 7
7
 8
8
 9
9
 10
10
 11
11
 12
12
 13
13
 14
14
 15
15
 16
16
 17
17
 18
18
 19
19
 20
20
1
/
20
100%