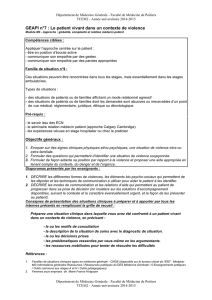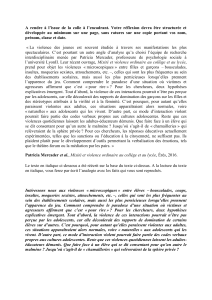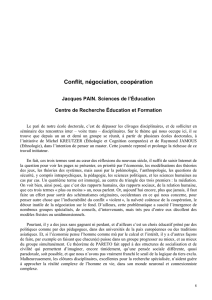Projet de recherche de Sabrina Melenotte, candidate au concours de CR2 du CNRS. Appel 2016.
1
Sabrina MELENOTTE Concours 40/04, 2016
Modus operandi
de la brutalité au Mexique :
citoyenneté armée en contexte (post-)autoritaire.
Résumé
En quoi les violences contemporaines au Mexique remettent-elles en question la transition
démocratique entamée dans les années 1990 ?
Il se concentrera autour de trois axes de recherche : d’une part, les masculinités armées,
analysées depuis la ritualisation des manifestations et des symboles de la violence par des
« non-professionnels » de la violence ; d’autre part, les corps violentés comme véhicules de
messages politiques et criminels. Il se veut à la fois une contribution à l’analyse des guerres et
des violences contemporaines et un renouvellement du questionnement de la démocratie
dans un contexte qui se prétend « post-autoritaire ».
À partir d’une enquête ethnographique menée dans deux états fédérés du Mexique, ce projet
se concentrera sur le phénomène de la décentralisation de la violence légitime comme le
symptôme contemporain des guerres nouvelles. Le cas mexicain offre un exemple
emblématique d’une transition politique d’un État aspirant à une modernité démocratique
sans réussir pourtant à se défaire de violences politiques et criminelles. Celles-ci sont
intégrées au champ social et ont perdu leur caractère extra-ordinaire, la vie quotidienne des
Mexicains étant le théâtre de scènes d’une extrême cruauté qui interroge les mécanismes de
telles pratiques brutales. Cette banalisation de la violence est un effet immédiat de la
militarisation de plusieurs régions du pays, de l’extension des droits militaires dans la vie
civile, et de la répression de nombreux mouvements sociaux, depuis la volonté officielle du
gouvernement mexicain de « lutter contre le narcotrafic ». En réponse, la popularisation et la
propagation de l’usage des armes dans la sphère civile interrogent en profondeur les
paradigmes de la démocratie et de l’État. La décentralisation du monopole de la violence
légitime et la professionnalisation d’acteurs civils qui s’arment et se préparent au combat
fabriquent de nouvelles expressions citoyennes éminemment ambiguës : symptômes à la fois
de l’abandon de l’État amenant des « non-professionnels de la violence » à s’armer pour
défendre leurs familles ou leurs communauté, tout en imitant les « professionnels de la
violence » par l’acquisition d’uniformes militaires, d’armes de haut calibre, mais aussi de
techniques et stratégies militaires. Ce projet s’intéresse donc aux ancrages sociaux de la

Projet de recherche de Sabrina Melenotte, candidate au concours de CR2 du CNRS. Appel 2016.
2
violence auxquels s’ajoute un imaginaire politique singulier au Mexique dans lequel puisent
les divers bandits sociaux pour légitimer leur projet. L’enjeu est de démontrer à la fois qu’il
est nécessaire d’historiciser la violence et d’intégrer, plutôt que d’opposer, les « non-
professionnels de la violence » à l’étude du projet de nation au Mexique.
1. Objets et objectifs de ma recherche
Au Mexique, la dénommée « lutte contre le narcotrafic », entamée par l’ancien Président de la
République Felipe Calderón Hinojosa (2006-2012) a bouleversé les modalités de la violence.
Sa nature et son échelle se sont transformées sous l’effet des dispositifs de sécurité mis en
place dans le pays depuis le Plan Mérida lancé en octobre 2007
1
. Pendant sa campagne,
l’actuel Président de la République, Enrique Peña Nieto avait également promis de lutter
efficacement contre le narcotrafic, assurant que les premiers résultats se feraient sentir au
bout d’un an. Beaucoup de Mexicains ont voté pour le retour du Parti Révolutionnaire
Institutionnel (PRI) en espérant que la politique de l’ancien parti hégémonique allait rompre
avec celle de son prédécesseur. Or, il s’avère que la politique de sécurité poursuivie par
l’actuel Président Enrique Peña Nieto n’est guère différente de celle de Felipe Calderón et
l’on compte aujourd’hui plus de 120 000 morts (chiffres officiels) et plus de 25 000 disparus.
Les politiques sécuritaires et de régulation n’ont donc fait qu’accroître la violence dans le
pays, marquant le retour d’un régime autoritaire et de pratiques violentes généralisées.
Le « tournant démocratique », entamé au Mexique à la fin des années 1980, n’a eu d’impact
ni sur les violences, ni sur les activités informelles et illégales. En ce sens, la recrudescence
des violences depuis 2007 au Mexique confirme l’hypothèse de mes recherches doctorales de
l’échec d’une transition démocratique pourtant convoitée. On peut même dire que non
seulement la « transition démocratique » au Mexique ne s’est pas accompagnée de la
diminution de la violence et de la coercition, mais qu’elle a plutôt signifié leur augmentation
et leur déplacement sur de nouveaux terrains.
Le déplacement de la violence est autant quantitatif que qualitatif : bien qu’il n’y ait pas de
consensus, les chiffres officiels montrent une explosion nette du nombre d’homicides à
partir de 2006 ; et la géographie de la violence semble s’être déplacée ces dernières années
1
L’Initiative Mérida est un projet d’aide extérieure lancé par les États-Unis en octobre 2007 et concrétisé par une
loi du 30 juin 2008 sous l’administration Bush, visant à mener des opérations armées au Mexique, en Amérique
Centrale et dans les Caraïbes, contre le trafic de stupéfiants et les opérations annexes qu’il engendre, comme le
blanchiment d’argent, le trafic d’armes, la création de gangs. Souvent comparé au Plan Colombie qui a soutenu
des forces militaires et paramilitaires dans la lutte contre les cartels, l’Initiative Mérida prétend moderniser les
forces armées mexicaines et renforcer le complexe militaro-industriel des États-Unis. Au Mexique, c’est la
Marine nationale qui a été au premier plan des opérations contre les narcotrafiquants, l’amenant à opérer sur
plusieurs territoires reculés, dont le Chiapas. Elle est jugée la « moins corrompue » des forces armées et
policières du pays.

Projet de recherche de Sabrina Melenotte, candidate au concours de CR2 du CNRS. Appel 2016.
3
des régions rurales et indiennes du Sud et du Centre du Mexique, dans les années 1990, au
Nord et dans les zones urbaines et semi-urbaines.
En outre, si la militarisation récente de plusieurs régions du pays témoigne d’une volonté
officielle de « lutter contre le narcotrafic », elle est aussi un moyen de réprimer les
mouvements sociaux, surtout dans le Sud du pays, au point qu’il est difficile quelquefois de
savoir qui la produit et qui elle vise. Aujourd’hui, la violence s’est généralisée à l’ensemble de
la société mexicaine, multipliant l’armement des groupes sociaux et politiques. Wil Pansters
(2012) les qualifie de « post-autoritaires » car, par leurs actions, ils échappent à l’ancienne
opposition entre guérilla et armée répressive. Ce terme désignerait ainsi les acteurs à la
gâchette facile (gangs, organisations criminelles), les forces de police corrompues, les
paramilitaires, les agents de sécurité privatisés (vigiles, miliciens).
La propagation du champ militaire dans la sphère sociale et civile dissout les frontières de la
définition de la guerre et établit des rapports violents durables. La durabilité du temps de la
guerre et sa propagation spatiale aux sphères civiles amène donc à s’interroger sur la mise en
concurrence d’acteurs privés avec l’État. La privatisation de l’espace et de la justice passe par
l’autonomisation de la violence (et vice-versa), invitant à réfléchir à la manière dont les
groupes privés subvertissent, voire se substituent, aujourd’hui à l’État grâce au contrôle de la
violence légitime.
Ce projet de recherche a pour ambition d’ouvrir une boîte de Pandore pour interroger et
débattre des concepts tels que « démocratie », « citoyenneté », « violence » ou « résistance » à
partir de l’étude du modus operandi de la brutalité au Mexique. Par brutalisation, je m’inspire de
la traduction française du travail de George L. Mosse (1999) sur la Grande Guerre et les
totalitarismes dans les sociétés européennes, mais que l’on pourrait tout autant rapprocher
du terme « ensauvagement » : la banalisation et l’intériorisation de la violence de guerre qui
s’établit durablement et sont ensuite réinvestis dans le champ politique, même une fois la
guerre finie. Je reprends donc à mon compte ce concept de Mosse, qui n’est d’ailleurs pas
sans faire écho à celui de « banalité du mal » d’Hannah Arendt, pas tant pour étudier une
situation d’après-guerre comme ont pu le faire les contributeurs de l’ouvrage collectif sur les
anciens combattants (Duclos 2010), que pour étudier une situation de guerre civile en cours
au Mexique. En revanche, certaines différences apparaissent d’emblée : la brutalisation des
individus que Mosse a étudiée dans le cadre des sociétés européennes se faisaient dans des
cadres à peu près pacifiés au début du XXe siècle, et chez des individus qui connurent des
ruptures brutales, par un effondrement du « temps de paix » et l’arrivée soudaine d’une
violence de grande intensité pour les combattants (Saint-Fuscien 2013).

Projet de recherche de Sabrina Melenotte, candidate au concours de CR2 du CNRS. Appel 2016.
4
Or l’une des premières difficultés est de qualifier la violence contemporaine au Mexique.
D’une part, l’imbrication des acteurs politiques et criminels dans le pays rend les frontières
entre des violences de différentes natures poreuses et difficilement discernables. D’autre part,
la définition et la nature mêmes des violences posent problème, la « guerre contre le
narcotrafic » se rapprochant davantage d’une guerre civile qui masque son nom, et qui
s’appuie sur de multiples troupes irrégulières et labiles imitant ou réalisant le travail effectif
de la guerre par des professionnels de la violence. Cela signifie qu’aujourd’hui au Mexique, la
nature de la guerre contemporaine se distingue de politiques d’annihilation complète d’un
peuple, comme ce fut par exemple le cas au Guatemala, ou de nombreuses dictatures latino-
américaines du Cône Sud. Elle est également différente des techniques de contre-insurrection
employées dans le conflit armé au Chiapas avec la « guerre de basse intensité » qui s’appuyait
davantage sur une intervention indirecte de l’Armée par la formation de groupes
paramilitaires. Les combattants n’appartiennent pas ou plus à aucune troupe régulière, mais à
des groupes, plus ou moins formels et organisés, plus ou moins mobiles et éphémères, plus
ou moins politisés et criminels, composés de rebelles, de partisans, de miliciens, d’activistes,
de terroristes ou de mercenaires, aux loyautés sociales et politiques qui les placent en
décalage et en opposition aux États, et employant des moyens de combat dont le spectre va
des plus conventionnels aux plus répréhensibles (Linhardt et Moreau de Bellaing 2014).
Pourtant, la brutalisation contemporaine de la société mexicaine interroge l’impact de la
généralisation de la violence sur la temporalité, comme dans des régimes de terreur (Taussig
1984; Pécaut 2007), qui s’affranchissent de l’opposition entre temps de paix et temps de
guerre. La temporalité qui s’installe dans ces régimes peut être celle de l’attente de la
prochaine guerre, en espérant que celle-ci ne va pas exploser, mais aussi celle d’une guerre
sans fin ni victoire ou défaite. En ce sens, le cas mexicain s’inscrit dans la lignée des travaux
récents qui portent sur la temporalité de l’entre-deux que des expressions comme « ni guerre,
ni paix » (Linhardt et Moreau de Bellaing 2014), ou d’« entre-guerres » (Debos 2013)
traduisent, pour signifier les déplacements des « guerres nouvelles ». Celles-ci n’opposeraient
plus uniquement les armées régulières des États souverains depuis la fin de la Deuxième
Guerre mondiale. Mais la nuance de l’analyse depuis le cas mexicain s’impose dès lors qu’on
adopte une démarche historicisante, obligeant à affiner l’analyse en termes de « guerres
nouvelles ». Au Mexique, des mercenaires et des pistoleros ont toujours coexisté avec l’État
moderne en construction et qui tentait de centraliser son pouvoir. Dire cela invite à
interroger les termes de la « démocratisation », entendu trop souvent comme le passage au
multipartisme et aux processus électoraux. Au contraire, la transition politique des années
1990 n’a, malgré la consolidation du multipartisme, pas mis fin à des violences durables,
encore moins à pratiques des armes qui font du Mexique un nouveau western. Il est donc
nécessaire de porter un regard critique sur les travaux de la première heure sur la « transition
démocratique » au Mexique (Linz et Stepan 1996; Kotler et Washington Office on Latin
America 1995; Eisenstadt et Hindley 1999; Woldenberg 2012; Viqueira Alban et Sonnleitner
2000; Sonnleitner 2001b; « Challenges to Mexico’s Democratic Consolidation » 2006; Bey et
Dehouve 2006), ainsi que de dépasser une vision normative de la « démocratie », qui

Projet de recherche de Sabrina Melenotte, candidate au concours de CR2 du CNRS. Appel 2016.
5
postulerait une vision linéaire du processus d’une transition politique, celle d’un passage des
« balles » au « vote », « from bullet to ballot », une expression anglo-saxonne souvent
employée encore pour décrire les transitions politiques dans différents contextes (Sonnleitner
2001a; Trelles et Carreras 2012).
Modification de la question de la brutalisation des sociétés car la pénétration de la
violence et de pratiques des armes parmi des acteurs a priori « non-violents » signifie
qu’il y a un déplacement du rapport à la violence dans le champ social, y compris
dans les institutions.
Mon hypothèse est que les mutations de la brutalité des formes de la violence passe
par l’émergence d’une nouvelle figure du combattant qui se généralise à plusieurs cas
d’étude dans le monde, mais qui sera abordée ici par le cas mexicain : le « civil-
combattant »
L’héritage révolutionnaire
Il s’agit donc de comprendre que la définition de la « délinquance » et de la « criminalité » au
Mexique intègre des pratiques très diverses de la violence, dont celle de groupes civils qui
s’arment pour répondre à la violence quotidienne vécue.
À y regarder de plus près, les « zones de non-droit » sont des régions marquées par un fort
taux de marginalité et où l’État n’incarne pas et n’a jamais incarné la protection envers la
population. Ainsi en est-il des États du Chiapas, du Guerrero ou du Michoacán, où la
pauvreté est plus élevée que la moyenne nationale, où la population est essentiellement
indienne et souffre d’un accès aux services publics et à la justice. J’ai montré dans ma
recherche doctorale que la création de pouvoirs personnalistes et arbitraires incarnés par de
forts caciques locaux illustre parfaitement que ni la formation d’un État postrévolutionnaire,
ni la transition démocratique des années 1990, n’ont jamais réussi à mettre fin à des rivalités
entre factions locales. Certaines de ces factions locales bénéficient directement des
ressources économiques liées aux partis politiques mais aussi de l’appui des élus locaux et
régionaux. D’autres au contraire préfèrent l’allégeance de cartels de la drogue. D’autres enfin
ont élaboré de longue date des mécanismes de défense face à la violence politique récurrente.
Concernant ce dernier point, le projet zapatiste au Chiapas a été l’un des projets les plus
emblématiques de cette position défensive face à la violence étatique, par un projet
d’autonomisation du politique et de la justice.
L’une des spécificités du Mexique réside dans le fait que le pays est imprégné d’un imaginaire
renvoyant au mythe révolutionnaire qui a forgé le nationalisme mexicain et qui est
aujourd’hui à l’œuvre dans le conflit dissymétrique qui meut le pays. Il est nécessaire de
 6
6
 7
7
 8
8
 9
9
 10
10
 11
11
 12
12
 13
13
 14
14
 15
15
 16
16
1
/
16
100%